 Avant d’y venir, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques définitions d’une notion qui n’a cessé de varier historiquement, comme le souligne le Dictionnaire des notions de l’Encyclopédie Universalis : « Outils, machines, instruments… définir ces trois classes d’objets techniques créés par l’homme pour son usage propre n’a vraiment de sens qu’à un moment donné de l’histoire. […] Les frontières de ces définitions sont perméables ; il est bien souvent difficile de classer tel ou tel objet. »[1].
Avant d’y venir, il n’est peut-être pas inutile de rappeler quelques définitions d’une notion qui n’a cessé de varier historiquement, comme le souligne le Dictionnaire des notions de l’Encyclopédie Universalis : « Outils, machines, instruments… définir ces trois classes d’objets techniques créés par l’homme pour son usage propre n’a vraiment de sens qu’à un moment donné de l’histoire. […] Les frontières de ces définitions sont perméables ; il est bien souvent difficile de classer tel ou tel objet. »[1].
Moins circonspecte, l’Encyclopédie Larousse définit la machine comme un « Appareil ou ensemble d’appareils capable d’effectuer un certain travail ou de remplir une certaine fonction, soit sous la conduite d’un opérateur, soit d’une manière autonome. Toute machine est transformatrice d’énergie. »[2]. Cette définition, qui inscrit la machine dans le paradigme thermodynamique, insiste sur l’idée de travail produit par transformation d’énergie. C’est ce que confirme le Petit Robert qui définit la machine comme un « objet fabriqué, généralement complexe (V. mécanisme), destiné à transformer l’énergie (V. moteur) et à utiliser cette transformation ». C’est ce qui, en principe, distingue la machine de l’appareil ou de l’outil « qui ne font qu’utiliser l’énergie ». D’où une définition de la machine comme « système où existe une correspondance spécifique entre une énergie ou une information d’entrée et celles de sortie ». À l’ère de l’informatique triomphante, ce qui est transformé, ce n’est plus de l’énergie en provenance d’une source naturelle mais de l’information, ainsi qu’en témoigne l’élargissement de la définition auquel procède le Dictionnaire Culturel des Sciences : « Une machine est un ensemble de mouvements, de transmissions et d’informations, ensemble animé et capable de produire un effet désiré ou appréciable ». Si cette définition insiste sur l’effet produit, il faut rappeler deux autres caractéristiques essentielles de la machine, apparues à la Renaissance : « l’automatisme et la régulation, ou contrôle par la machine elle-même de son propre mécanisme »[3].
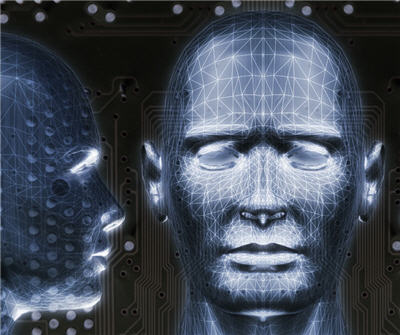 Lorsque la machine devient capable, non seulement de régulation, mais aussi de rétroaction, alors elle commence à s’apparenter au cerveau humain. La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures. Elle suppose un principe d’apprentissage continu, basé sur les échanges d’information entre un système et son environnement, qui permettent à ce dernier d’ajuster son comportement en fonction de l’analyse qu’il fait des effets de son action. L’invention de machines possédant une autonomie suffisante pour analyser des informations en provenance du monde extérieur et pour prendre en permanence des décisions a montré que la rétroaction était non seulement l’apanage des êtres vivants mais, plus généralement, la source de tout comportement intelligent et organisé. Les machines aujourd’hui disposent de capacités cognitives et sociales de plus en plus comparables à celles de l’homme : elles sont capables de manifester le comportement adaptatif et la faculté d’acquisition des connaissances que le système nerveux prend en charge chez les être vivants[4]. L’idée, déjà ancienne, d’une équivalence entre l’homme et la machine a ainsi trouvé de nouveaux arguments. C’est en invoquant le principe de rétroaction que Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, la postule à son tour[5].
Lorsque la machine devient capable, non seulement de régulation, mais aussi de rétroaction, alors elle commence à s’apparenter au cerveau humain. La rétroaction est la fonction par laquelle une machine peut prendre en compte le résultat de son action passée pour y adapter ses actions futures. Elle suppose un principe d’apprentissage continu, basé sur les échanges d’information entre un système et son environnement, qui permettent à ce dernier d’ajuster son comportement en fonction de l’analyse qu’il fait des effets de son action. L’invention de machines possédant une autonomie suffisante pour analyser des informations en provenance du monde extérieur et pour prendre en permanence des décisions a montré que la rétroaction était non seulement l’apanage des êtres vivants mais, plus généralement, la source de tout comportement intelligent et organisé. Les machines aujourd’hui disposent de capacités cognitives et sociales de plus en plus comparables à celles de l’homme : elles sont capables de manifester le comportement adaptatif et la faculté d’acquisition des connaissances que le système nerveux prend en charge chez les être vivants[4]. L’idée, déjà ancienne, d’une équivalence entre l’homme et la machine a ainsi trouvé de nouveaux arguments. C’est en invoquant le principe de rétroaction que Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, la postule à son tour[5].
Or Wiener a consacré plusieurs textes à des ordinateurs, réels et imaginaires, jouant aux échecs. Dans l’étude qu’il publie ici, Pierre Cassou-Noguès confronte ses conceptions avec celles d’Edgar Poe dans « Le joueur d’échecs de Maelzel » et dans d’autres textes mettant en jeu des machines susceptibles d’imiter  l’humain. Il montre que la machine de Poe se situe à mi-chemin entre la machine cartésienne – simple automate conçu sur le modèle de l’horloge et destiné à imiter nos mouvements corporels – et la machine cybernétique, qui est un ordinateur ou une machine à calculer capable de rétroaction et donc susceptible d’imiter la pensée humaine. L’originalité de Poe réside dans l’idée d’un automate conçu comme machine à calculer et non comme simple horloge. Mais cette machine est aveugle : obéissant à un strict déterminisme, elle est incapable d’apprendre car elle est sans rétroaction.
l’humain. Il montre que la machine de Poe se situe à mi-chemin entre la machine cartésienne – simple automate conçu sur le modèle de l’horloge et destiné à imiter nos mouvements corporels – et la machine cybernétique, qui est un ordinateur ou une machine à calculer capable de rétroaction et donc susceptible d’imiter la pensée humaine. L’originalité de Poe réside dans l’idée d’un automate conçu comme machine à calculer et non comme simple horloge. Mais cette machine est aveugle : obéissant à un strict déterminisme, elle est incapable d’apprendre car elle est sans rétroaction.
Sydney Lévy s’intéresse à son tour aux récits de Poe, mais sous un angle légèrement différent, partant de la distinction établie par l’auteur américain entre calcul et analyse (pensée) pour distinguer l’humain de la machine. Profondément conscient de la nature algorithmique de tout calcul, Poe récuse l’idée que l’esprit serait susceptible de mécanisation : si les machines sont capables de calcul, la pensée reste le propre de l’homme. Et la pensée pour Poe, c’est la double faculté d’analyse et d’imagination : non pas un cheminement pas-à-pas relevant d’une procédure algorithmique, mais un phénomène émergent résultant d’interactions nombreuses. En déplaçant le point de vue de l’extérieur vers l’intérieur de la machine, les récits de Poe montrent qu’il ne faut pas confondre la pensée avec l’apparence de la pensée et pointent ainsi par avance les apories de la machine de Turing.
Cette dernière est au cœur de l’étude de Thomas Vercruysse sur Paul Valéry, dont il confronte le premier formalisme aux travaux fondateurs de Hilbert, qui ont imprégné toute l’époque et laissé leur trace dans le projet valéryien d’une mathématique de l’esprit. La question qu’il pose dans son étude est de savoir si les machines de Turing – qui dérivent du formalisme hilbertien – ne fourniraient pas un point de comparaison adéquat pour aborder la machine autopoïétique rêvée par Valéry. En effet, si l’on accepte l’idée qu’un « système formel n’est qu’une liste d’instructions pour une machine de Turing », alors le Système qui fournit son horizon au premier formalisme de Valéry pourrait être vu comme représentation fonctionnelle d’un cerveau conçu comme une machine de Turing. Valéry, toutefois, a rapidement pris ses distances avec le paradigme mathématique et renoncé à la formalisation pour s’intéresser à la thermodynamique qui lui offrait un autre modèle du cerveau : celui d’une machine énergétique fonctionnant par « cycles fermés ».
Avec Hervé-Pierre Lambert, on quitte le domaine des simples analogies entre l’homme et la machine pour aborder le devenir-machine de l’homme dans la fiction. Son étude porte sur Maurice Dantec, représentant de l’un des grands courants de l’imaginaire contemporain, le post-humain, qui explore les conséquences possibles pour l’espèce humaine de la convergence entre biotechnologies, intelligence artificielle et nanotechnologies. Cette convergence a créé les conditions d’une « néo-évolution », déterminée non plus par les lois naturelles mais par les sciences et les techniques qui pourraient concurrencer les mécanismes de l’évolution biologique et conduire à une artificialisation du vivant, à la dénaturalisation de l’homme. L’idée d’un homme-machine n’est pas neuve, elle a de nombreux antécédents littéraires comme en témoigne la large exploitation du thème dans la fiction[6]. L’imaginaire post-humain – ou méta-humain, comme préfère le dire Dantec – s’inscrit dans cette continuité, oscillant entre une tendance catastrophiste et une tendance prophétique qui se sont répandues dans le discours philosophique mais aussi dans la littérature et les arts plastiques. Dans l’œuvre de Dantec, cet imaginaire se construit à travers un « bricolage épistémique » qui, outre les références aux techno-mythes du cyberpunk, opère un croisement entre les thèses de Gilles Deleuze et celles de Jeremy Narby sur l’ADN et le chamanisme. Dantec emprunte à l’anthropologue la théorie des biophotons, l’un de ces savoirs hétérodoxes qui lui sont chers et selon lequel l’ADN émettrait une information génétique sur sa propre structure, savoir auquel les chamanes auraient accès par le biais de plantes hallucinogènes. Se réappropriant cette thèse, Dantec imagine dans Babyon Babies une « neuroconnexion » entre le cerveau et une intelligence artificielle appelée la neuromatrice, qui signale l’émergence du premier phénomène posthumain.
Si la machine est inextricablement liée à la définition de l’humain, c’est qu’elle imite ou supplée des facultés qui sont censées être le propre de l’homme : l’intelligence, la pensée, la mémoire. C’est à cette dernière faculté que s’intéresse
C’est à un autre dispositif textuel que s’intéresse
La photographie, matrice originelle des médias actuels, s’insère aujourd’hui dans des dispositifs plus complexes, qui combinent texte et image sur des supports multimédias. L’étude d’Arnaud Régnaud (à venir) est consacrée à l’analyse de deux cyberfictions de Shelley Jackson, Patchwork Girl (1995) et My Body & A Wunderkammer (1997), qui articulent de manière originale les rapports corps/esprit/écriture. Dans la lignée de Donna Haraway et de son célèbre manifeste cyborg, Shelley Jackson revendique une forme de cybermatérialisme qui évacue toute composante métaphysique ou mystique de la définition de l’intelligence humaine et qui déstabilise par là-même la dichotomie corps/esprit. Elle envisage les cellules du corps humain comme une intelligence collective de type machinique, dépourvue de conscience de soi et travaillant à la régulation d’un système homéostatique qui détrône la prééminence cartésienne du cerveau. Les processus cognitifs ne sont plus cantonnés aux frontières de l’épiderme mais se prolongent jusque dans son environnement, ce qui brouille les frontières traditionnelles du sujet perçu comme une entité close et autonome. Dès lors, la capacité d’agir ne dépend plus d’un cerveau comparable à une tour de contrôle mais devient une fonction distribuée entre divers actants, dans un processus qui implique la coopération de l’humain avec le non humain. Ne pourrait-on y voir, comme le suggère Arnaud Régnaud, une mise en abyme de la lecture interfacée qu’impose toute littérature électronique ?
[1] Je remercie
[2] Cette définition est aussi celle que donne l’Encyclopédie Universalis : « En tant que réalité technique, la machine est une construction artificielle qui consiste en « un assemblage de parties déformables avec restauration périodique des mêmes rapports entre les parties » (G. Canguilhem, La Connaissance de la vie) ; elle a pour fonction de transformer de l’énergie provenant d’une source naturelle (eau, vent, vapeur, électricité, pétrole, atome, soleil) et d’utiliser cette transformation. In Encyclopédie Universalis, http://www.universalis.fr/encyclopedie/machine/. Consulté le 22 mars 2010.
[3] In Encyclopédie Universalis. Consulté le 22 mars sur : http://www.universalis.fr/encyclopedie/machine
[5]
[6] Voir notamment sur la question l’ouvrage de Philippe Breton, A l’image de l’homme, du golem aux créatures artificielles, Paris, Seuil, 1995.
Laurence Dahan-Gaida est professeur de littérature comparée à l’université de Franche-Comté. Elle dirige depuis 2009 le Centre de Recherches Interdisciplinaires et Transculturelles (C.R.I.T.), qu’elle a refondé la même année à l’Université de Franche-Comté. Elle est également directrice du portail Epistemocritique.org ainsi que codirectrice de la revue en ligne du même nom, consacrée à l’étude des relations entre savoirs et littérature. Elle est l’auteur de deux ouvrages d’épistémocritique (Musil. Savoir et fiction, PUV, 1994 ; Le savoir et le secret. Poétique de la science chez Botho Strauss, PUS, 2008) ainsi que de nombreux articles sur les rapports science/littérature. Deux nouveaux ouvrages sont en cours d’impression, l’un dans le domaine de la diagrammatologie (Poétiques du diagramme : arbres, trames, conques, PUV, 2022) et l’autre dans le domaine de la cartographie narrative (Cartes, diagrammes & littérature, PUV, 2022). Elle a également dirigé plusieurs ouvrages collectifs sur les rapports entre sciences et littérature : Eurêka. Invention et découverte dans les récits savants, Hermann, 2022 ; Conversations entre la littérature, les arts et les sciences, 2006 ; Dynamiques de la mémoire : arts, savoirs, histoire, 2009 ; Temps, rythmes, mesures. Figures du temps dans les sciences et les arts, Paris, 2012 ; Circulation des savoirs et reconfiguration des idées. Perspectives croisées : France-Brésil, 2015 ; Penser le vivant (en collaboration avec G. Seginger, L. Talairach, Ch. Maillard).



