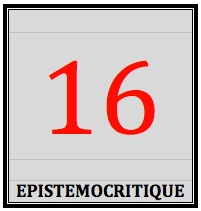Ce 16e numéro de la revue Épistémocritique est né dans le dessein de rendre un peu plus visibles les diverses lignes de recherche portant sur «la littérature et les savoirs» que l’on poursuit depuis ces dernières années en Espagne. Expression d’un engouement grandissant pour ces questions, aussi bien du côté des sciences que des humanités, Vers une épistémocritique hispanique est un ouvrage collectif réalisé dans le cadre du Projet de recherche ILICIA. Inscriptions littéraires de la science. Langage, science et épistémologie. FFI2014-53165-P du Ministère de l’Économie et de la Compétitivité d’Espagne.
Éblouissante, la lumière du jour pénètre par la baie vitrée, inondant la table du laboratoire où abondent fioles, tubes à essai et pipettes. Accoudé à une extrémité, assis sur un tabouret, un homme d’environ vingt-cinq ans – costume impeccable et nœud papillon, cheveux gominés vers l’arrière – regarde avec concentration dans un microscope. Sur le rebord de la fenêtre, on aperçoit un autre de ces instruments, à l’écart pour l’instant. Peut-être le jeune homme découvre-t-il toute la beauté qu’un échantillon de tissu ou d’organe peut renfermer, car ce n’est pas un scientifique, ni même un laborantin. L’absence de blouse le trahit. C’est un poète, un des plus universels qu’aient jamais compté les lettres hispaniques ; c’est Federico García Lorca, photographié au laboratoire d’histologie Pío del Río Hortega de la Résidence d’étudiants de Madrid où il avait été admis en 1919.
Il s’agit-là d’une image emblématique d’une rencontre fertile entre les sciences et les arts, rencontre qui, comme en tant d’autres occasions dans l’histoire de l’Espagne, n’allait pas tarder à faire long feu. Depuis sa fondation en 1910, la résidence madrilène était devenue le principal foyer culturel de la péninsule ibérique et, comme le souligne Esteban García-Albea, « une des institutions les plus vivaces et fécondes de création et d’échange scientifique de l’Europe d’entre-deux-guerres », qui se proposait « de compléter l’enseignement universitaire par le dialogue permanent entre les sciences et les arts, et de devenir un pôle d’accueil pour les avant-gardes internationales » (114). Il en fut ainsi puisque ses forums de débat reçurent d’éminentes figures comme Albert Einstein et Paul Valéry, Marie Curie et Igor Stravinsky, John Maynard Keynes et Le Corbusier. Et certains des étudiants qui assistèrent à ces débats allaient d’ailleurs devenir avec les années aussi illustres qu’eux : Luis Buñuel, Salvador Dalí, Federico García Lorca.
Cet esprit de dialogue entre les deux rives de la connaissance porta sans nul doute ses fruits. L’œuvre de Lorca ne manque pas d’allusions à la science : dans les Suites déjà, composées entre 1920 et 1923, et plus précisément dans des poèmes comme « La forêt des horloges » ou dans « Méditation première et dernière », il fait allusion à la théorie de la relativité d’Einstein, de la même manière qu’avec « Newton », dans le sillage de Wordsworth, mais sur un ton plus détendu, voire satyrique, il relate la découverte de la gravitation universelle grâce à la dernière pomme « qui pendait de l’arbre de la Science », « bolides des vérités » qui en tombant percute le nez du grand physicien (202-203). Le fait est que, sans pour autant mettre en doute la validité de la science, le poète de Grenade en abhorrait l’empire moderne et déshumanisé, l’emprise qu’exerçait une raison mathématique muée en nouveau dogme de foi. C’est pourquoi, quelques années plus tard, dans Poète à New York (1929-1930), et plus précisément dans « L’Aurore », il condamnerait un monde dans lequel « La lumière est ensevelie sous les chaînes et les bruits / en un défi impudique de science sans racines « (488). Ratio et vie, racines carrées et racines végétales : le vieil arbre de la science devait recouvrer ses racines vives pour cesser de sécher sous le poids des longues chaînes des raisons cartésiennes. Alors seulement, comme l’avait écrit Lorca ailleurs dans son recueil, en attendant « sous l’ombre végétale » du Roi de Harlem, on pourrait mettre « des couples de microscopes dans les grottes des écureuils » (473-474).
En 1911 Pío Baroja avait déjà brossé un portrait pessimiste qui allait être longtemps le paradigme de l’échec de la science et de la culture de la fin du xixe siècle. Dans L’arbre de la science, le héros, Andrés Hurtado, cherche en vain la formule de la vie et, ayant compris qu’il ne trouverait pas l’expression mathématique des fonctions vitales, aspire à travailler dans un laboratoire de physiologie, chose impossible, comme le lui fait savoir son oncle, car cela n’existe alors pas en Espagne (122). Heureusement, à la publication du roman, la situation des sciences expérimentales s’était un peu améliorée. Après le désastre de 98, la science était devenue une proposition réformiste de la société espagnole : avec l’élan du prix Nobel de Médecine décerné à Ramón y Cajal en 1906 et sous l’égide d’institutions telles que la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (Assemblée pour l’extension des études et des recherches scientifiques), durant les premières décennies du xxe siècle, les hommes de science purent bénéficier de laboratoires où réaliser leurs expériences. Mais le soulèvement militaire de 1936 mit un terme à ce progrès naissant, à cette « cajalisation » de la science espagnole : Pío del Río Hortega, parmi bien d’autres, dut fermer le laboratoire de la Résidence d’étudiants et déménager ses essais, tout d’abord en zone républicaine, à Valence, puis à Oxford. Le jeune poète qui regardait avec tant de curiosité dans son microscope fut assassiné par le régime franquiste la même année. Exil et mort. Les sciences et les lettres s’unissaient dans le malheur et, une fois encore, se voyaient freinées dans leur évolution.
Quand on observe avec suffisamment d’attention l’évolution de la science espagnole, on voit bien qu’un de ses signes d’identité principaux est la discontinuité. López-Ocón Cabrera l’affirme ainsi dans son indispensable Breve historia de la ciencia española ; pour cet érudit, l’activité scientifique des cinq siècles derniers pourrait être comparée au « tissage/détissage de Pénélope dans l’attente du retour de son cher Ulysse » ou, mieux encore, aux eaux du Guadiana qui coulent librement, puis « se cachent sous terre pour émerger de nouveau, impétueuses, dans leur course finale » ; en effet, dans ces terres espagnoles, la science a été variable, « oscillant entre son caractère secret et public, entre son manque de pertinence et son impact social, entre sa position marginale ou ses succès dans la science-monde, c’est-à-dire au sein du système mondial de production et de distribution des connaissances scientifiques » (12). Cette « guadianisation » de la science espagnole est à rattacher à la lamentable et dramatique tendance, imputable à des facteurs historiques, sociaux et économiques, à aller à contrecourant des mouvements de modernisation des autres pays. Le cas le plus représentatif et avéré à cet égard est sans doute le fait qu’il ne se soit pas produit en Espagne de révolution scientifique comme dans le reste de l’Europe durant le xviie siècle, un phénomène servi en grande mesure par le déclin de la culture des sciences et coïncidant avec la décadence manifeste de la monarchie espagnole pendant cette période (24). La dictature franquiste à laquelle la guerre civile ouvrit la voie est un autre de ces pathétiques points morts ; en effet, dans ses apparentes eaux calmes, le Régime étouffa tout espoir de modernisation et, avec l’exil des scientifiques républicains et le démantèlement du système de recherche, fit reculer la science espagnole de plusieurs décennies.
Retour à la case départ, comme si le temps était pris au piège d’un éternel recommencement. À première vue, il pourrait sembler qu’il s’agit de la même scène, mais il y a longtemps que Lorca est mort et, de plus, tout est baigné dans une lumière bien plus sombre. Un jeune homme regarde également dans un microscope, avec concentration certes, mais aussi une évidente contrariété. Ce n’est pas un poète, c’est un médecin, un chercheur qui prétend, illusion don-quichottesque, étudier les mécanismes de transmission du cancer inguinal dans un laboratoire espagnol à la fin des années quarante. C’est le protagoniste de l’un des plus grands et des plus influents romans de l’histoire de la littérature espagnole, mais aussi l’un des plus méconnus hors de nos frontières. C’est le docteur Pedro Martín de Les demeures du silence. Son irritation initiale, juste au début du roman, n’est pas due uniquement à l’insistance de la sonnerie du téléphone et à la coupure de courant qui l’empêche de poursuivre son observation à travers la lentille ; ce qui brise net son élan, c’est la nouvelle que lui annonce le garçon de laboratoire, Amador, fidèle écuyer qui le suivra dans ses péripéties : le stock de souris d’Illinois dont il se sert pour ses expériences est épuisé. Il lui vient alors à l’esprit la figure de Ramón y Cajal, image emblématique du saint patron de la science espagnole, mais aussi, tel qu’on le surnomma, le « Quichotte de la science » :
Terminées les souris ! Finies que je vous dis. En face de moi, le portrait de l’homme à la barbe, qui a tout vu, qui a délivré le peuple ibérique de son complexe d’infériorité devant la science, préside immobile et le regard scrutateur à l’extinction des cobayes. Son sourire compréhensif et libérateur explique le manque de crédits. Un peuple pauvre, c’est ça, nous sommes un peuple pauvre. Car nous sommes aussi un peuple inférieur… Qui pourra jamais aspirer, une nouvelle fois, à la récompense venue du nord, au sourire du roi géant, à la consécration officielle et à la situation enviable du savant qui attend que les cerveaux fassent fructifier la péninsule aride ? Les mitoses anormales demeurent coagulées dans leurs petits cristaux immobiles – elles qui sont le mouvement même –. Amador, sans bouger, repose le téléphone, et me sourit avant de dire : « C’est fini ! ». (7)
Le roman de Luis Martín-Santos, publié en 1962, est une tragédie qui affecte aussi bien son héros que la ville et la nation auxquelles il appartient, et comme telle, se déroule avec une précision mathématique, tout découlant fatalement de ce début, de cette pénurie qui contraindra le nouveau chevalier de la science et son laborantin à partir en quête de souris dans un bidonville, loin de leur univers habituel. Tout cela par manque de crédit, faute d’avoir les moyens de mener leur recherche, forcés en outre d’observer à travers un simple microscope, « en l’absence d’appareil électronique » (9). D’emblée, Les demeures du silence se présente comme une critique acerbe de l’état lamentable de la science, de la culture et de la société espagnoles de l’époque, mais il est bien davantage. On pouvait déjà lire une réprobation similaire dans L’arbre de la science, roman auquel Martín-Santos doit une bonne part de l’atmosphère générale de sa narration, comme s’il eut voulu signifier que la situation avait bien peu changé en un demi-siècle. Pourtant, tandis que Baroja parlait sur la science dans de longues conversations formulées dans un langage assez conventionnel, Martín-Santos laisse la langue s’imprégner du discours scientifique et invente un style unique qui, dans sa variété, vise à nous immuniser contre le langage trivial dominant, à la manière des mécanismes que son personnage s’efforcera en vain de découvrir avec son microscope.
Dès la parution, la singularité de la langue de Les demeures du silence a suscité surprise et perplexité, à la manière d’une bombe au beau milieu d’un paysage littéraire plombé et uniforme. Des années durant, la critique a souligné la nature baroque et hétérogène de son style, voire son inadéquation à l’atmosphère lamentable dépeinte par Luis Martín-Santos, attribuée dans le meilleur des cas à une vision ironique. En réalité, peu de romans de ce genre sont parvenus avec une telle acuité à ajuster et acclimater le langage à son objet. Les demeures du silence est un roman sur les péripéties d’un chercheur dans la première décennie de la Dictature, sur un médecin qui entend vérifier, dans son laboratoire indigent, si le cancer est transmis par les gènes ou s’il peut l’être par contagion moyennant un virus. Cependant, en accord avec sa trame, c’est également en bonne logique un roman de recherche sur et avec le langage, sur les possibilités de combattre les maux des mots avec des mots.
« Prolixe par essence », écrit Cioran dans Syllogismes de l’amertume, « la littérature vit de la pléthore des vocables, du cancer du mot » (25). Nul autre roman que Les demeures du silence n’a sans doute incarné cette vérité avec autant d’intensité et d’exactitude. Métaphore récurrente dans ce roman, le cancer n’exprime pas seulement les maux de la société, mais encore la nature de leur écriture. C’est ce que suggère le protagoniste lorsque, après avoir médité à propos de Cervantès au cours d’une promenade, au moment de pénétrer dans un café littéraire, il pense qu’il aurait préféré continuer « d’évoquer des fantômes d’hommes qui déversèrent leurs propres cancers sur des feuilles blanches » (76). Dans Les demeures du silence, Luis Martín-Santos fait plus que déverser son âme endolorie, il transforme aussi son œuvre en un laboratoire où étudier et combattre le langage cancéreux, trivial et répétitif, en lui inoculant des paroles immunisantes. À cet égard, Guillermo Cabrera Infante touche juste quand il dit qu’en raison de son innovation linguistique Les demeures du silence « en finit avec la tradition réaliste espagnole qui a été propagée, comme une infection, par les mauvais lecteurs de Cervantès presque depuis la publication du Don Quichotte » (cité dans Lázaro, 243). Pour un écrivain, il n’est pas d’autre combat que celui du langage, de la même façon que le protagoniste ne s’intéresse à nul « autre combat que ceux des virus avec les anticorps » (Martín-Santos, 45). Les technicismes (scientifiques, médicaux, juridiques, etc.) que Martin-Santos ne cesse d’inoculer à ses phrases agissent comme un vaccin contre le langage maladif et destructeur qui proliférait dans la littérature la plus conventionnelle et réaliste de l’époque. Chacun de ces mots est un antigène introduit dans le discours dans le but de le faire réagir en créant ses propres défenses. L’écriture ne peut donc qu’apparaître hors de contrôle et anormale, virale en elle-même, puisqu’elle adopte les processus de reproduction de la maladie dont elle parle.
Dès les premières lignes, où le lecteur peut se voir comme dans un miroir, nous sommes invités à observer le texte, sorte de tissu vivant où les mots se reproduisent à la manière de cellules :
Le téléphone a sonné et j’ai entendu la sonnerie. J’ai décroché l’appareil. Je n’ai pas bien saisi. J’ai posé le téléphone. J’ai dit: «Amador.» Il est arrivé avec ses grosses lèvres et il a pris le téléphone. Moi je regardais à travers le binoculaire et la préparation n’avait pas l’air de pouvoir être comprise. J’ai regardé à nouveau: «Bien sûr, cancéreuse.» Mais, après la mitose, la tache bleue se résorbait petit à petit. (Nous traduisons ce passage afin de rendre l’effet original)
Double du héros, faute d’un meilleur microscope, le lecteur ne semble pas à même de comprendre non plus la préparation verbale qu’il a sous les yeux. Ce texte est effectivement déconcertant, instable, comme se déroulant par répétition à mesure qu’on le lit, comme si chaque mot se divisait à l’instar d’une cellule pour produire de nouveaux mots : téléphone, sonnerie, appareil / sonnait, entendu, sonnerie, compris, dit, etc. Et cette mitose verbale va se produire non seulement par des procédés sémantiques, mais encore grâce à d’autres moyens comme l’allitération : selon Amador, c’est une chance que les filles de son ami Latrogne (El Muelas, dans l’original) s’occupent des souris qu’ils ont dérobées : « Au fond, c’est plutôt un bien sans ça il faudrait arrêter [parar]. Ce sont ses filles qui s’en occupent. Si c’était pas ça elles auraient déjà crevé au lieu de mettre bas [parir] comme elles font [paren], car pour ce qui est de mettre bas [paren], elles en mettent un coup [sin parar] ces salopes. ». La reproduction biologique se reproduisant dans une reproduction verbale. Un jeu parmi tant d’autres qui réclament depuis des années une étude complète, détaillée, une recherche sur la science dans l’œuvre de Luis Martín-Santos, une approche épistémologique capable de jeter une lumière neuve sur cette œuvre cruciale de la littérature espagnole, ce roman n’ayant toujours pas, à ce jour, reçu l’attention qu’il mérite, comme si l’ensemble du contenu scientifique en était un point aveugle, invisible au-delà de son rôle de métaphore des maux sociaux[1].
En raison de sa valeur littéraire et de la place principale qu’il occupe dans les lettres espagnoles, Les demeures du silence peut être tenu pour un exemple paradigmatique du peu d’intérêt accordé à la science dans les études littéraires menées de ce côté-ci des Pyrénées, au moins jusqu’à récemment. Toute œuvre est lue et interprétée dans un cadre épistémologique concret, duquel la science semble être absente depuis fort longtemps, essentiellement parce qu’en Espagne, comme nous l’avons dit, celle-ci n’a pas toujours eu l’importance et l’impact qu’on aurait pu espérer et qu’elle avait dans des pays voisins. Le retard souffert par les mathématiques (et en définitive par les sciences) au long du xixe siècle est à cet égard manifeste ; comme l’a montré Javier Peralta, dans le splendide panorama mathématique du xixe siècle « rien ou presque ne peut être recensé qui soit de paternité espagnole » (57). Ce qui du reste n’a rien d’étonnant à la lumière de ce que José Cadalso avait dénoncé dans ses Cartas marruecas (Lettres marocaines) à la fin du siècle précédent, s’étant vu dans l’obligation de prendre la défense des mathématiques face au savant scolastique qui les confondait encore avec l’astrologie et les méprisait : « Malheur à toi si tu lui parles de mathématiques. Mensonge et passe-temps – dira-t-il avec gravité » (192). Avec un tel fardeau, avec un enseignement universitaire qui ignorait que « les mathématiques sont et ont toujours été tenues pour un ensemble de connaissances qui forment la seule science digne de ce nom parmi les hommes » (Cadalso, 193), le xixe siècle espagnol avait peu de chances de briller dans le monde scientifique, et, par conséquent, les écrivains pouvaient difficilement s’intéresser à ces questions et les intégrer dans leurs œuvres.
Une des métaphores qui reviennent le plus souvent quand on parle des relations entre les sciences pures et les sciences humaines, généralement pour revendiquer la nécessité d’établir des liens plus solides et vrais, est celle du pont restant à tendre entre ces deux domaines du savoir. Vu ainsi, on pourrait penser que chacun d’eux est d’ores et déjà constitué en lui-même et que le pont ne ferait que relier deux espaces autonomes. Il suffit à cet égard de rappeler la fonction que Heidegger attribuait à ce genre de construction : « Léger et puissant, le pont s’élance au-dessus du fleuve. Il ne relie pas seulement deux rives existantes. C’est le passage du pont qui seul fait ressortir les rives comme rives. » (27). De même, les deux domaines essentiels du savoir connus comme les sciences et les humanités ne prennent vraiment corps qu’une fois qu’ils ont emprunté le pont dans l’une et l’autre direction. C’est pourquoi, au long du xxe siècle, dès l’apparition des premiers indices de dégradation, une polémique éclata autour des deux cultures dans des pays comme la France et le Royaume-Uni, nombre de scientifiques et de penseurs tels qu’Henri Poincaré, C. S. Snow ou Aldous Huxley insistant alors sur la nécessité de colmater les fissures qui s’étaient ouvertes dans ce pont épistémologique et menaçaient de le détruire. En Espagne, en revanche, la question était bien différente : le pont, limité à de précaires fondations, restait à construire, et les deux rives n’étaient encore que des friches.
Fort heureusement, la situation s’est substantiellement modifiée depuis et, en dépit de l’éternel manque de crédits pour le développement scientifique (et plus encore humanistique), dramatiquement aggravé par les politiques issues de la crise financière de 2008, les deux rives ressortent aujourd’hui avec force et de très nombreux scientifiques et artistes empruntent le pont dans les deux directions. À preuve les travaux individuels et collectifs qui, ces dix dernières années, ont été et sont menés en Espagne, avec pour objet d’établir des liens entre les sciences et les lettres. Le fait que de nombreux poètes et romanciers comme Clara Janés, Agustín Fernández Mallo, Vicente Luis Mora, Ricardo Gómez, Javier Argüello, Germán Sierra, Javier Moreno ou Alejandro Céspedes aient composé des œuvres où la science est posée comme indissociable de l’écriture a eu un impact décisif sur l’attention que la critique littéraire prête désormais aux inscriptions scientifiques dans les lettres. Du reste, certains de ces créateurs ont théorisé autour de leur propre activité, revendiquant une véritable convergence des langages, comme Fernández Mallo dans Postpoesía ou Argüello dans La música del mundo.
En outre, de plus en plus fréquemment, des revues de renom consacrent à la question des monographies ; c’est le cas de Litoral, Quimera, Signa ou Revista de Occidente ; et des volumes collectifs, comme Arte y ciencia: mundos convergentes, dirigé par S. J. Castro et A. Marcos, ou Espectro de la analogía, dirigé par Amelia Gamoneda. Preuve que le thème suscite un intérêt croissant, la récente publication posthume de l’ouvrage de Francisco Fernández Buey Para la tercera cultura. Ensayos sobre ciencias y humanidades, où le philosophe non seulement reconstruit les facettes que la polémique des deux cultures a adoptées dans divers pays, mais encore apporte des exemples significatifs de l’empreinte qu’a pu avoir la science sur certaines œuvres littéraires. Bien des articles figurant dans ces revues et volumes collectifs ont une approche proprement épistémocritique, au sens que Michel Pierssens et Laurence Dahan-Gaida ont accordé à ce terme, et plusieurs essais de cette même veine ont d’ailleurs été publiés, notamment Sinergias de Candelas Gala, Epistemocrítica de Jesús Camarero, Esperando a Gödel: literatura y matemáticas de Francisco González et Del animal poema d’Amelia Gamoneda, ces deux derniers dans le cadre de l’équipe de recherche ILICIA, la première en Espagne à s’être axée sur la relation entre science et littérature (www.ilicia.es).
Le présent volume d’études, organisé sous forme de monographie et intitulé Vers une épistémocritique hispanique, a lui aussi été réalisé au sein du G. I. R. ILICIA. Les divers textes rassemblés ici sont agencés selon des tendances réflexives qui font des particularités que l’on vient d’évoquer, et qui sont un héritage de la culture espagnole, un trait spécifique pour aborder la présence et la circulation des savoirs au sein du texte littéraire.
Pour en rendre compte, il faut revenir au fameux espace de la Résidence d’Étudiants. Sur la photo, cette fois-ci, pas de microscope : José Ortega y Gasset se trouve dans les jardins, en train de lire un journal annonçant que la Première Guerre mondiale vient d’éclater. Le philosophe le plus remarquable de l’histoire espagnole se rendait quotidiennement à la Résidence, dont il était membre du comité de direction, et ce carrefour des arts, des sciences et de la pensée nourrit son œuvre, la seule de la sphère philosophique espagnole à avoir, avant le xxie siècle, franchi les frontières physiques et temporelles : si, à son époque, Ortega a pu représenter à lui seul la philosophie espagnole ayant un rayonnement européen, il est dans l’Espagne actuelle l’unique philosophe du passé faisant encore figure de référence pour une culture qui, après le désert laissé par le franquisme et l’après-guerre, affiche résolument et sans complexe son postmodernisme. De plus, par l’ampleur et la variété de sa réflexion, Ortega est également une référence pour les études qui, en Espagne, tentent de concilier des perspectives humanistes et scientifiques. Ces études reçoivent pour ainsi dire le parrainage symbolique de celui qui, dans son œuvre, écrivit sur le lien entre raison, nature et technologie, ou encore affirma que « la science est beaucoup plus proche de la poésie que de la réalité [car] comparativement à la réalité authentique, on constate ce qu’elle peut avoir de romanesque, de fantaisie, de construction mentale, d’édifice imaginaire. […] la mathématique jaillit de la même source que la poésie » (31). Indubitablement respectueux de la science, Ortega y Gasset visait une matrice créative commune à cette dernière et à l’art, ce qui ne passa nullement inaperçu de sa disciple María Zambrano, la philosophe à qui l’on doit la notion de « raison poétique ». À mi-chemin entre philosophie et métaphore, cette notion – l’une des plus souvent invoquées par les poètes de la seconde moitié du xxe siècle espagnol –, est à l’évidence également liée à une conception de la cognition (embodied cognition), aujourd’hui défendue par les sciences cognitives, qui jette un pont entre les domaines de la créativité et ceux de l’expérience vécue. Ce faisant, Ortega et Zambrano se situent dans un domaine philosophique qui conçoit que créativité littéraire et créativité scientifique puissent se rejoindre dans ses processus de pensée. La grande influence qu’exercent ces deux auteurs en matière philosophique et poétique explique le parti pris dont sont imprégnées les études espagnoles qui, jusqu’ici, ont approché la science dans le domaine littéraire : un parti pris franchement philosophique, exceptionnellement épistémologique et, occasionnellement, épistémocritique.
Les contributions rassemblées dans cette nouvelle livraison de la revue sont à cet égard une tentative de modifier une telle tendance, en intensifiant les partis pris épistémologiques et épistémocritiques. Pourtant, comme on l’observera, il y a moins rupture avec la tradition culturelle espagnole qu’évolution, une évolution nuancée qui laisse encore toute sa place à la philosophie. On ne s’étonnera donc pas que la plupart de ces textes s’articulent autour de la critique philosophique et épistémologique du représentationnalisme, et que la philosophie, la théorie de l’esthétique et la théorie de la littérature soient convoquées aux côtés de la science pour participer au conclave des savoirs au sein de la pratique épistémocritique. C’est le cas du texte signé par Benito García-Valero, qui porte pour titre « Création ou représentation ? Mimesis au carrefour entre science, pensée orientale et théorie occidentale », dont l’hypothèse est la suivante : la conception traditionnelle orientale de la mimesis s’apparente à certaines interprétations de la physique quantique et certaines postures épistémologiques issues du poststructuralisme. La conception – due à Ricœur – de la mimesis en tant que processus créatif et non de représentation est en correspondance avec les pratiques de la peinture japonaise et son désintérêt pour la copie fidèle, mais surtout rejoint le bouddhisme, dont un des postulats est que l’esprit attribue un statut fictionnel à la réalité. Que le monde soit issu de l’esprit, voilà une formulation générale que partage aussi le poststructuralisme dans le sillage de Foucault, mais face à ce dernier, qui sépare définitivement mots et choses, le bouddhisme lamaïste et la physique quantique postulent une intervention de l’esprit dans l’établissement du réel. García-Valero recourt également au concept de réalisme agentiel, proposé par la physicienne et épistémologue féministe Karen Barad, en vertu duquel il n’y a pas de référent mais un phénomène – ce qui se présente comme effet d’une action –, permettant de faire une distinction semblable à celle que faisait Heisenberg entre le réel et l’actuel. Ainsi donc, du point de vue de la science, de la philosophie de Ricœur, du bouddhisme et du réalisme agentiel, il s’avère que l’art, la littérature et la connaissance du réel renouent avec l’idée (aristotélicienne) de la mimesis comme création, comme poïesis. Et cette compréhension se vérifie également dans le monde naturel – où la création acquiert les mêmes traits poïétiques –, de telle sorte que les frontières s’estompent entre l’art et la nature. La littérature, qui crée elle aussi sa réalité par le biais de processus cognitifs spécifiques, participe à cet effacement des limites.
On retrouve la même perspective anti-platonicienne, associée à la critique de la représentation mimétique, dans l’analyse proposée par l’article Candela Salgado Ivanich, « Qu’est-ce qu’un événement ? La connaissance poétique et anti-platonicienne de Chantal Maillard ». Cet article traite du recueil de Chantal Maillard intitulé, précisément, Matar a Platón (« Tuer Platon ») dont les poèmes soumettent à examen un événement – un accident de voiture ayant entraîné un décès – auquel assiste un groupe de personnes. Chantal Maillard, poète et philosophe ayant une connaissance approfondie de la pensée bouddhiste, procède dans ce recueil à des constructions successives de réalité opérées par ces spectateurs de l’événement ; un événement qui n’a d’autre réalité que celle du phénomène (et non celle du référent, pour utiliser les termes de Barad). Candela Salgado Ivanich inscrit son analyse dans le cadre des théories connexionniste et énactive proposées par le biologiste, cognitiviste et neurologue Francisco Varela. Lui-même influencé par la pensée bouddhiste, Varela conçoit le monde comme énacté par la propre connaissance du sujet, et sa théorie – antérieure dans le temps – peut être rapprochée de la notion d’acte qui est supposée par le réalisme agentiel de la philosophe. Au surplus, l’approche connexionniste de la cognition que défend Varela se démarque de la conception symbolique et jette les fondements d’une embodied cognition (cognition incarnée). Candela Salgado Ivanich procède à une analyse des poèmes mettant à contribution la perception et d’autres instruments relatifs à ce type de cognition pour aboutir à une approche de la poésie répondant à la forme d’une connaissance formulée comme poïesis.
La notion d’« événement », telle qu’elle vient d’être évoquée et la mise en échec de la représentation qu’elle suppose sont abordées à nouveau dans le texte de Javier Moreno intitulé « Le charme discret du continuum : le temps et le récit ». Pour cet auteur, la narration est précisément la manifestation du fait que mots et choses ne se produisent pas simultanément et que le monde ne peut pas être saisi au travers du langage. Moreno voit dans la narration une manipulation temporelle qui ne coïncide pas avec le temps réel (compris intuitivement). Quelque chose qu’avait déjà pointé l’analyse du recueil de Chantal Maillard : la variété d’actes de connaissance des observateurs de l’événement démontre qu’ils ne sont pas concomitants, bien que la connaissance énacte la réalité et y participe en tant qu’agent.
Javier Moreno propose d’envisager les temps de la réalité et ceux de la narration à partir de leur nature respective, continue pour l’une et discrète pour l’autre. Le passage du réel au langage est justement celui du continuum au discret et, dans ce processus, se produisent des désautomatisations de la perception/compréhension du réel, qui sont imposées par le caractère discontinu du langage. Il en résulte ce qu’il appelle « événement narratif », et il s’emploie à « analyser la microphysique perceptive de ce mouvement » au moyen de la notion d’inframince [infraleve] de Leibniz (« un infinitésimal dans un spectre continu » qui percute l’organisme en produisant un acte de langage, un mouvement, un geste). Il rejoint ainsi – sans les mentionner – les perspectives de la cognition incarnée (embodied cognition) pour expliquer le mode par lequel le langage connaît/énacte/crée le monde. Il fait par ailleurs observer qu’Italo Calvino avait lui aussi proposé la légèreté comme vertu cardinale de la littérature à venir, donnant l’exemple d’un poème où le langage se raréfie (Emily Dickinson) ou d’un récit sur des questions subtiles et imperceptibles (comme les tropismes de Nathalie Sarraute) ou encore une description extrêmement abstraite. Il est surprenant de constater que ces notions – l’inframince, le microphysique, la légèrete, l’imperceptible – sont proches de celles que déploient les analyses poétiques présentées par Candela Salgado et Víctor Bermúdez dans leurs textes respectifs. Dans le cas de ce dernier – intitulé « Déclinaisons épistémiques de la métaphore dans Sol absolu de Lorand Gaspar » – ces unités de l’inframince capables d’opérer le mouvement entre le réel-continu et le langage-discontinu adoptent la forme de modèles métaphoriques spécifiques de l’œuvre de Gaspar, où se présentent des qualités ou des lieux du fonctionnement métaphorique pratiquement imperceptibles : « malléabilités », « interstices ».
L’analyse poétique que propose Víctor Bermúdez aborde une œuvre poétique – celle de Gaspar – tout à la fois inscrite dans la tradition de la poésie scientifique et composée dans un registre philosophique ; l’œuvre confère des traits poétiques aussi bien à la science qu’à la philosophie par le biais de structures de pensée stabilisées dans les modèles métaphoriques mentionnés précédemment. Cette métaphorologie se déploie en trois volets : dans « Malléabilités du système citationnel », l’auteur observe les effets littéraires des citations textuelles (porteuses de savoir scientifique) en fonction de la disposition spatiale du poème. Dans « Maillons et interstices de la description », il étudie le mode selon lequel les énoncés littéraux adoptent une valeur métaphorique (Davidson) ; il s’agit fréquemment de descriptions géologiques, botaniques, historiques dont les énoncés scientifiques présentent une charge lyrique sans même déborder de leur interprétation littérale. Le troisième volet expose le mode dans lequel se produit un glissement de l’épistémique à l’esthésique par le jeu d’associations qui mobilisent la subjectivation et concernent le corps et sa sensibilité. Cette métaphorologie décrit donc un mode poïétique orienté par la cognition incarnée (embodied cognition) et qui semble en même temps faire appel aux territoires de l’inframince susceptibles de figurer comme infinitésimaux dans le spectre continu de la réalité.
On pourrait inférer du texte de Victor Bermúdez que la terminologie scientifique de l’œuvre de Gaspar trahit l’impuissance du langage à coïncider avec le continuum du réel, et de là la nécessité pour lui de recourir à la métaphore – métaphore cognitive enracinée dans le corps – pour dissoudre le discret. Toutefois, selon Javier Moreno, c’est le langage mathématique qui, en fin de compte, se charge de prendre la relève de cette « poétique du minuscule », laquelle, dans le texte littéraire, aspire à orienter le discret vers le continu : l’infini dénombrable de Cantor et son hypothèse du continu répondent à la simultanéité du discret et du continu. Si le langage pouvait être aussi un infini dénombrable, la narration et la réalité pourraient alors partager le même temps.
La question de la science comme modèle littéraire est envisagée non seulement dans le domaine de la connaissance du réel à travers le langage mais aussi dans le domaine même des formes, métaphores et processus de création littéraire. Nous abordons ici aux textes qui abandonnent la réflexion d’ordre explicitement cognitif pour pénétrer un territoire plus clairement épistémocritique. L’article signé par Germán Sierra, « Science qui advient comme littérature », fait appel dès son titre à la notion d’« événement », véritable leitmotiv des articles réunis ici ; un terme avec lequel il fait référence aux modes de présentation et d’action de la science au sein de la littérature. Et plus précisément à ces modes d’inscription qui dépassent le simple niveau de l’argument, où l’image scientifique ne se borne pas à remplacer platement un autre type d’images antérieures à l’actuelle culture technoscientifique (modes repérables chez Agustín Fernández Mallo, Janice Lee, Amy Catanzano). Sierra signale que la clé d’une intégration réussie – qui garantit l’intensité esthétique – de la science à la littérature implique que cette dernière continue d’évoluer dans le domaine spéculatif qui lui est propre (un domaine que la science tend justement à supprimer). Pour cela, il élabore une critique de la « science-mythe », un type de science auquel recourt une littérature prétendant au « réalisme scientifique » et qui abandonne toute spéculation constructiviste sur le réel. Quand la littérature cède le terrain à des notions réductionnistes technoscientifiques, la science n’« advient » plus comme littérature ; autrement dit : elle ne fait plus partie du tissu littéraire. L’article définit trois postures spéculatives – et par conséquent esthétiques – parfaitement représentées en Espagne et partagées avec d’autres littératures étrangères. En premier lieu, un nihilisme spéculatif –assorti d’une « esthétique de la fin » – reposant sur une lecture de la science – physique, astronomie – comme négation de l’humanisme et crise absolue de l’anthropocentrisme. En second lieu, un néo-matérialisme qui ne nie pas la fin de l’anthropocentrisme mais admet que nous n’avons accès qu’à la connaissance humaine, la littérature correspondante adoptant donc une « esthétique de laboratoire » intéressée par les modèles de réalité compréhensibles (chez Fernández Mallo, Moreno et Gámez, par exemple). En troisième lieu, la posture du néo-rationalisme/accélérationnisme, convaincu de faciliter la transition de l’humanisme au posthumanisme, et inspiré par les versions fortes de l’IA et par un élan techno-utopique : le récent mouvement littéraire-artistique additiviste en est une illustration.
Privées d’une grande tradition d’ouverture aux sciences, les propositions de la littérature espagnole surprennent par leur radicalité et leur avant-gardisme, ce qui – comme il a été suggéré plus haut – est une caractéristique commune à divers domaines de notre culture, et plus particulièrement au genre de l’essai. Les référents de cette littérature sont à chercher – comme on pouvait s’y attendre – dans le domaine anglo-saxon ; pourtant, comme d’ordinaire dans la culture en langue espagnole, l’influence s’accompagne de traits autochtones très accusés. À cet égard, certaines œuvres dont traite ce numéro révèlent, aux côtés de la science, la présence surprenante de la mystique. Profondément enracinée dans notre culture philosophique et littéraire, la tradition mystique espagnole du xvie siècle – avec pour représentants Saint Jean de la Croix et Thérèse d’Avila – a été intensément revendiquée par la poésie espagnole des dernières années du xxe et du début du xxie. Le cas de la poète et académicienne Clara Janés, à laquelle Antonio Ortega consacre l’étude « L’arc et la flèche : science et poétique dans l’écriture de Clara Janés », est exceptionnellement intéressant en ce qu’il allie l’influence de la mystique occidentale et celle de la tradition orientale à une présence très explicite et marquée de la science. Le lien entre mécanique quantique et poétique, caractéristique de la poésie de Clara Janés est analysé par Antonio Ortega avec, pour toile de fond, la mystique.
La proposition transdisciplinaire de Clara Janés consiste à employer des concepts scientifiques à valeur métaphorique pour désigner des réalités sans nom dans le domaine de la sensibilité ou de l’expérience subjective (catachrèse). Au sein de cette expérience, la mystique occupe une place importante, la poète y trouvant un type de connaissance qui se révèle plus compréhensible à la lumière de la science. Trois aspects fondamentaux de la mystique difficilement descriptibles se voient ainsi associés à des domaines scientifiques : le « hors du temps » est vu au travers la théorie de la relativité ; « l’unicité » au travers de la fonction d’onde ; et le « savoir du non-savoir » au travers du principe d’incertitude. Les deux derniers aspects sont abordés par le texte d’Antonio Ortega qui, en premier lieu, pour expliquer le « savoir du non-savoir » de Jean de la Croix repris par Clara Janés fait appel aussi bien à Maria Zambrano – philosophe de la parole poétique associée à la mystique – qu’au physicien Heisenberg ; tous les deux accompagnent Ortega dans son explication de l’analogie entre le «savoir du non-savoir » et la nature de la matière considérée du point de vue de la physique quantique. En second lieu, Antonio Ortega propose l’idée selon laquelle le fonctionnement essentiellement autoréférentiel du langage poétique – que Clara Janés relie à l’« unicité » de la mystique – trouve un mode de compréhension à travers la fonction d’onde de Schrödinger (où l’observateur s’infiltre dans le système et en actualise une des possibilités).
Clara Janés parle d’une « resacralisation du monde » par le regard scientifique, moyennant laquelle est satisfaite la nostalgie d’absolu et d’unité – derrière la multiplicité visible – qui prévaut également dans la mystique. Ceci est également l’objectif d’une œuvre comme celle d’Ernesto Cardenal, étudiée par Mauricio Cheguhem Riani dans « Ce qui meut le soleil et les autres étoiles. Convergences entre science et mystique dans Cantique cosmique d’Ernesto Cardenal ». Mais en termes de formes d’exécution, le projet de Cardenal est bien éloigné de celui de Clara Janés. Dans la poésie du Nicaraguayen – la distance entre la culture américaine et européenne n’est pas anodine même si toutes deux sont produites en espagnol – le projet est essentiellement philosophique : le texte sur lequel il porte ne vise pas à ce que la science « advienne » en tant que littérature (Germán Sierra), ni ne fonctionne comme une métaphore catachrétique d’expériences subjectives (Antonio Ortega), ni n’aspire à un glissement de l’épistémique vers l’esthésique (Víctor Bermúdez). Cardenal se situe dans l’orbite philosophique de Badiou, et demande à la science de soutenir depuis son propre domaine le concept discrédité de « vérité » que cette philosophie propose. Une vérité engendrée scientifiquement, mais pas seulement ; les vérités, d’après Badiou, traversent quatre « espaces » ou conditions : science (mathème), art (poème), politique et amour. Étant d’accord avec la non-séparation de ces conditions productrices de vérité, Cardenal fonde sa propre position philosophique sur celle de Badiou : la non-séparation entre mystique (qui ferait partie de la « condition » de l’amour) et science.
Cheguhem procède à une analyse de Cantique cosmique – caractérisé génériquement comme une « épique astrophysique » – du point de vue scientifique et, de même que Clara Janés, il mobilise comme instruments l’espace-temps (l’« étreinte courbe », disait Clara Janés), la mécanique quantique (intrication quantique) et le principe d’incertitude, en plus d’un certain nombre de considérations relatives à la seconde loi de la thermodynamique et ce qui en découle. Cependant, si dans le cas de Clara Janés l’aspect scientifique que métaphorisait l’« unicité » mystique était la fonction d’onde, chez Cardenal c’est la Loi de la gravité dans le contexte quantique : l’attraction entre les corps que pose cette loi acquiert dans cette poésie une valeur téléologique. En effet, Cardenal n’oublie pas les autres « conditions » de vérité, bien que la science ait l’aptitude de penser les « principes premiers » (vérités). Cheguhem ne les oublie pas non plus, et son analyse culmine par une approche scientifique de l’idée de Dieu comme mouvement, qui l’amène à résumer ainsi : Dieu est « l’événement de toute chose ». Derrière la variété d’approches qu’offrent les textes de ce numéro monographique, on perçoit donc une manière commune d’envisager tout type de connaissance – épistème scientifique, cognition humaine, union mystique – comme acte de création s’actualisant en « événement ».
Analyser la manière dont la science « advient » comme littérature est un programme épistémocritique. L’avant-dernier texte de cette monographie s’y conforme très précisément, tout en participant par son argumentaire au questionnement commun sur l’« événement », envisagé du point de vue de la critique philosophique, épistémologique et poétique du représentationnalisme. « La parole ignifugée : économie monétaire et antinomies du réalisme dans Argent brûlé, de Ricardo Piglia», texte signé par Borja Mozo, aborde l’incidence du savoir économique et de la logique monétaire sur la structure et la configuration narrative de l’œuvre de l’écrivain argentin. Il le fait, tout d’abord, à partir de la distinction entre argent et monnaie, pris tous deux comme des signes dont la valeur symbolique différente dédouble la compréhension du dénouement du roman, où les délinquants brûlent une grande quantité de billets de banque. En second lieu, Mozo observe, au niveau thématique et linguistique de l’œuvre, la logique monétaire capitaliste de l’« équivalence généralisée » – invariante mesurable ayant une fonction régulatrice dans l’échange – qui se voit défiée et niée par le comportement des délinquants. En troisième lieu, il s’attache à vérifier une correspondance analogique entre ce comportement antisocial et antiéconomique et un niveau supérieur de la construction du texte : celui de sa poïesis. C’est à ce niveau que se manifeste le paradoxe, car tandis que, dans la trame, les délinquants refusent l’échange symbolique basé sur l’argent, il existe dans l’écriture de Piglia une volonté de construire un échange communicatif – et par conséquent symbolique – avec le lecteur. Mais le fait est que la stratégie narrative réaliste mise en œuvre pour cela ne produit pas d’autre résultat qu’une mimesis imparfaite de la réalité qui contraint à mettre en question son référent. La crise de la représentation, la notion d’« événement » comme construction et celle de vérité comme consensus affleurent sous la volonté de produire un texte lisible. Borja Mozo en conclut que, cependant, Piglia finit par contraindre le lecteur à une version unique s’imposant sur la variété de lectures : il l’oblige à se plier aux limites de représentation qu’impose le langage. L’attitude anti-symbolique subversive des délinquants ne s’accompagne pas dans le roman d’une poïesis qui éloignerait le signe linguistique de son référent. Et le réalisme mimétique impose cette intime contradiction au roman de Piglia.
Si le présent numéro monographique constitue – comme on l’a vu jusqu’ici – une modulation cohérente et nuancée de la critique du représentationalisme, au carrefour entre la littérature et la science, son article de clôture est apparemment l’exception devant être apportée à toute règle. Écrit par le mathématicien Raúl Ibáñez, « Avatars littéraires du dernier théorème de Fermat » passe en revue une quarantaine de romans de la littérature mondiale où ce théorème est présent, que ce soit comme simple figuration ou comme partie essentielle de l’argument. Soit deux formes qui ne mobilisent pas la poïesis du texte, pas plus qu’elles n’y interviennent au niveau structurel. Pourtant – indépendamment de l’analyse épistémologique dont certains pourraient faire l’objet – l’impressionnant déploiement de titres répertoriés tendrait à attester que la science compte sur son potentiel comme élément de fiction. Certes, le théorème de Fermat a eu dans l’histoire un destin romanesque, avec ses différends, ses retards, ses embellies et ses revers, ses déceptions, sa démonstration finale et, plus tard, la remise en question de son utilité. Un véritable récit… que recompose l’article écrit par Raúl Ibáñez. Un récit qui se construit en organisant les différentes fictions qui ont essaimé autour de ce théorème mathématique : une métafiction qui est en même temps un récit réaliste rendant compte de ce qui est véritablement arrivé au théorème. Et, en définitive, un nouvel exemple de la façon dont la réalité se passe de la mimesis pour être racontée, mais peut néanmoins se servir d’une multitude de fragments fictionnels.
Bibliographie
Argüello, Javier, La música del mundo, Barcelone, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011.
Baroja, Pío, El árbol de la ciencia, Madrid, Alianza Editorial, 1979 (version française : L’arbre de la science, Gallimard, 1929, traduit par Georges Pillement).
Cadalso, José (de), Cartas marruecas. Noches lúgubres, E. Martínez Mata (ed.), Madrid, Editorial Crítica, 2000.
Camarero, Jesús, Epistemocrítica. Las estructuras del contenido en literatura y su relación con otros saberes, Saarbrücken, Editorial Académica Española, 2015.
Castro, Sixto J. / Marcos, Alfredo (eds.), Arte y ciencia: mundos convergentes, Madrid, Plaza y Valdés Editores, 2010.
Cioran, Emil, Syllogisme de l’amertume, Paris, Coll. Folio, Gallimard, 1987.
Fernández Buey, Francisco, Para la tercera cultura. Ensayos sobre ciencias y humanidades, Madrid, El Viejo Topo, 2013.
Fernández Mallo, Agustín, Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma, Barcelone, Anagrama, 2009.
Gamoneda, Amelia (ed.), Espectro de la analogía. Literatura y ciencia, Madrid, Abada Editores, 2015.
Gamoneda, Amelia, Del animal poema. Olvido García-Valdés y la poética de lo vivo, Oviedo, Krk editorial, 2016.
Gala, Candelas, Sinergias. Poesía, física y pintura en la España del siglo XX, trad. d’Isabel Palomo, Barcelone, Anthropos Editorial, 2016.
García-Albea, Esteban, Su majestad el cerebro, Madrid, Editorial La esfera de los libros, 2017.
García Lorca, Federico, Poesía completa, Barcelone, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011 (version française : Œuvres complètes, 2 tomes, coll. Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 1990).
González Fernández, Francisco, Esperando a Gödel. Literatura y matemáticas, Madrid, Nivola, 2012.
Huxley, Aldous, Literatura y ciencia. El humanismo frente al progreso científico y tecnológico, trad. de Roberto Ramos Fontecoba, Barcelona, Página Indómita, 2017 (version française : Littérature et science, traduit par Jacques Hess, Paris, Plon, 1966).
Heidegger, Martin, Construir Habitar Pensar, edición de A. Leyte / J. Adrián, Madrid, La Oficina Ediciones, 2015 (version française : Bâtir, habiter, penser, in Essais et conférences, Gallimard, 1958).
Kunz, Marco, «Mitosis, ósmosis y fecundación: tres metáfora biológicas del plurilingüismo literario», in Acta Romanica Basiliensia, Arba 20, «Traducción y estilística», Brandenberger, Schmid, Wilnet (eds.), novembre 2008, p.41-55.
Lázaro, José, Vidas y muertes de Luis Martín-Santos, Barcelone, Editorial Tusquets, 2009.
Litoral. Revista de poesía, arte y pensamiento, monográfico «Ciencia y poesía. Vasos comunicantes», nº 253, 2012.
López-Ocón Cabrera, Leoncio, Breve historia de la ciencia española, Madrid, Alianza Editorial, 2003.
Martín-Santos, Luis, Tiempo de silencio, Barcelone, Editorial Seix-Barral, 2011. (version française : Les demeures du silence, traduit par Alain Rouquié, Actes Sud, 1997).
Peralta, Javier, La matemática española y la crisis de finales del siglo XIX, Madrid, Editorial Nivola, 1999.
Poincaré, Henri, Las ciencias y las humanidades, trad. de Francisco González Fernández, Oviedo, Krk editorial, 2017 (Les Sciences et les humanités, Arthème Fayard, 1911).
Quimera, numéro monographique «Literatura y ciencia», Moreno, Javier (ed.), nº 336, novembre 2011.
Revista de Occidente, numéro monographique «Metáfora y ciencia. Cuando dos y dos no son cuatro», juillet-août 2016, nº 422-423.
Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica, numéro monographique «Sobre ciencia y literatura», María M. García Lorenzo (ed.), nº 23, 2014.
Snow, Charles Percy, Las dos culturas, trad. de H. Pons, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2000 (version française : Les deux cultures, J. J.Pauvert, 1968, trad. Par Claude Noël).
[1] À l’exception d’un remarquable travail de Marco Kunz, professeur de l’Université de Lausanne, consacré partiellement à Les demeures du silence, et intitulé « Mitose, osmose et fécondation : trois métaphores biologiques du plurilinguisme littéraire » (2008), le roman de Martín-Santos n’a toujours pas été abordé d’un point de vue prenant en compte les inscriptions de la science.
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XVI
Télécharger l’article au format PDF : 1 DEFINITIVO INTRO FRANÇAIS