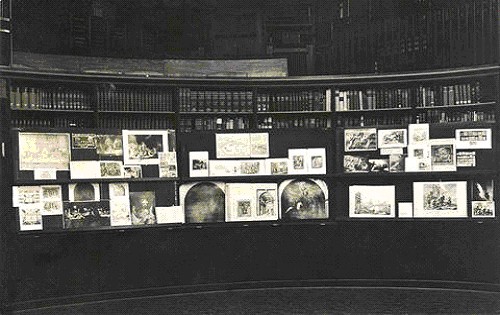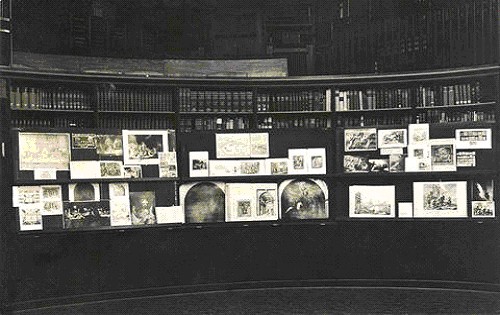
Figure 1 : Aby Warburg, Bilderatlas Mnemosyne (1927-1929). Londres, Warburg Archive.
Toute la mémoire du monde
Au livre I de L’Ève future, Villiers de l’Isle-Adam fait s’exclamer ainsi le personnage de Thomas Edison, peu avant que l’inventeur ne se lance dans la fabrication de l’andréide « Hadaly » :
C’en est fait ! nous ne verrons plus, nous ne reconnaîtrons jamais, en leurs effigies, les choses et les gens d’autrefois, sauf dans le cas où l’Homme découvrirait le moyen de résorber, soit par l’électricité, soit par un agent plus subtil, la réverbération interastrale et perpétuelle de tout ce qui passe […], l’éternelle réfraction interstellaire de toutes choses.[1]
À la déploration de la perte se mêle l’ambition d’une conservation sans limite, (reprise par Alain Resnais dans son magnifique documentaire sur la Bibliothèque nationale[2]), au constat irrévocable de la disparition d’un passé glorieux répond malgré tout la nécessité d’un travail de mémoire. Comme le souligne Edison, ce rêve d’impossible totalité ne peut advenir qu’à la seule condition d’en passer par des moyens techniques. Mélancolie contre « machination », authenticité de l’expérience vécue contre artificialité de la remémoration, fugacité de l’instant contre labeur « en-duré » du souvenir : Villiers de l’Isle-Adam synthétise en ce court extrait d’un impressionnant monologue l’ensemble des contradictions habituellement nouées par toute réflexion sur les conditions matérielles d’archivage de la pensée. Que l’on se réfère à la théorie du pharmakon platonicien ou à l’actuelle numérisation de nos fonds patrimoniaux, en passant par les analyses de Walter Benjamin sur le « déclin de l’aura » et la nouvelle « transmissibilité » des œuvres d’art à l’époque de leur reproductibilité mécanique, l’héritage du passé requiert toujours la médiation d’un appareillage :
De jour en jour s’affirme plus impérieusement le besoin de posséder l’objet d’aussi près que possible, dans l’image ou plutôt dans la reproduction. Et il est évident que la reproduction […] se distingue de l’image. En celle-ci l’unicité et la durée sont aussi étroitement liées qu’en celle-là la fugacité et la reproductibilité. Dégager l’objet de son enveloppe, détruire son aura, c’est la marque d’une perception qui a poussé le sens de tout ce qui est identique dans le monde au point qu’elle parvient même, au moyen de la reproduction, à trouver de l’identité dans ce qui est unique.[3]
Sous l’égide conjointe du « Sorcier de Menlo Park » fabulé à la fin du XIXe siècle par Villiers de l’Isle-Adam et de ce premier penseur de l’appareil photographique qu’est Walter Benjamin, on tâchera d’exposer certains des liens qui unissent la figure de Mnémosyne à ses « prothèses ». Partant de la lecture d’un étonnant texte de Jean-François Lyotard, daté de 1986 (100 ans après la publication du roman de Villiers[4]) et énigmatiquement intitulé « Si l’on peut penser sans corps », on examinera la relation établie par Lyotard entre les « machines de mémoire » et la « mort solaire » de toute chose, afin d’aborder la manière dont ces affinités entre la mémoire et la technique qui la rend possible affectent la création littéraire, tout particulièrement à l’aube du XXIe siècle.
I – Penser sans corps ?
L’impropre de l’homme
« Si l’on peut penser sans corps » est un texte écrit par Jean-François Lyotard à partir de l’enregistrement d’une séance de séminaire tenu à l’Université de Siegen en novembre 1986. Il s’agit donc d’une communication volontairement adressée. Reprise deux ans plus tard dans le recueil L’Inhumain, celle-ci conserve une forme très oralisée, une tonalité générale d’injonction ainsi qu’une « disposition » rhétorique extrêmement rigoureuse. Premier texte d’un ouvrage réunissant près d’une vingtaine de conférences et d’exposés de commande à propos du temps, de la mémoire et du vivant, « Si l’on peut penser sans corps » semble ainsi donner le ton d’une inquiétude ou d’un soupçon porté sur « le »propre’’ de l’homme » :
Et si les humains, au sens de l’humanisme, étaient en train, contraints, de devenir inhumains […] ? Et si le »propre’’ de l’homme était qu’il est habité par de l’inhumain ?[5]
Revendiquant d’emblée – et en termes clairement psychanalytiques – la nécessité d’affronter cette « angoisse » à l’égard du « plus familier des hôtes »[6], Lyotard commence par examiner l’Autre de l’humain sous son aspect le plus radicalement étranger : celui de la machine. Pour traiter ce rapport « unheimlich » de l’humain à l’inorganique, le texte « Si l’on peut penser sans corps » – dont il faut souligner l’ambiguité du titre, au croisement de l’interrogation (« est-il seulement possible de penser sans corps ? ») et de la proposition conditionnelle (« Si l’on peut penser sans corps, alors… ») –, s’organise en deux temps, autour de deux morceaux d’éloquence portés par deux orateurs anonymes, respectivement dénommés « Lui » (première partie du texte) et « Elle » (seconde partie du texte et conclusion). Les deux discours se répondent point par point, à l’argument et à la formule près : le « vous, philosophes » lancé en guise d’exorde par celui qu’on suppose être la figure paradigmatique du Technicien est ainsi repris par « Elle » au tout début de son plaidoyer : « Il y aurait là de quoi nous satisfaire, nous philosophes […] »[7].
C’est dans le cadre de cet échange polémique entre Technique et Philosophie que se déploie la réflexion de Lyotard sur l’absolue nécessité des appareils techniques à la survie du vivant en même temps que sur leur paradoxale incapacité à toucher au « propre » de l’humain ou, autrement dit, sur l’inaptitude des machines à penser – puisque pour Lyotard, la pensée constitue une expérience sensible et « non machinable », défiant dans l’absolu toute « programmation »[8].
Vivants et machines face à la « mort solaire »
Après avoir dénoncé en exorde l’habituel mépris des philosophes à l’égard de la technique (« Vous, philosophes, vous posez des questions sans réponse et qui doivent le rester pour mériter le nom de philosophiques. Une question résolue, elle n’est selon vous que technique »[9]), le premier des rhéteurs présente son argument. À la Philosophie qui prétend pouvoir régler par elle-même le problème de la finitude, le Technicien objecte que seule la technique, parce qu’elle extériorise la mémoire sur des supports, parce qu’elle programme des banques illimitées de données, parce qu’elle « assure [ainsi] au software [le langage humain] un hardware indépendant des conditions de vie terrestre », est capable de répondre à l’un des plus importants défis de la philosophie : celui de la transmission et de la survie de la pensée au-delà de la « fin ».
Vous savez, la technique n’est pas une invention des hommes. Plutôt l’inverse. Les anthropologues et les biologistes admettent que l’organisme vivant même simple, l’infusoire, la petite algue synthétisée au bord des flaques il y a quelques millions d’années par la lumière, est déjà un dispositif technique. Est technique n’importe quel système matériel qui filtre l’information utile à sa survie, la mémorise et la traite, et qui induit, à partir de l’instance régulatrice, des conduites, c’est-à-dire des interventions sur son environnement, qui assurent au moins sa perpétuation. [10]
Lyotard appuie cette thèse technologiste sur une vision tout à fait apocalyptique de la « mort solaire », désastre cosmique qui fait signe en direction de toute une tradition cinématographique – que l’on se souvienne de l’explosion fatale sur laquelle se conclut le film Kiss Me Deadly de Robert Aldrich[11] ou du très bel essai de Chris Marker, Sans Soleil[12] :
En attendant, le soleil vieillit. Il explosera dans 4,5 milliards d’années […]. La terre disparaissant, la pensée cessera, laissant cette disparition absolument impensée. C’est l’horizon même qui s’anéantira et votre transcendance dans l’immanence. La mort, si comme limite, elle est par excellence ce qui se dérobe et se diffère, et par là, ce avec quoi la pensée a affaire constitutivement, cette mort-là n’est encore que la vie de l’esprit. Mais la mort du soleil est la mort de l’esprit, parce qu’il est la mort de la mort comme vie de l’esprit. Il n’y a pas de relève, ni de différer, si rien ne survit.[13]

Figure 2 : Robert Aldrich, Kiss Me Deadly (1955).
C’est tout l’enjeu du témoignage que cristallise ainsi Lyotard, au terme d’un XXe siècle qui combine de façon inédite le plus grand anéantissement mémoriel que l’humanité ait jamais connu et la plus grande augmentation des capacités de stockage des données. À l’aune de ce paradoxe contemporain (oubli génocidaire et vertigineuse hypermnésie), comment la « vie de l’esprit », pour reprendre la belle expression de Hannah Arendt, pourrait-elle résister à l’explosion programmée du soleil ? Davantage, comment pourrait-elle attester de cette inéluctable disparation ? Comment garder une trace de la pire des catastrophes, celle que représente « la mort des pensées inséparables du corps », autrement qu’en ayant recours à des appareils techniques d’enregistrement ?
Après la mort du soleil, il n’y aura pas de pensée pour savoir que c’était la mort. Telle est à mon sens la seule question sérieuse posée aux humains d’aujourd’hui. Auprès d’elle, tout me paraît futile […]. Le reste qui reste après l’explosion solaire, il n’y aura pas un humain, un vivant, terrien, intelligent, sensible et sentimental, qui puisse en témoigner, puisqu’il aura brûlé avec son horizon de terre.[14]
Le Technicien finit ainsi par focaliser l’objet de toute recherche scientifique (« depuis la diététique, la neurophysiologie, la génétique et le tissu de synthèse, jusqu’à la physique des corpuscules, l’astrophysique, l’informatique et le nucléaire ») sur un unique enjeu : « simuler les conditions de la vie et de la pensée de telle sorte qu’une pensée reste matériellement possible après le changement d’état de la matière qu’est le désastre. »[15]
La deuxième partie du texte de Lyotard met en scène la réponse de la Philosophie. Tout en admettant ses objections, celle-ci rappelle au Technicien l’« imbrication du penser et du souffrir »[16] qui s’opère en chaque corps humain et qui fait intrinsèquement défaut aux machines : « L’horizon de la pensée, son orientation, la limite illimitée et la fin sans la fin qu’elle suppose, c’est à l’expérience corporelle, sensible, sentimentale et cognitive d’un vivant très sophistiqué mais terrien que la pensée les emprunte et les doit. »[17] Affirmant ainsi la prééminence « inépuisable »[18] de l’organique, Lyotard en vient à remettre en cause la pertinence des aide-mémoires mis à notre disposition par la technologie moderne : comment le hardware, la machine, l’inorganique par excellence, pourraient-ils en effet répondre au défi de l’é-motion vers le « non-encore-pensé » et expérimenter la « souffrance du temps » qui caractérise la « vraie » pensée ?
La douleur de penser n’est pas un symptôme, qui viendrait d’ailleurs s’inscrire sur l’esprit à la place de son lieu véritable. Elle est la pensée elle-même en tant qu’elle se résout à l’irrésolution, décide d’être patiente, et veut ne pas vouloir, veut, justement, ne pas vouloir dire à la place de ce qui doit être signifié. Révérence faite à ce devoir, qui n’est pas encore nommé. Ce devoir n’est peut-être pas une dette, c’est peut-être seulement le mode selon quoi ce qui n’est pas encore le mot, la phrase, la couleur viendra. De sorte que la souffrance de penser est une souffrance du temps, de l’événement. J’abrège : vos machines à représenter, à penser, souffriront-elles ? Que peut être le futur pour elles, qui ne sont que mémoires ? [19]
Avant d’en venir plus précisément à la manière dont certaines œuvres littéraires contemporaines ont choisi de répondre à ces questions philosophiques, posées par Lyotard en guise de péroraison avec un usage tout rhétorique du pathos et des apostrophes[20], il est essentiel de revenir en détail sur l’ambivalente conception de la mémoire qui sous-tend ce texte.
Hériter du futur : une double définition de la mémoire
Dans l’extrait précédent, la mémoire nous est présentée comme un attribut exclusif des machines (« vos machines […], que peut être le futur pour elles, qui ne sont que mémoires ? »), comme le pouvoir absolu, quoique restreint, d’un archivage qui consisterait à « décrire la pensée sous la forme d’une sélection des données et de leur articulation »[21]. À l’exact opposé de cette première définition de la mémoire – qui n’est pas sans rappeler celle que donne Platon de l’hypomnésis et des hypomnèmata dans le Phèdre : non pas « la » mémoire mais les signes et les supports extérieurs de la remémoration[22] –, la notion de témoignage, en tant que mémoire vive, urgente et sensible, s’impose comme l’unique moyen de résister à la mort solaire. Comment articuler ces deux visions antinomiques de Mnémosyne ? Comment concilier cette mémoire « morte », machinale et machinique, répétitive et automatique, « sans affect ni auto-affection » des appareils techniques et cette autre mémoire organique, fragile et essentiellement « humaine », de la catastrophe ?
Le problème posé par leur agencement détermine l’ensemble de « Si l’on peut penser sans corps » ainsi qu’il oriente toute la réflexion « grammatologique » de Derrida. Dans « La pharmacie de Platon », ce dernier a fort bien montré que l’écriture-pharmakon dont le Phèdre instruit le procès est beaucoup plus qu’un simple accessoire ou « excédent » de la mémoire vive (mnêmê). Elle remet profondément en cause la hiérarchisation axiologique qui fonde l’épistémè occidentale des rapports entre tekhnè et écriture, machine et pensée, organique et inorganique : la mnêmê intériorisante, capable de répéter l’Idée (eidos) et d’accéder à la connaissance authentique grâce à l’anamnèse, se trouve « engourdie » et « supplantée » par l’hypomnésis, mémoire secondaire qui ne peut que s’aider de l’artifice des empreintes (tupoi) et des archives[23]. En brouillant les frontières qui séparent habituellement le dedans du dehors, la vie de la mort, l’écriture-pharmakon révèle la nécessaire interdépendance des deux mémoires :
Si le pharmakon est « ambivalent », c’est donc bien pour constituer le milieu dans lequel s’opposent les opposés, le mouvement et le jeu qui les rapportent l’un à l’autre, les renverse et les fait passer l’un dans l’autre (âme/corps, bien/mal, dedans/dehors, mémoire/oubli, parole/écriture, etc.) […]. Le pharmakon est le mouvement, le lieu et le jeu (la production de) la différence. Il est la différance de la différence.[24]
De même que tout désir de conservation est intimement lié à une pulsion inverse (la menaçante et destructrice « anarchive »[25]), Derrida insiste sur le fait que la conjonction entre mnêmê et hypomnésis est l’ultime condition de saisie de l’événement. Penser cette contradiction ou, plus précisément, cette hybridation, telle est la tâche « monstrueuse » que Derrida fixe à la philosophie :
Pourrons-nous un jour, et d’un seul mouvement, adjointer une pensée de l’événement avec la pensée de la machine ? Pourrons-nous penser, d’un seul et même coup et ce qui arrive (on nomme cela un événement), et, d’autre part, la programmation calculable d’une répétition automatique (on nomme cela une machine) ? Il faudrait alors dans l’avenir (mais il n’y aura d’avenir qu’à cette condition), penser et l’événement et la machine comme deux concepts compatibles, voire indissociables. [26]
Au terme de « Si l’on peut penser sans corps », Lyotard ne dit pas autre chose : ce qu’il nous faut arriver à concevoir, c’est un corps « impropre », un corps proprement inhumain, « à la fois »naturel’’ et artificiel »[27] – ce que Benjamin appelle quant à lui un corps « innervé »[28] par la technique et ce que Villiers invente précisément avec le personnage d’Hadaly.

Figure 3 : Fritz Lang, Metropolis (1927).
Pour enfin braver la mort solaire, nous aurions besoin d’un organisme qui soit à même de combiner le hardware imperturbable de la machine et le corps phénoménologique de la sensation, capable à la fois d’anticiper, de calculer et de « prévoir » comme le soutient Nietzsche[29] et de rester simultanément ouvert à « ce qui arrive », sensible au devenir, à l’inarchivé voire à l’inarchivable. La notion même de « prothèse » change alors de sens. Comme le souligne Bernard Stiegler, elle ne vient pas tant pallier un manque, combler une perte ou réparer une déficience de l’organisme que s’ajouter spatialement (« devant ») et temporellement (« déjà ») à ce qui est :
Par prothèse, nous entendrons toujours à la fois : posé devant, ou spatialisation (é-loignement), posé d’avance, déjà là (passé) et anticipation (prévision), c’est-à-dire temporalisation. La prothèse n’est pas un simple prolongement du corps humain, elle est la constitution de ce corps en tant »qu’humain’’. Elle n’est pas un »moyen’’ pour l’homme, mais sa fin […]. C’est le processus de l’anticipation lui-même qui s’affine et se complique avec la technique qui est ici le miroir de l’anticipation, lieu de son enregistrement et de son inscription en même temps que surface de son réfléchissement, de la réflexion qu’est le temps, comme si l’homme lisait et liait son avenir dans la technique.[30]
Seul un corps aussi étrange et composite, prothétique plutôt que prothétisé, serait ainsi capable de transformer la violente expérience du désastre (Erlebnis) en expérience de pensée (Erfahrung) et de faire de l’événement historiquement subi l’objet construit d’une possible transmission.
II – La littérature, un étrange corpus en mouvement
Corpus : repère dispersés, difficiles, lieux-dits incertains, plaques effacées en pays inconnu, itinéraire qui ne peut rien anticiper de son tracé dans les lieux étrangers. Écriture du corps : du pays étranger, de cet étrangement qu’est le pays.
Jean-Luc Nancy, Corpus.
L’attention portée à la démonstration rhétorique ainsi qu’à la structure dramaturgique de « Si l’on peut penser sans corps » n’a rien d’anodin. En effet, le texte de Lyotard illustre de façon exemplaire le mouvement « pharmacologique » par lequel le logos se trouve insidieusement contaminé par la fiction littéraire, comme infiltré et progressivement transplanté hors de son lieu philosophique habituel, dès qu’il s’agit de traiter des rapports entre la machine, la mémoire et le vivant[31].
L’hypothèse que l’on souhaiterait esquisser ici est la suivante : et si le corpus constitué par les œuvres littéraires était le lieu privilégié de cette fameuse « innervation » ? Et si la littérature, par son pouvoir d’hybridation formelle et sa plasticité linguistique, offrait un modèle essentiel de corps prothétique, protéiforme et ouvert, conjuguant les deux mémoires distinguées par Lyotard afin de « produire autant que d’enregistrer l’événement »[32] ?
Innervation par la science-fiction
De nombreuses pistes ont déjà été ouvertes. La fiction d’anticipation littéraire explore sans relâche cet inquiétant phénomène de « peuplement » entre ce que Deleuze et Guattari appellent également « deux états du vivant » :
Il devient indifférent de dire que les machines sont des organes, ou les organes, des machines […]. L’essentiel n’est pas dans le passage à l’infini lui-même, l’infinité composée des pièces de machine ou l’infinité temporelle des animalcules, mais plutôt dans ce qui affleure à la faveur de ce passage. Une fois défaite l’unité structurale de la machine, une fois déposée l’unité personnelle et spécifique du vivant, un lien direct apparaît entre la machine et le désir, la machine passe au cœur du désir, la machine est désirante et le désir, machiné […]. Bref, la vraie différence n’est pas entre la machine et le vivant, le vitalisme et le mécanisme, mais entre deux états de la machine qui sont aussi bien deux états du vivant.[33]
Outre L’Ève future, on se reportera bien sûr à toutes les œuvres affiliées à la tradition cyberpunk (John Brunner, Norman Spinrad, Lewis Shiner, Walter Jon Williams, Samuel Delany, James Flint, Neal Stephenson) fondée au début des années 1980 par William Gibson (Johnny Mnemonic, 1981 ; Neuromancer, 1984) et Bruce Sterling (Mirrorshades: A Cyberpunk Anthology, 1986), qui développent le thème de la mutuelle « complétion » du corps et des machines en manipulant la langue anglaise[34]. À l’appui de cet incessant travail d’innervation opéré par la science-fiction contemporaine, convoquons simplement les inquiets propos de Philip K. Dick, qui font de la machine le principal modèle épistémologique au miroir duquel interroger la spécificité de l’humain :
We humans, the warm-faced and tender, with thoughtful eyes — we are perhaps the true machines. And those objective constructs, the natural objects around us and especially the electronic hardware we build, the transmitters and microwave relay stations, the satellites, they may be cloaks for authentic living reality inasmuch as they may participate more fully and in a way obscured to us in the ultimate Mind. Perhaps we see not only a deforming veil, but backwards. Perhaps the closest approximation to truth would be to say: « Everything is equally alive, equally free, equally sentient, because everything is not alive or half-alive or dead, but rather lived through”.[35]
De nouveaux « dispositifs » de mémoire
À ces grandes références de la fiction d’anticipation qui exposent des corps pleinement innervés par la technique, il faut enfin ajouter un autre type d’œuvres littéraires qui réalisent cette interaction de façon certes moins explicite mais tout aussi efficace. Que l’on songe par exemple au vaste et monstrueux « Projet » de Jacques Roubaud (notamment à l’une de ses dernières résurgences : la version « mixte » du Projet que constitue La Bibliothèque de Warburg)[36], au vertigineux roman Austerlitz de W. G. Sebald[37], à l’étonnant laboratoire de J. G. Ballard : The Atrocity Exhibition (1969-1990)[38] ou encore à l’œuvre romanesque de l’argentin Ricardo Piglia, programmatiquement intitulée Respiration artificielle (1980)[39].
Sans entrer dans le détail des textes ni viser l’exhaustivité de la démonstration, on rappellera synthétiquement les grandes problématiques offertes par cet autre corpus d’étude. Le rapport de « peuplement » entre machine et vivant, mnêmê et hypomnésis, n’est plus donné à lire au travers des personnages ou des thématiques mises en scène comme c’est le cas dans les textes de science-fiction cités précédemment. Il se joue au plan de l’architecture des œuvres ou, plus exactement, de ce qu’il conviendrait d’appeler, avec Foucault, Deleuze et Giorgio Agamben, leurs « dispositifs »[40] mémoriels. En dépit de leurs différences voire de leurs disparités, ces quatre œuvres partagent effectivement une même puissance d’invention face à la nécessité de repenser les procédures mémorielles après « l’époque de la disparition »[41]. Avec d’autres auteurs comme Georges Perec, Denis Roche ou Claude Simon, W. G. Sebald, J. G. Ballard, Ricardo Piglia et Jacques Roubaud ont en commun d’avoir pris acte des mutations historiques et techniques du XXe siècle (l’art « en tant que photographie », le « déclin de l’aura », le passage à la question de « l’exposition », la problématique de la « trace »). Ni successeurs, ni descendants, ni disciples au sens filial et traditionnel du terme, mais héritiers, au sens éthique et politique, d’une mémoire du désastre, ils interrogent notre difficulté à hériter de temps multiples – y compris du futur, comme nous y invitent Nietzsche, Lyotard et Marker.
Élevant l’écrivain au statut de « technologue » et le lecteur à celui de « mécano », chacune de leurs œuvres génère ainsi un corpus hétérogène, situé à la rencontre du programme et de l’événement sensible, de l’archive et du « mal d’archive », du « calcul » (Arno Schmidt) et du hasard, de la machination et de la « vraie pensée ». Qu’il s’agisse des circonvolutions romanesques de Jacques Roubaud où s’entremêlent la mathématique et la poésie, où l’écriture autobiographique remobilise les anciens « arts de mémoire »[42] ; qu’il s’agisse des agencements entre texte et photographies proposés par W. G. Sebald dans un sillage tout à fait benjaminien ; qu’il s’agisse de J. G. Ballard, qui transforme son roman en vaste machine à recycler la mémoire collective et l’iconographie populaire de la seconde moitié du XXe siècle – au moyen notamment de la répétition hallucinée des séquences narratives et d’un proliférant appareil de notes ; ou qu’il s’agisse encore de Ricardo Piglia, qui applique à la douloureuse mémoire argentine les préceptes du formaliste Iouri Tynianov, faisant de l’écriture romanesque un patient travail d’« ostranenie »… chacune de ces œuvres littéraires produit un type singulier de dispositif destiné à lutter contre l’oubli et offrant une manière de réponse au paradoxe énoncé conjointement par Edison, Benjamin et Lyotard : « résorber » par la technique la « réfraction interstellaire » des choses et des événements afin d’en faire non seulement l’objet d’un témoignage mais une véritable matière à connaissance.
Conclusion méthodologique
À la suite de Michel Carrouges et de Pierre Macherey, Deleuze en a fait la démonstration magistrale dans Proust et les signes : poser la question de la machine à la littérature et dans la littérature consiste non plus à interroger la signification de l’œuvre littéraire mais la complexité de son fonctionnement.
Télescope psychique pour une « astronomie passionnée », la Recherche n’est pas seulement un instrument dont Proust se sert en même temps qu’il le fabrique. C’est un instrument pour les autres, et dont les autres doivent apprendre l’usage […]. Non seulement instrument, la Recherche est une machine. L’œuvre d’art moderne est tout ce qu’on veut, ceci, cela, et encore cela, c’est même sa propriété d’être tout ce qu’on veut, d’avoir la surdétermination de ce qu’on veut, du moment que ça marche : l’œuvre d’art moderne est une machine, et fonctionne à ce titre.[43]
Est-ce que « ça marche » et comment « ça marche » ? Telles sont les questions qu’il nous faut poser aux arts de mémoire littéraires – dont les précédents exemples ne sont que les jalons d’un Atlas encore embryonnaire du XXIe siècle. Avec quels outils analyser ces nouvelles « mnémo-technographies » ? Comment rester fidèle à leurs machinations ? Comment en retranscrire le fonctionnement et s’en faire aujourd’hui les authentiques héritiers ?
Il faut à notre tour en passer par la technique. Comme on a cherché à le faire ici en confrontant Villiers à Lyotard, la littérature à la philosophie, la fiction à la théorie, l’une des façons les plus intéressantes de « traiter » ces dispositifs romanesques consiste à équiper son regard de multiples prothèses. Afin de mieux prendre en compte les phénomènes d’hétérogénéité, d’innervation, de prolifération et de possible effacement mémoriel mis en œuvre par un tel corpus littéraire, c’est la lecture elle-même qui doit être envisagée en termes d’appareillage. Issu du verbe latin apparare (préparer, apprêter, orner), l’appareillage « joue » à plusieurs niveaux : maritime (lever l’ancre), architectural (apparier les matériaux de construction), linguistique (la « prosthèse ») et médical (le supplément technique). L’appareillage, qui permet tout aussi bien de séparer que de raccorder, de détruire que d’augmenter, d’entrechoquer que de (re)monter, est un geste fondamentalement critique et comparatiste, grâce auquel la littérature s’ouvre à des domaines étrangers comme le cinéma, la philosophie, les sciences du vivant ou les arts plastiques. Reliant par isomorphie la loi de la lecture à celle des œuvres étudiées, on se donne enfin la chance de « rapprocher des choses qui ne l’avaient jamais été » (selon la formule fétiche que Jean-Luc Godard emprunte à Pierre Reverdy), de la même manière que la mémoire ne cesse de reprendre et de repriser, altérant ses archives tout en les réinscrivant dans des « constellations » de pensée toujours inédites.
[1] Auguste Villiers de l’Isle-Adam, L’Ève future, éd. N. Satiat, Paris, Flammarion, « GF », 1992, p. 125-126.
[2] Alain Resnais, Toute la mémoire du monde, 35 mm, 22 min, Les Films de la Pléiade, 1956.
[3] Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie » (1931), dans Œuvres II, trad. M. de Gandillac, R. Rochlitz et P. Rusch, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000, p. 311.
[4] Avant d’être publiée en 1886 chez M. de Brunhoff, L’Ève future était d’abord parue en feuilleton dans deux périodiques, L’Étoile française (1880-1881) et La Vie moderne (1885-1886).
[5] Jean-François Lyotard, L’Inhumain : Causeries sur le temps, Paris, Galilée, « Débats », 1988, p. 10.
[6] Le vocabulaire est directement emprunté à la théorie freudienne : « Le système a plutôt pour conséquence de faire oublier ce qui lui échappe. Mais l’angoisse, l’état d’un esprit hanté par un hôte familier et inconnu qui l’agite, le fait délirer mais aussi penser – si on prétend l’exclure, si on ne lui donne pas d’issue, on l’aggrave. Le malaise s’accroît avec cette civilisation, la forclusion avec l’information. » Ibid., p. 10. Nous soulignons.
[7] Ibid., p. 25.
[8] « Est-il même consistant de prétendre mettre en programme une expérience qui défie, sinon la programmation, du moins le programme, comme est la vision du peintre ou l’écriture ? » Ibid., p. 26.
[9] Ibid., p. 17.
[10] Ibid., p. 21. Nous soulignons. On retrouve exactement la même définition « hypomnésique » de la technique chez Bernard Stiegler : « Il faut comprendre la rupture en quoi consiste l’extériorisation comme l’émergence d’une nouvelle organisation de la mémoire, comme l’apparition de nouveaux supports de mémoire […]. C’est en se libérant de l’inscription génétique que la mémoire à la fois poursuit le processus de libération et y inscrit la marque d’une rupture – sur les cailloux, sur les murs, dans les livres, les machines, les madeleines et toutes les formes de supports, depuis le corps tatoué lui-même jusqu’aux mémoires génétiques instrumentalisées […] en passant par les mémoires holographiques que projette l’industrie informatique. » Bernard Stiegler, La Technique et le temps. I, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 1994, p. 178. « Parce que le cerveau ne suffit pas à mémoriser […], le support est donc la condition d’élaboration du savoir, et non seulement de transmission. » Bernard Stiegler, « Du jugement prothétique a priori », conférence donnée au séminaire « Les supports de la mémoire », texte mis en ligne en novembre 2005 sur le site Ars Industrialis, URL : http://www.arsindustrialis. org/activites/cr/5nov2005/dujugementprothetique. Consulté le 10 janvier 2009.
[11] Robert Aldrich, Kiss Me Deadly (En quatrième vitesse), 106 min, United Artists, 1955. Le film s’ouvre sur l’obscurité d’une route déserte où erre une fugitive (Christina) et se termine sur la lumière éblouissante jaillissant d’une boîte de Pandore radioactive. Associant les peurs d’un nouvel âge industriel à un jeu formel sur les stéréotypes du film noir, Aldrich soumet également son implacable machine cinématographique à un devoir de mémoire (le détective Mike Hammer débute en effet son enquête à partir des simples mots « Remember me » que Christina a eu le temps de lui confier avant d’être assassinée.)
[12] Chris Marker, Sans Soleil, 16 mm gonflé en 35, 110 min, Argos Films, 1982. S’il rend explicitement hommage au « soleil noir » de Gérard de Nerval, Chris Marker emprunte également ses références au film catastrophe et à la science-fiction d’après-guerre. Dans un geste esthétique très proche de celui d’Alain Fleischer, Chris Marker développe enfin une réflexion sur la puissance révélatrice du « noir ». Cf. Alain Fleischer, L’Empreinte et le tremblement / Faire le noir, Paris, Galaade, 2009.
[13] Jean-François Lyotard, op. cit., p. 17-19.
[14] Ibid., p. 18-19.
[15] Ibid., p. 20. Nous soulignons.
[16] Ibid., p. 26. Sans toutefois le citer, Lyotard fait écho à la réflexion de Deleuze sur la « violence des signes » : « Nous ne cherchons la vérité que quand nous sommes déterminés à le faire en fonction d’une situation concrète, quand nous subissons une sorte de violence qui nous pousse à cette recherche. Qui cherche la vérité ? C’est le jaloux, sous la pression des mensonges de l’aimé. Il y a toujours la violence d’un signe qui nous force à chercher, qui nous ôte la paix. La vérité ne se trouve pas par affinité, ni par bonne volonté, mais se trahit à des signes involontaires. Le tort de la philosophie, c’est de présupposer en nous une bonne volonté de penser, un désir, un amour naturel du vrai […]. Il y a peu de thèmes sur lesquels Proust insiste autant que celui-là : la vérité n’est jamais le produit d’une bonne volonté préalable, mais le résultat d’une violence dans la pensée. » Gilles Deleuze, Proust et les signes (1964), Paris, P.U.F., « Quadrige », 2e édition, 1998, p. 10 et 24-25. Nous soulignons.
[17] Jean-François Lyotard, op. cit., p. 18. Nous soulignons.
[18] « Si l’on parle d’analogique sérieusement, c’est cette expérience qu’on connote, ce flou, cet incertain, et cette foi dans l’inépuisable sensible, et pas seulement un mode de report du donné sur une surface d’inscription qui n’est pas originairement la sienne. » Ibid., p. 25.
[19] Ibid., p. 27-28. Nous soulignons.
[20] Il faut noter la gradation de l’interpellation par laquelle se conclut le dialogue entre Technique et Philosophie : l’apostrophe commence au futur (« vos machines à représenter, à penser, souffriront-elles ? »), se module au conditionnel (« il faudrait que le non-pensé leur fasse mal, fasse mal à leur mémoire, le non inscrit qui reste à inscrire, comprenez-vous ? ») avant de se muer en urgence impérative : « Il nous faut des machines qui souffrent de l’encombrement de leur mémoire. » Ibid., p. 27-28.
[21] Ibid., p. 26.
[22] Dans ce dialogue, Platon définit l’écriture (grammata) comme une drogue ambivalente (pharmakon) offerte par le dieu Theuth au roi Thamous. Le mot « pharmakon » signifiant à la fois remède et poison, l’écriture se trouve d’emblée dotée d’une double caractéristique : supplément sensible, visible et spatial de la mnêmê, elle agit du dehors comme « aide-mémoire » tout en faisant preuve d’un pouvoir maléfique d’infiltration du « dedans invisible de l’âme, la mémoire et la vérité ». Au lieu d’accroître le savoir comme l’affirme Theuth, l’écriture rend au contraire toujours « plus oublieux » : « cette connaissance aura, pour résultat, chez ceux qui l’auront acquise, de rendre leurs âmes oublieuses, parce qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire (lethen men en psuchais parexei mnêmes amélétésiâ) : mettant en effet leur confiance dans l’écrit, c’est du dehors, grâce à des empreintes étrangères (dia pistin graphès exothen up’allotriôn tupôn), non du dedans et grâce à eux-mêmes qu’ils se remémoreront les choses (ouk endothen autous uph’autôn anamimneskomenous). Ce n’est donc pas pour la mémoire, c’est pour la remémoration que tu as découvert un remède (oukoun mnémès, alla upomnéseôs, pharmakon eures). » Platon, Phèdre, 274 e-275 b, dans Jacques Derrida, « La pharmacie de Platon », Tel Quel, n° 32, Hiver 1968, p. 34.
[23] Derrida note que l’on retrouve la même différenciation chez Hegel entre le souvenir intériorisant (die Erinnerung) et l’extériorité graphique, spatiale et technique de la mémoire-Gedächtnis. Jacques Derrida, « Actes », dans Mémoires – Pour Paul de Man, Paris, Galilée, « La Philosophie en effet », 1988, p. 108-110.
[24] Jacques Derrida, art. cit., p. 39.
[25] « Car l’archive, si ce mot ou cette figure se stabilisent en quelque signification, ce ne sera jamais la mémoire ni l’anamnèse en leur expérience spontanée, vivante, intérieure. Bien au contraire : l’archive a lieu au lieu de défaillance originaire et structurelle de ladite mémoire […]. L’archive travaille toujours et a priori contre elle-même. » Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Galilée, « Incises », 1995, p. 26-27.
[26] Jacques Derrida, Papier machine, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 2001, p. 34.
[27] « Et c’est ce corps-là, à la fois »naturel’’ et artificiel, qu’il faudra emporter loin de la terre avant sa destruction, si l’on veut que la pensée qui doit survivre à l’explosion solaire soit autre chose que le misérable squelette binarisé de ce qu’elle était auparavant. » Jean-François Lyotard, op. cit., p. 26.
[28] « La collectivité aussi est de nature corporelle (leibhaft). Et la phusis qui pour elle s’organise en technique ne peut être produite dans toute sa réalité politique et matérielle qu’au sein de cet espace d’images avec lequel l’illumination profane nous familiarise. Lorsque le corps et l’espace d’images s’interpénétreront en elle si profondément que toute tension révolutionnaire se transformera en innervation du corps collectif (leibliche kollektive Innervation), toute innervation corporelle de la collectivité en décharge révolutionnaire, alors seulement la réalité sera parvenue à cet autodépassement qu’appelle le Manifeste communiste. » Walter Benjamin, « Le Surréalisme », dans Œuvres II, trad. M. de Gandillac, Paris, Gallimard, « Folio essais », 2000, p. 134.
[29] Je me réfère à la définition de la culture exposée dans la deuxième dissertation de La Généalogie de la morale. Opposée en apparence à la saine faculté d’oubli défendue dans la Deuxième Considération inactuelle, la culture nous dote selon Nietzsche d’une faculté mnésique qui n’a plus rien à voir avec la « fièvre historienne » (historisches Fieber) qui « ébranle et fait dégénérer la vie » (zerbröckelt und entartet das Leben). Parce qu’elle nous rend responsables d’une dette envers nos semblables, la culture est présentée comme « mémoire de la volonté » (Gedächtnis des Willens), à la fois « engagement de l’avenir, souvenir du futur » et douloureux « mouvement qui s’opère dans les corps et s’inscrit sur eux, les labourant » (Deleuze) : « Pour pouvoir à ce point disposer à l’avance de l’avenir, combien l’homme a-t-il dû d’abord apprendre à séparer le nécessaire du contingent, à penser sous le rapport de la causalité, à voir le lointain comme s’il était présent et à l’anticiper, à voir avec certitude ce qui est but et ce qui est moyen pour l’atteindre, à calculer et à prévoir […], pour pouvoir finalement, comme le fait quelqu’un qui promet, répondre de lui-même comme avenir. » Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, trad. I. Hildenbrand et J. Gratien, Paris, Gallimard, « Folio essais », 1971, p. 60-63.
[30] Bernard Stiegler, La Technique et le temps. Tome I : La faute d’Épiméthée, Paris, Galilée, « La philosophie en effet », 1994, p. 162-163.
[31] Les ouvrages de Jean-Luc Nancy en sont un autre exemple : cf. L’Intrus, Paris, Galilée, 2000 et Corpus, Paris, Métailié, 2000.
[32] L’expression est de Derrida : « La structure technique de l’archive archivante détermine aussi la structure du contenu archivable dans son surgissement même et dans son rapport à l’avenir. L’archivation produit autant qu’elle enregistre l’événement. [Elle] commande ce qui dans le passé même instituait et constituait quoi que ce fût comme anticipation de l’avenir. Et comme gageure. L’archive a toujours été un gage, et comme tout gage, un gage d’avenir. » Jacques Derrida, Mal d’archive, Paris, Galilée, « Incises », 1995, p. 34-36.
[33] Gilles Deleuze et Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, « Critique », 1972, p. 339. Nous soulignons. En ce qui concerne le cinéma, le travail de David Cronenberg est un modèle du genre. Le « peuplement » opère de ses premiers films de série B hantés par l’obsession de la contamination (Shivers, Rabies, The Brood, Scanners) jusqu’à son adaptation du roman de J. G. Ballard, Crash ! (1996) et eXistenZ (1999), en passant par Videodrome (1982), The Fly (1986) et la fabuleuse adaptation de Naked Lunch (1991).
[34] À cet égard, la prolifération des néologismes chez William Gibson (neuromancer, cyberspace, conurb, nerve-splicing, joeboys, force-feedback, etc.) est à rapprocher du travail de réinvention de la langue française par néologismes scientifiques et préciosité lexicale chez Villiers et Roussel.
[35] « Il se peut que nous autres humains, tendres et chaleureux, le regard brillant d’une pensée profonde, soyons les vraies machines. Et il se peut que les constructions objectives autour de nous, les objets naturels autour de nous, et surtout les appareils électroniques que nous fabriquons – transmetteurs et stations de relais des micro-ondes, satellites – ne soient que les déguisements de la réalité authentique et vivante […]. Il se peut que nous voyions non seulement à travers un voile déformant, mais de plus, à l’envers. Que la meilleure approche de la vérité serait de dire : »Tout est vivant de la même manière, sensible de la même façon, car tout n’est pas vivant, à moitié vivant, ou mort, mais plutôt, tout est vécu comme passage’’. » Philip K. Dick, « Hommes, androïdes et machines », dans Si ce monde vous déplait… et autres écrits, trad. C. Wall-Romana, Paris, Éditions de l’Éclat, 1998, p. 116-117. Man, Android and Machine fut rédigé pour une convention de science-fiction à laquelle Dick ne se rendit pas et a paru pour la première fois dans l’anthologie Science fiction at Large (ed. Peter Nicholls), Londres, Gollancs, 1976.
[36] Cf. Jacques Roubaud, « Description du Projet », Mezura. Cahiers de Poétique comparée (Deuxième série : documents de travail), n° 9, Paris, INALCO, 1979 ; La Bibliothèque de Warburg : Version Mixte, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2002.
[37] W. G. Sebald, Austerlitz, München/Wien, Carl Hanser Verlag, 2001 (Austerlitz, trad. P. Charbonneau, Arles, Actes Sud, 2002, rééd. Paris, Gallimard, « Folio », 2006).
[38] J. G. Ballard, The Atrocity Exhibition (1969-1990), London, HarperCollins-Flamingo, 2001 (La Foire aux atrocités, trad. F. Rivière, Paris, Tristram, 2003).
[39] Ricardo Piglia, Respiración artificial (1980), Barcelona, Anagrama, 2001 (Respiration artificielle, trad. A. et. I. Berman, Marseille, André Dimanche, 2000). Voir aussi le labyrinthique La ciudad ausente (1992), Buenos Aires, Seix Barral, 2004 (La Ville absente, trad. F.-M. Durazzo, Paris, Zulma, 2009), qui met en scène une nouvelle « Ève future », mi-femme, mi-machine, autour de laquelle s’enchevêtrent une multiplicité de récits.
[40] Cf. Michel Foucault, « Le jeu de Michel Foucault », dans Dits et écrits III, Paris, Gallimard, 2000, p. 298-342 ; Gilles Deleuze, « Qu’est-ce qu’un dispositif ? », dans Deux régimes de fous, éd. David Lapoujade, Paris, Minuit, « Paradoxe », 2003, p. 318-325 ; Giorgio Agamben, Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. M. Rueff, Paris, Payot et Rivages, « Rivages poche/Petite Bibliothèque », 2007.
[41] Cf. Jean-Louis Déotte et Alain Brossat, L’Époque de la disparition : Politique et esthétique, Paris, L’Harmattan, « Esthétiques », 2000.
[42] Cf. Jacques Roubaud, Le Fils de Leoprepes : Poésie et mémoire, Saulxures, Circé, 1993.
[43] Gilles Deleuze, Proust et les signes, op. cit., p. 174-175. Ce questionnement, effectivement inspiré par les ouvrages de Michel Carrouges (Les Machines célibataires, Paris, Arcanes, « Chiffres », 1954) et de Pierre Macherey (Pour une théorie de la production littéraire, Paris, Maspero, 1966), trouve d’autres prolongements chez Michel Serres, (Feux et signaux de brume : Zola, Paris, Grasset, « Figures », 1975) et Italo Calvino (La Machine littérature (1984), trad. M. Orcel et F. Wahl, Paris, Seuil, « La Librairie du XXe siècle », 1993).