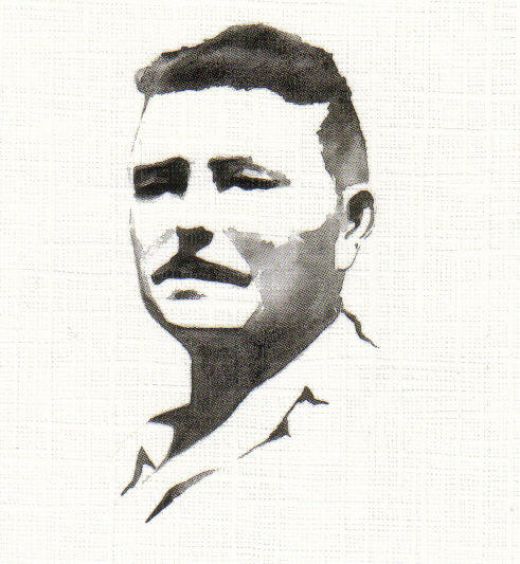Si l’on se souvient aujourd’hui de Malcolm Lowry, c’est d’abord au titre des fictions qui lui sont attribuées, voire à cause d’un ouvrage en particulier, Under the Volcano (1947) que l’on tient souvent pour l’un des romans de langue anglaise les plus marquants du vingtième siècle. Cela dit, la fiction telle qu’il la conçoit ne se laisse en aucun cas réduire ni à une modalité particulière de la narration, ni à un corpus de récits partageant certaines caractéristiques immanentes, si exemplaires soient”‘ils. Chez Lowry, la fiction par excellence n’est pas une dimension du texte, mais réside dans l’affirmation qu’il a pour origine l’activité de l’individu présenté comme son « auteur », dans la revendication qu’exprime la signature dont il est porteur ; en ce sens, relève de la fiction tout écrit tenu pour ressortir à un régime particulier de la propriété intellectuelle, quel que soit le genre auquel il appartient (roman, nouvelle, poème, lettre, pour citer quelques”‘unes des formes les plus pratiquées par Lowry) et sans préjuger de ses particularités sémantiques ou formelles, de la valeur de vérité des énoncés qu’il contient ni même de son éventuel recours à la narration. Ainsi caractérisée, la fiction n’entretient pas de relations privilégiées avec la littérature, puisqu’elle se définit moins comme un objet esthétique que comme une modalité du rapport au langage écrit, à la trace matérielle offerte à la contemplation et à la lecture : la question qu’elle pose est celle de la lettre et de son usage, condition de possibilité de la pratique littéraire (et donc de l’invention romanesque), mais aussi, d’abord, enjeu épistémologique dont la portée est beaucoup plus vaste.
En effet, c’est bien de savoir qu’il s’agit, et cela à deux niveaux. D’une part, on ne peut examiner ainsi la fonction de l’écrit sans s’interroger sur ce qu’il enseigne à son lecteur, c’est”‘à”‘dire pour commencer à son « auteur », celui qui le découvre avant tous les autres (c’est peut”‘être là son seul vrai privilège). Que me dit ce texte que j’ai sous les yeux ? Qu’a”‘t”‘il à m’apprendre sur moi”‘même, à moi qui, de temps à autre, suis tenté de me reconnaître dans ce que je lis au point de le présenter à autrui comme mon œuvre ? D’autre part, un tel questionnement comporte une dimension réflexive, propice à l’émergence d’un savoir paradoxal sur ce que savoir veut dire, sur la fiction qui rend possible l’acte cognitif et dont il ne se laisse que malaisément distinguer. Admettre que toute signature est fictive, c’est se préparer à envisager l’hypothèse que le savoir s’appuie toujours sur une fiction pour peu que son autorité dépende des modalités de sa transmission écrite, ce qui est généralement le cas dans une culture comme la nôtre. Dès lors, on comprend mieux pourquoi les textes de Lowry n’établissent aucune hiérarchie de principe entre les « vrais » savoirs (scientifique, technologique, historique, géographique, philologique…) et les savoirs « imaginaires » ou perçus comme tels, par exemple l’astrologie, l’alchimie, la théosophie ou les arts divinatoires. En tant qu’ils s’interrogent sur leurs propres conditions d’apparition, tous les savoirs sont également vrais, et cela parce qu’ils se savent tous fictifs au même degré et pour les mêmes raisons, parce qu’ils ont d’abord pour objet la fiction primordiale qui, dans un même mouvement, les constitue et les subvertit.
La portée philosophique du débat ainsi lancé par les textes de Lowry demande à être mesurée avec précision. La question posée est celle du logos, de sa possibilité et de ses conditions d’émergence ; et elle est abordée à partir de l’écrit, c’est”‘à”‘dire de quelque chose qui refuse de se fondre dans le logos (au sens de parole pleine, vive, jaillissante), mais sans quoi le logos (entendu cette fois comme discours raisonné) ne serait pas un objet de pensée, voire cesserait d’exister dans un monde où ce qui se dit ne fait in fine sens que par le truchement de l’écriture. « The novel […] can be regarded as a kind of symphony, or in another way as a kind of opera—or even a horse opera. It is hot music, a poem, a song, a tragedy, a comedy, a farce, and so forth. It is a prophecy, a political warning, a cryptogram, a preposterous movie, and a writing on the wall », écrit Lowry à son éditeur Jonathan Cape à propos de Under the Volcano (506), termes qu’il reprend dans la préface de la première édition française : « Ce roman […] peut être considéré comme une sorte de symphonie, d’opéra, ou même de film de cow”‘boys. J’ai désiré en faire une musique hot, un poème, une chanson, une tragédie, une comédie, une farce et ainsi de suite. […] C’est une prophétie, un avertissement politique, un cryptogramme, un film loufoque, une absurdité, une phrase sur le mur[1] » (31). Ce propos ambigu présente le discours comme sur le point d’être dépassé par la dimension proprement musicale du texte, par le traitement mélodique de la voix tel qu’on le rencontre par exemple à l’opéra ; seule la référence aux modes d’inscription les plus rétifs à la vocalisation (le cryptogramme, les lettres mystérieuses tracées sur le mur du palais de Balthazar) semble garantir la possibilité de l’articulation signifiante. Sans l’écrit, tout est musique, vocalise, symphonie, exploration voluptueuse de la sonorité pure où le mot s’abolit, et avec lui le savoir qu’il transmet. Cela dit, l’écrit ne parvient à sauver le discours qu’en le rendant étranger à lui”‘même et en lui conférant le statut d’énigme : dans sa mystérieuse autonomie, la lettre se présente sous l’aspect d’un signifiant opaque ; message « crypté », elle est la « crypte » où se terre un sens soustrait à l’audition du plus grand nombre. À ce titre, elle est l’opposé de l’Opéra ou de la salle de concert, l’un et l’autre voués à amplifier la résonance de la voix, à en exploiter le potentiel théâtral et la capacité d’interpellation.
L’approche ainsi adoptée par Lowry n’est pas sans présenter des affinités avec celle de son contemporain Heidegger et de certains de ses héritiers, au premier chef Derrida. Comme le note le penseur de La Dissémination dans son commentaire de Platon, l’écrit coupe le discours de son origine et le condamne à errer « comme un hors”‘la”‘loi, un dévoyé, un mauvais garçon, un voyou ou un aventurier » (165) ; aussi la « vérité de l’écriture » ne se distingue”‘t”‘elle pas de « la non”‘vérité » (83) et demeure”‘t”‘elle dans un indécidable entre”‘deux, celui”‘là même, peut”‘être, qu’explore la fiction de Lowry. Du reste, note aussi Derrida, il n’y a pas là l’effet d’un simple hasard, d’une coïncidence qui aurait fait entrer l’humanité dans l’ère de l’écrit alors qu’elle aurait tout aussi bien pu se contenter des formes d’expression orales, puisque « la parole […] est déjà en elle”‘même une écriture » (De la grammatologie 68). C’est pourquoi il prête attention aux analyses de Heidegger pour qui, d’emblée, « la langue ou la parole […] se dédit, […] se défait ou se détraque, […] déraille ou délire, se détériore, se corrompt tout aussitôt et tout aussi essentiellement » (Heidegger et la question 114).
Ce parallèle est instructif, ne serait”‘ce que parce qu’il dissuade de traiter l’obsession du plagiat largement attestée chez Lowry comme le simple effet d’une névrose personnelle : si la confiscation toujours possible d’un « signifiant à la disposition de tout le monde » (La Dissémination 165) et donc susceptible d’être arraisonné par le premier venu joue un tel rôle dans sa réflexion sur la littérature, il ne faut pas rechercher à cela des explications psychologiques, mais y voir l’expression lucide d’une interrogation sur ce qu’il en est de l’esprit humain dès lors que l’homme accepte de se définir, via une tradition écrite, comme un « animal doué de logos ». Cela dit, il importe également de situer précisément le niveau où la question se pose dans les textes de Lowry, et de noter qu’il se distingue de celui où se déploie l’analyse philosophique. Lowry n’examine pas le logos à la lumière d’une réflexion sur « l’écriture » considérée comme un concept problématique (éventuellement voué à produire les conditions de sa propre déconstruction), ni à celle d’une interrogation sur ce qu’« est » le geste d’écrire (quand bien même il en ressortirait qu’il existe entre la pratique de l’écriture et la pensée de l’être une antinomie indépassable). Chez Lowry, il n’y a pas d’écriture, il n’y a que des écrits singuliers, des cas particuliers impossibles à identifier autrement que sur le mode pragmatique : est écriture non ce qui est en adéquation avec une idée générale, mais ce qui fait office de trace lisible dans un contexte donné, sujet à des déterminations concrètes qui ne se retrouvent telles quelles nulle part ailleurs (d’où sans doute le privilège accordé dans son œuvre à la fiction romanesque, où la question de l’écrit n’est abordée qu’en situation). En d’autres termes, il ne s’agit pas d’opposer, aux savoirs fictifs, une compréhension exacte de ce que serait la fiction dont ils seraient tous issus, ni même, à l’instar de Derrida, la prise de conscience du trouble que cette interrogation sème dans toute enquête destinée à clarifier ce qu’il en est au juste du savoir en tant que tel. Il n’y a pas de savoir du particulier, seulement une expérience : l’écrit, chez Lowry, n’est pas l’enjeu d’une réflexion théorétique, mais un objet trouvé que l’on cherche tant bien que mal à s’approprier ; il est une étape d’un parcours de vie singulier et, à ce titre, s’avère indissociable d’un certain rapport au corps, à l’existence concrète de l’individu incarné qu’est le lecteur. Ainsi, même si la fiction apparaît bel et bien dotée d’une valeur épistémologique, ce n’est pas à l’ignorance, à l’incertitude ou à l’erreur qu’elle a in fine affaire, mais à la mort : en dernière analyse, la question du savoir apparaît chez Lowry comme le prolongement d’une interrogation éthique liée au terrible pressentiment de la finitude.
L’énoncé le plus concis de cette problématique se trouve dans « The Plagiarist » (« Le Plagiaire »), un court poème mis en chantier en 1939”‘1940, alors que Lowry termine la première version de Under the Volcano, puis achevé en 1945”‘1946, au moment où il met la dernière main à son grand roman. La deuxième section de ce texte de vingt”‘quatre vers se présente ainsi :
See the wound the upturned stone has left
In the earth ! How doubly tragic is the shape
Swarming with anguish the eye can’t see nor hear.
It is a miracle that I may use such words
As shape. But the analogy has escaped.
Crawling on hands and sinews to the grave
I found certain pamphlets on the way.
Said they were mine. For they explained a pilgrimage
That otherwise was meaningless as day[2].
On observera tout d’abord que ce poème écrit à la première personne du singulier ne doit pas être lu comme un texte autobiographique, même si l’on sait que l’homme Malcolm Lowry vivait dans la peur panique d’être accusé de plagiat (cette crainte était du reste tout sauf irrationnelle puisqu’il avait dû faire face en 1935 aux griefs d’un certain Burton Rascoe, qui lui reprochait à tort ou à raison d’avoir reproduit des passages d’une de ses nouvelles dans Ultramarine [1933], son premier roman ; Bowker 192”‘193). De prime abord, on serait plutôt tenté d’avancer qu’il s’agit du monologue dramatique d’un personnage archétypal, figure d’un drame allégorique à la manière de Robert Browning : le « je » du poème est un masque porté par un acteur dont il dissimule le visage et travestit la voix, il est le déguisement d’un individu qui ne s’appartient plus, puisqu’il n’intervient que pour faire don de sa plume à l’être de fiction qu’il convoque. Tout dissuade en effet de reconnaître une projection du « moi » auctorial dans un poème dont il ressort que se prétendre auteur, c’est avant tout réagir à l’absence de l’autos (et donc à l’impossibilité de l’autobiographie), autrement dit se reconnaître incapable de rien posséder en propre, à commencer par les mots que l’on écrit.
Ainsi, il y a là un masque ; mais quel est”‘il ? La persona adoptée est d’une identification incertaine ; on ne peut en parler qu’en termes négatifs, en indiquant ce qu’elle n’est pas. Le titre précise qu’il s’agit d’un plagiaire, voire du Plagiaire par excellence, mais cela ne rend pas le personnage plus facile à cerner puisque la seule chose que l’on sait de lui, c’est que les termes qu’il emploie ne sont pas les siens. Lyrique non moins que dramatique, le texte recourt ici au discours direct, comme pour donner au lecteur l’illusion d’avoir affaire à la parole authentique d’un sujet dont il recueille sans intermédiaire les désolants aveux. Pourtant, dans le même temps, le poème creuse entre l’énonciateur et l’énoncé un abîme difficile à franchir, de sorte que la teneur de ce qui est avancé ne renseigne pas sur celui qui, ici, dit « je ». Un paradoxe analogue se fait jour dans la première partie du poème lorsqu’un narrateur donne la parole au plagiaire dont les propos sont reproduits entre guillemets, comme dans un dialogue de roman : entreprise étrange si l’on songe que l’on reproche justement au plagiaire de n’avoir rien à dire.
Ce poème se prête à une lecture allégorique, a”‘t”‘on suggéré d’abord ; de fait, l’accent mis sur un type humain plus que sur un individu, l’allusion à un mode de comportement qui interroge de manière générale l’éthique de la littérature rendent cette hypothèse plausible. Pourtant, on s’aperçoit bien vite qu’il convient de la traiter avec une certaine prudence. L’allégorie est une modalité de la mise en rapport, puisqu’elle établit un lien entre deux niveaux distincts de signification ; or c’est ici le travail de la déliaison qui prime. Le poème, de par son sujet, procède à une mise en abyme de la distance qui sépare l’auteur, dépourvu de « soi » et incapable de réflexivité, du personnage au profit duquel il s’efface. Or ce personnage est lui”‘même errant, indistinct, sans identité, exclu de la sphère du langage, en quelque sorte hors « je ». Par principe et sauf exception miraculeuse, les mots lui sont interdits, y compris, suppose”‘t”‘on, le pronom de la première personne : « It is a miracle that I may use such words/As shape » — étrange formulation où le modal « may » dit la permission (accordée par qui ?). L’auteur se cache derrière un masque qui recouvre entièrement son visage ; or ce masque est entièrement lisse : au lieu de donner à voir d’autres traits que ceux de l’instance auctoriale, il montre ce qui demeure quand il n’en reste plus aucun, et le déguisement ne donne pas accès à une identité d’emprunt puisqu’il contribue au contraire à les abolir toutes. Dans ces conditions, on peut sans doute continuer à discerner dans ce texte quelque chose qui s’apparente à une variante de l’allégorie, mais à condition de préciser qu’il dessine ainsi la figure de ce qui justement rend l’allégorie impossible. « The analogy has escaped », note le « je » comme pour diagnostiquer le mal dont souffre un monde où l’on ne peut être sûr de rien, excepté de ce qui s’oppose à toute forme de rapprochement analogique. Certes, la formulation laisse entendre qu’une comparaison existe, même si elle se dérobe : il y a du langage (on le voit bien, puisque le texte est là, sous nos yeux), quelque chose est toujours”‘déjà articulé, ainsi que le suggère aussi la prière du plagiaire qui, au vers 3, s’exclame « Oh Great Articulate[3] », comme pour confirmer qu’au commencement il ya le Verbe. Ce n’est pourtant pas suffisant, car dans ce texte, c’est l’existence des mots qui, paradoxalement, oppose à la volonté de dire l’obstacle le plus infranchissable : le langage est partout sauf là où « je » suis, et « je » ne parviens pas à « m »’en saisir. Par conséquent, l’expérience que « j »’en ai est celle de la désarticulation, de la perte du logos, de l’échec de la ratio entendue comme faculté d’instaurer entre les choses ou entre les mots des rapports de signification.
Dire « m »’est interdit, et pourtant le poème existe : « je » parle. Cette parole ne s’appuie sur rien, excepté sur son propre arbitraire : « Said they were mine ». « Je » « me » donne, en le faisant, le droit de parler, par le truchement d’un énoncé performatif qui pourtant ne fonde rien, si par fondement on entend une assise solide, suffisante pour conférer une légitimité à l’édifice qu’elle soutient. Toute la difficulté naît, on l’a vu, de l’impossible rencontre entre le « je » et le dire ; or dans la phrase où « je » déclare que ces mots sont les « miens », le pronom de la première personne est élidé. Ce tour n’est pas sans évoquer la Verneinung ou dénégation freudienne, par laquelle le sujet oppose un déni vigoureux à une assertion que les termes mêmes auxquels il a recours confirment en sous”‘main : « je » prétends dire, mais en l’occurrence le dire ignore tout du « je », hormis qu’il fait défaut. L’énonciateur recourt à l’image, qualifiée de « tragique », de la pierre arrachée dont l’empreinte demeure visible dans la terre ; de fait, cet adjectif convient très bien à une situation où, via la figure, l’incompatibilité entre le « je » et les mots revient hanter l’énoncé qui, en un geste d’hybris, prétendait les surmonter.
Cette tragédie, on le notera, coïncide avec la naissance d’une fiction, c’est”‘à”‘dire d’un discours dont on ne peut évaluer a priori la capacité à renseigner son destinataire sur le monde extérieur. La phrase« Said they were mine » est l’aveu d’un mensonge, mais elle n’est pas elle”‘même mensongère, puisqu’en la prononçant « je » ne prétends pas faire illusion aux yeux de quiconque, pas même aux « miens » — différence essentielle avec la Verneinung freudienne dont il importe peu que personne ne soit dupe, pourvu que le locuteur demeure sourd à la véritable teneur de ce qu’il a dit. La situation est plus complexe : « j »’admets avoir menti ; en d’autres termes, « j »’apprends à « mon » interlocuteur que « j »’ai affirmé quelque chose que « je » savais inexact, tout en reconnaissant aujourd’hui ce qu’il en était de « mon » mensonge d’alors. Ce brouillage des frontières entre le vrai et le faux signale que « je » me situe en”‘deçà de cette opposition et que par conséquent celle”‘ci ne peut pas s’appliquer au discours que « je » tiens. Ici, le dire n’opère pas sur le mode de l’affirmation, mais sur celui de l’allégation, du reste d’emblée présentée comme douteuse : faut”‘il « me » croire quand « je » reconnais avoir menti, puisque « je » « me » présente du même coup comme quelqu’un dont les propos ne sont pas dignes de foi ? Un certain scepticisme semble être ici de mise, réaction naturelle à une parole dont il est impossible d’évaluer a priori la fiabilité puisqu’elle ne s’autorise que d’elle”‘même, de l’activité d’un énonciateur dépourvu de toute autorité, y compris sur les mots qu’il profère. Cela ne signifie pas nécessairement que cette parole soit irrationnelle ni absurde ; au contraire, un lecteur de Stanley Cavell observerait sans doute qu’elle est incertaine précisément parce qu’elle met à nu l’ambition exorbitante avec laquelle le discours de la raison, y compris sous les formes non poétiques du langage commun, se prétend en prise sur les choses (Domenach 503). Comme le note Cavell, il est toujours possible de douter de la véracité de tout ce qui se dit — a fortiori quand ce dire est ouvertement paradoxal, comme c’est le cas dans ce texte — car notre relation première au monde n’est pas fondée sur la certitude, sur l’appréhension intellectuelle et l’énoncé du vrai, mais sur la reconnaissance qu’il existe quelque chose en dehors de nous : « the human creature’s basis in the world as a whole, its relation to the world as such, is not that of knowing, anyway not what we think of as knowing » (241)[4]. En d’autres termes, si fiction il y a dans le poème de Lowry, celle”‘ci pourrait bien se retrouver, moins visible certes mais sous une forme identique, dans toute parole quelle qu’en soit la teneur — de sorte que tout logos se déploie sur fond de ce qui échappe au logos, et que la question préalable à l’émergence du savoir même le plus avéré n’est pas épistémologique, mais métaphysique, puisqu’elle touche aux limites de notre être.
On note bien, du reste, que l’enjeu ne consiste pas, chez Lowry, à disqualifier la cognition, mais plutôt à la mettre à sa juste place. « […] [T]hey explained a pilgrimage/That otherwise was meaningless as day », notent les deux derniers vers — formulation intéressante puisque la lumière du jour est, au moins depuis Platon, une des métaphores stéréotypées du vrai. Ici, le voir, à lui seul, est dépourvu de valeur épistémologique : il faut encore qu’il y ait les mots (les écrits, « certain pamphlets »), et surtout que ces mots soient revendiqués par un « je », acteur du « pèlerinage » qu’ils sont censés expliquer. Savoir, c’est expliquer le vécu singulier de l’individu en le rapprochant des principes généraux que véhicule le langage, lui qui, tout comme Dieu, est de tous temps et de tous lieux (« Oh Great Articulate, everywhere abroad[5] », implore le plagiaire dans la première partie du poème). La fiction a pour fonction problématique d’opérer cette mise en rapport, de relier ce que je vis dans mon corps (« hands and sinews ») à ce qui se dit ailleurs sans que « j »’y sois nommément désigné. À strictement parler, cette tâche est impossible puisque, comme on l’a vu, il n’a dans le discours de rapport, de ratio ou de logos que sur fond d’écart irréductible, d’arraisonnement du verbe au profit de l’énonciateur que sur fond d’une désappropriation sans appel. Pourtant, cela ne dissuade ni ne dispense d’essayer. A minima, à défaut de parvenir à comprendre qui « je » suis, il « me » reste toujours la ressource de chercher à savoir ce qu’il en est de cet échec, d’expliquer comment « je » m’y suis pris pour tenter de me rapprocher du but et d’identifier les obstacles rencontrés en chemin. Dans le poème de Lowry, ce retour réflexif justifie l’emploi du prétérit qui marque la distance entre l’instant évoqué (celui où « je » revendique certains écrits comme « miens ») et l’instant de l’énonciation, celui où son évocation a lieu : « Said they were mine ». Non seulement le texte attire ainsi l’attention sur le lien indissoluble entre savoir et fiction, mais il suggère que cette fiction est nécessairement narrative puisqu’elle postule — hypothèse risquée, le poème le montre bien — l’existence d’un « je » à qui arrive d’abord une chose, puis l’autre. Par fiction narrative, l’on n’entend pas forcément le récit romanesque ni quoi que ce soit que l’on puisse enfermer dans les limites d’un genre littéraire prédestiné, le cas de ce poème lyrique le prouve. Cette formulation renvoie plutôt à la narration embryonnaire que tout discours comporte dès lors qu’il opère un retour explicite sur les moments successifs de sa propre élaboration. En ce sens, le récit romanesque n’est pas une modalité parmi d’autres de l’expression verbale, mais la tentative délibérée de pousser plus avant l’exploration d’une voie ouverte dès lors qu’il y a parole ; il est l’effort accompli en vue de compenser l’impossibilité ou l’échec du dire au moyen d’un discours qui, a contrario, dit cette impossibilité même.
On notera que, dans le texte de Lowry, tout cela passe avant tout par l’écriture. Non que le « je » soit plus légitime quand il se fait entendre dans le discours oral, ni que les mots « m »’appartiennent davantage quand je les prononce au lieu de manier la plume : le texte parle bien de ce qui se passe quand « je » fais usage des mots (« that I may use such words »), sans autre précision. Cela dit, en établissant de manière incontestable que le langage est un objet trouvé, telle la pierre arrachée au sol, l’écrit favorise le retour réflexif sur ce qui permet ou freine son appropriation. C’est ce que suggère la première partie du poème :
The fake poet sat down in his gilt
Took borrowed plume and wrote this humble verse.
« Oh Great Articulate, everywhere abroad,
To whom the soaring bridge and symbol road
Are attestation, […]
Some oblique and unique greatness yield
To him who plagiarised a book on stealing[6]. »
Les deux vers sur lesquels se termine ce passage font entendre le premier aveu du plagiaire, à distance de l’expression « Said they were mine » qui dès lors sonne comme un ajout ou une explicitation. On notera que cette « humble » évocation d’un crime relatif à l’écriture a pour particularité de faire elle”‘même appel à la médiation de l’écrit ; la faute est donc répétée en même temps qu’avouée puisque le scripteur manie une plume d’emprunt, « borrowed plume ». Ainsi, le texte achève de tracer un cercle vicieux dans lequel la seconde reconnaissance de culpabilité, « Said they were mine », ne s’inscrit pas avec la même évidence : « je » mens, puis « j »’admets que « j »’ai menti, mais cet aveu est à nouveau un mensonge qu’il va falloir avouer à son tour, etc. — situation qui non seulement oblige à recourir à la narration (puisque les retournements qui la définissent ne peuvent être évoqués que successivement), mais qui, de surcroît, impose à ce récit de tourner en rond. Surtout, « je » suis bien obligé de reconnaître à cette occasion que le plagiat « me » permet d’exister et, simultanément, « me » renvoie au néant. Par définition, le plagiaire s’attribue abusivement la paternité d’un écrit ; par conséquent, il n’est pas stricto sensu coupable de plagiat quand il se contente de parler (même si les mots qu’il emploie ne sont pas les siens), ce qui pourrait faire accroire qu’il « m »’est possible de « m »’exprimer en mon propre nom. En revanche, l’écriture ne connaît que des mots empruntés ; le « je » lui”‘même n’y a d’existence qu’oblique (« some oblique and unique greatness yield ») comme si elle n’admettait que l’oratio obliqua, appellation du discours indirect dans la rhétorique classique. Le sujet — c’est à cela sans doute qu’on le reconnaît — revendique son unicité, celle du monarque qui va s’asseoir sur son trône doré (« gilt ») pour y jouir de sa solitude grandiose. Il n’en reste pas moins que ce terme anglais désigne ce qui n’a de l’or que la surface, mais non l’épaisseur substantielle : la royauté dont il s’agit est factice (« fake »), et l’éclat dont le « je » impérial s’environne n’est que le rayonnement visible de la faute (« guilt », homophone de « gilt ») qui le constitue. En d’autres termes, c’est l’écriture qui, le plus clairement, révèle que l’on ne peut espérer acquérir un savoir du « je », et cela pour la bonne raison que le « je » n’existe pas : il se présente comme l’effet d’une action qui suscite un sentiment de culpabilité et non comme une entité susceptible d’être pris en compte de manière autonome. Pas de « je » sans écriture, a”‘t”‘on dit, mais pas d’écriture qui, du même coup, ne vise à expulser le « je » de la sphère de l’être, ou si l’on préfère qui n’œuvre à sa mise à mort : « Crawling on hands and sinews to the grave », note l’énonciateur — expression ambiguë puisque ramper (« crawling »), c’est se déplacer comme le jeune enfant qui n’a pas encore appris à marcher, mais c’est aussi, dans ce poème, le dernier geste du mourant.
Entre ce qui apparaît à la lecture de « The Plagiarist » et Under the Volcano, les analogies sont frappantes. Tout d’abord, le roman développe une narration circulaire, construite de telle sorte que le premier chapitre fait office d’épilogue autant que d’introduction : il se déroule un an après les faits racontés dans les onze suivants ; ainsi, la dernière page renvoie à la première et la lecture est vouée à demeurer interminable. Deuxièmement, cette structure cyclique apparaît liée à l’enfermement du protagoniste dans une culpabilité sans nom ni cause assignable qui dépasse par son intensité tout ce que le récit de sa vie semble justifier ; liée au simple fait d’exister plutôt qu’au souvenir d’une action précise, la conscience de la faute est notamment figurée par une usurpation d’identité, puisque celui que la narration appelle le Consul n’a plus le droit de porter ce titre depuis que la Grande”‘Bretagne, son pays, a rompu ses relations diplomatiques avec le Mexique où il réside. Troisièmement, le récit ainsi structuré a pour sujet l’interminable destruction d’un sujet, sa mise à mort progressive — assassinat ou suicide, on ne sait, puisque les événements qui le mènent à sa perte se présentent à la fois comme une série de tragiques injustices et comme l’effet d’une entreprise d’auto”‘destruction délibérée. En même temps, la narration met l’accent sur sa remarquable résilience : le personnage dont il s’agit n’a pas d’autre mode d’existence que son épuisement même ; en persévérant dans la voie qui mène à la perte de soi, il persévère dans l’être, comme s’il n’y avait pas pour lui de différence entre ce qui le tue et ce qui le fait exister. Enfin, tout cela apparaît lié, dans Under the Volcano, au rapport que le protagoniste entretient avec l’écriture, clef d’un savoir fictif qui se substitue à l’appréhension de l’inconnaissable. « [I]t is perhaps a good idea under the circumstances to pretend at least to be proceeding with one’s great work on “Secret Knowledge,” then one can always say when it never comes out that the title explains this deficiency[7] », note”‘t”‘il dans une lettre à son épouse Yvonne (39) — aveu désabusé d’une pratique du faux”‘semblant qui recourt à une science fictive pour justifier, sous couvert de logique, l’impossibilité du dire.
Au chapitre III de Under the Volcano, le Consul feuillette avec Yvonne un magazine d’astronomie, discipline qu’elle a étudiée à l’Université de Hawaii.
A magazine she’d been reading dropped to the floor. […] The magazine was the amateur astronomy one she subscribed to and from the cover the huge domes of a observatory, haloed in gold and standing out in black silhouette like Roman helmets, regarded the Consul waggishly. « The Mayas, » he read aloud, « were far advanced in observational astronomy. But they did not suspect a Copernican system. » He threw the magazine back on the bed and sat easily in his chair, crossing his legs, the tips of his fingers meeting in a strange calm, his strychnine on the floor beside him. « Why should they ? . . . What I like though are the “vague” years of the old Mayans. And their “pseudo years,” musn’t overlook them ! And their delicious names for the months. Pop. Uo. Zip. Zotz. Tzec. Xul. Yakin. »
« Mac, » Yvonne was laughing. « Isn’t there one called Mac ? »
« There’s Yax and Zac. And Uayeb : I like that one most of all, the month that only lasts five days. »
« In receipt of yours dated Zip the first !— »
« But where does it all get you in the end ? » The Consul sipped his strychnine […]. « The knowledge, I mean. One of the first penances I ever imposed on myself was to learn the philosophical sections of War and Peace by heart. That was of course before I could dodge about in the rigging of the Cabbala like a St. Jago’s monkey. But then the other day I suddenly realised that the only thing I remembered about the whole book was that Napoleon’s leg twitched — » (81”‘82)[8]
Dans ce passage, se rencontrent plusieurs savoirs au statut apparemment très différent, au fil d’une énumération qui chemine du plus incontestable au plus incertain, de la certitude positive au questionnement le plus hasardeux. Tout d’abord, le magazine évoque la science astronomique des anciens Mayas, qu’il compare avec bienveillance à celle des Occidentaux modernes (figurée par les dômes de l’observatoire et par l’allusion au système copernicien). La narration en profite pour mentionner les connaissances d’ordre anthropologique sur lesquelles ces mêmes Occidentaux s’appuient pour aborder les cultures étrangères et le passé lointain. Ce savoir au second degré, qui relève de l’histoire des idées scientifiques, semble tout aussi fiable que les compétences des astronomes mayas puisque le Consul se montre capable de réciter par cœur leur calendrier et d’en décrire avec précision les particularités. Le personnage évoque ensuite sa connaissance d’un corpus ésotérique dont le Zohar est la pièce maîtresse. Un glissement s’opère ici, de l’histoire des sciences à celle des idées religieuses : en effet, le savoir révélé que transmet la Kabbale n’est pas scientifique, ni au sens des modernes, ni à celui des Mayas car il n’est pas fondé sur l’observation, à la différence de l’astronomie précolombienne. Cela dit, le Consul dit la connaître aussi bien que le calendrier maya ; plusieurs fois évoquées dans le roman, ses connaissances en matière de philologie hébraïque sont présentées comme tout à fait sûres. Enfin, au terme de cette gradation, le personnage évoque sa fréquentation de la littérature et s’attarde sur un cas particulier, celui de Guerre et Paix. C’est alors que, pour la première fois, ses connaissances sont prises en défaut : le roman de Tolstoï confronte cet esprit encyclopédique à une limite, qui est d’abord celle de ses facultés de mémorisation.
Il n’est sans doute pas indifférent que la question de la mémoire se pose à propos d’un texte littéraire, c’est”‘à”‘dire d’un ouvrage qui doit sa légitimité culturelle au rapport réflexif qu’il entretient avec sa propre nature de document écrit, à la différence par exemple de l’article de journal dont la fonction se résume à transmettre des informations pertinentes : ici se laisse percevoir un écho du Phèdre de Platon, et notamment du célèbre passage où le roi d’Égypte, devant la nouvelle invention qu’est l’écriture, s’inquiète de l’amnésie qu’elle risque de causer parmi les humains. Qui plus est, la littérature est représentée en l’occurrence par un roman historique riche en développements philosophiques, autrement dit par un récit qui, à l’intrigue inventée, mêle une part de vérité (par exemple en évoquant Napoléon), et qui fait de ce mélange l’occasion d’un questionnement explicite sur le rapport entre savoir, logos et fiction. Ici se joue le drame du Consul qui, malgré ses qualités de lecteur, se découvre incapable de s’approprier ce que l’écriture articule, et qui par conséquent doit se satisfaire des aléas d’une existence corporelle dont les dérèglements pathologiques annoncent sa mort inévitable (« Napoleon’s leg twitched », se remémore”‘t”‘il en sirotant la boisson à base de strychnine que son demi”‘frère Hugh lui a recommandée dans le vain espoir de soigner son alcoolisme).
Ce moment ne marque pas seulement le terme d’une progression soigneusement ménagée ; c’est aussi celui où devient explicite une interrogation déjà présente aux étapes antérieures. A posteriori, on s’aperçoit en effet que tous les autres savoirs énumérés dans ce passage ont eux aussi trait aux diverses modalités de l’écriture. Autant qu’une mystique, la Kabbale propose une herméneutique ; elle illustre une approche de l’Écriture sainte que gouverne le rapport à la lettre, d’où la pratique de la gematria à laquelle le Consul fait allusion dans d’autres passages du roman. Quant aux plaisanteries d’Yvonne sur le calendrier maya, elles reposent sur la combinaison humoristique de noms de mois pour le moins exotiques avec les formules toutes faites de la correspondance d’affaires (« In receipt of yours dated Zip the first ! — »). Cela n’a rien pour surprendre puisque l’astronomie est d’abord évoquée par le truchement d’un magazine illustré dont le Consul cite un extrait à voix haute : le savoir scientifique se trouve donc associé dès l’abord à la maîtrise de la lecture, censée permettre à quiconque en dispose de s’approprier ce qui est écrit et de l’incorporer à son propre discours. En fin de compte, il n’y a dans ce passage de savoirs que médiatisés par l’écriture, ce qui suggère que les inquiétudes suscitées par le travail littéraire de la lettre ne sont pas sans conséquences pour eux tous : à un certain niveau, il n’y a pas de différence entre ce qui reste du propos philosophique développé dans Guerre et Paix et ce que nous savons de la course des astres, car tout cela, du discours de vulgarisation (« amateur astronomy ») à la réflexion la plus ésotérique, est renvoyé par l’action corrosive de l’écrit au statut de construction incertaine, à l’instar des « pseudo”‘années » et des mois de cinq jours qui confèrent au calendrier maya, pourtant fondé sur l’observation du ciel, l’allure d’une divertissante fiction borgésienne.
« But where does it all get you in the end ? » demande le Consul. « The knowledge, I mean. » (82) « Cui bono ? » (« À quoi bon ? ») interroge à son tour Hugh au chapitre IV (102) en écho à un célèbre passage de Cicéron (Ackerley & Clipper 157). Questions rhétoriques, car ce que le texte montre, c’est que le savoir n’est pas tout, ni même peut”‘être l’essentiel. Ce n’est sans doute pas un hasard si, du grand roman de Tolstoï, les souvenirs du Consul ne retiennent qu’un fragment infra”‘signifiant, le tressautement nerveux d’une jambe, notation invérifiable qui, à la manière d’un effet de réel, renseigne moins sur tel ou tel aspect de la campagne de Russie qu’elle ne renvoie, sans autre précision, à l’existence du monde où la littérature va puiser de quoi donner forme à ses fictions. Synecdoque d’une expérience de vie, la jambe de Napoléon est aussi l’illustration exemplaire de la résistance qu’oppose le particulier à la généralisation ; elle interrompt la continuité du discours narratif ou argumentatif et, dans ce roman qui propose une vision panoramique de l’histoire enfin rendue intelligible, elle traduit l’insistance avec laquelle le détail dans sa singularité excède toutes les interprétations pour se graver seul dans la mémoire du lecteur, abstraction faite du contexte susceptible de lui donner un sens. En d’autres termes, renvoyée par les souvenirs imprécis du Consul à son statut d’objet trouvé, cette vision fugitive n’est pas sans présenter des affinités avec la lettre, avec la marque inscrite sur la page, qui certes peut se prêter au travail de l’interprétation à condition qu’elle soit comprise comme l’un des éléments d’une articulation signifiante, mais qui se présente par ailleurs comme un tracé singulier, doté d’irréductibles idiosyncrasies en vertu desquelles elle fournit la matière d’une expérience plutôt que d’un savoir. Dès le chapitre I, la narration prend soin de signaler que le destin du Consul est d’abord celui de l’écrit et que les vrais héros de ce roman ne sont autres que les signes dont le texte se compose, à la faveur d’un jeu sur le mot anglais « character » qui désigne à la fois le « personnage » et le « caractère d’imprimerie » : « [T]here was no mistaking […] the hand, half crabbed, half generous, and wholly drunken, of the Consul himself, the Greek e’s, flying buttresses of d’s, the t’s like lonely wayside crosses save where they crucified an entire word, the words themselves slanting steeply downhill, though the individual characters seemed as if resisting the descent, braced, climbing the other way. » (35)[9] Jacques Laruelle se fait cette réflexion alors qu’il cherche, en parcourant de vieux papiers, à comprendre ce qui a causé la perte de son ami disparu un an plus tôt ; comme le signale l’allusion à la Grèce, son ambition est d’élaborer un savoir de la tragédie, d’en faire le moment spéculatif d’un parcours qui, à l’instar de la Crucifixion, se donne l’absolu pour horizon. Cela dit, sa remarque signale aussi que l’écrit est toujours du côté du singulier, du reste irrécupérable qui subsiste à l’issue de toute tentative d’interprétation : du « e » grec (« ε ») à son équivalent latin, la différence ne se laisse pas expliquer par l’écart entre deux significations, mais par le rapport particulier du corps écrivant (« hand ») à la lettre dans sa matérialité, par les modalités concrètes de la rencontre entre un individu promis à la mort et les marques qu’il découvre au bord de la route (« wayside crosses »), à charge pour lui de s’y retrouver ou de s’y perdre. « Crawling on hands and sinews to the grave » : c’est bien cela, disait déjà « The Plagiarist », qui définit d’abord le trajet incertain de la fiction.
Annexe
« The Plagiarist »
The fake poet sat down in his gilt
Took borrowed plume and wrote this humble verse.
“Oh Great Articulate, everywhere abroad,
To whom the soaring bridge and symbol road
Are attestation, and to whom the ship is
As a poem man wrote to the sea
Dedicated to man’s trade and foundering,
As a poem and—multitudinously inscribed—
To the ubiquitous foundering of man
And if my heart refused to freeze in a rhyme,
At least my suffering was not more fake than iron.
Some oblique and unique greatness yield
To him who plagiarised a book on stealing.”
Who exhausted not its usefulness at once
In that it serves us as a symbol of life and death.
See the wound the upturned stone has left
In the earth! How doubly tragic is the shape
Swarming with anguish the eye can’t see nor hear.
It is a miracle that I may use such words
As shape. But the analogy has escaped.
Crawling on hands and sinews to the grave
I found certain pamphlets on the way.
Said they were mine. For they explained a pilgrimage
That otherwise was meaningless as day.
(204-205)
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. X
Ouvrages cités
Ackerley, Chris, et Lawrence J. Clipper, A Companion to Under the Volcano, Vancouver, UBC Press, 1984.
Bowker, Gordon, Pursued by Furies : A Life of Malcolm Lowry, Londres, HarperCollins, 1993.
Cavell, Stanley, The Claim of Reason : Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford, Oxford University Press, 1979.
Derrida, Jacques, De la grammatologie, Paris, Minuit, 1967.
———, Heidegger et la question. De l’esprit et autres essais, Paris, Flammarion, 1990 (1987).
———, La Dissémination, Paris, Seuil, 1972.
Domenach, Élise, « Stanley Cavell : les chemins de la reconnaissance », Revue Philosophique de Louvain 96-3 (1998), pp. 496-511.
Lowry, Malcolm, Au”‘dessous du volcan, Stephen Spriel (trad.), Paris, Gallimard, 1959 (1947).
———, lettre à Jonathan Cape du 2 janvier 1946, Sursum Corda ! The Collected Letters of Malcolm Lowry, Sherrill E. Grace (éd.), vol. 1 (1926”‘1946), Londres, Jonathan Cape, 1995, pp. 498”‘528.
———, « The Plagiarist », The Collected Poetry of Malcolm Lowry, Kathleen Scherf (éd.), Vancouver, UBC Press, 1992, pp. 204”‘205.
———, « Préface », Au”‘dessous du volcan, Stephen Spriel (trad.), Paris, Gallimard, 1959 (1948).
———, Under the Volcano, Londres, Picador, 1990 (1947).
[1] Devenue proverbiale, l’expression anglaise « writing on the wall » fait directement référence à l’épisode biblique du festin de Balthazar (Dn 5:1”‘34), ce que la traduction française ne laisse qu’imparfaitement percevoir.
[2] « Voyez la blessure que la pierre retournée a laissée / dans la terre ! Qu’elle est tragique, doublement tragique, cette forme / où pullule une angoisse que l’œil ne voit ni n’entend. / C’est un miracle qu’il me soit permis d’employer des mots / tels que “forme”. Mais l’analogie s’est enfuie. / Alors qu’à la force du poignet, les muscles bandés, je me traînais jusqu’à la tombe / je trouvai certains opuscules sur mon chemin. / Déclarai qu’ils étaient miens. Car ils expliquaient un pèlerinage / qui autrement était aussi dénué de sens que la lumière du jour. » (Ma traduction)
[3] Cette expression est difficile à traduire. En anglais, « articulate » est un adjectif qualifiant une personne qui s’exprime avec aisance. Ici substantivé, il désigne le « Grand Orateur » divin, à cette réserve près que le terme « articulate » fait étymologiquement référence à l’articulation signifiante, ce qui n’est pas le cas de cette traduction possible.
[4] « [L]es relations de la créature humaine au monde dans sa totalité, son rapport au monde en tant que tel, ne se fondent pas sur la connaissance, du moins pas au sens où nous entendons ce terme » (ma traduction).
[5] « Everywhere abroad » = « présent de toutes parts ».
[6] « Le faux poète s’assit parmi ses dorures / se saisit d’une plume empruntée et écrivit ces humbles vers. / “Oh Grand Orateur, présent de toutes parts, / dont le pont qui s’élance vers le ciel et la route symbolique attestent l’existence, / […] accorde quelque grandeur, oblique et unique. / à celui qui plagia un livre sur le vol.” » (Ma traduction)
[7] « [C]’est une bonne idée peut”‘être, vu les circonstances, de feindre pour le moins de poursuivre son grand travail sur le “Savoir Secret” car on peut toujours dire, s’il ne paraît jamais, que le titre en explique l’absence. » (Au”‘dessous du volcan 93)
[8] « Un magazine qu’elle lisait tomba par terre. […] Le magazine était cette revue d’astronomie d’amateurs à laquelle elle était abonnée, et de dessus la couverture les dômes énormes d’un observatoire, détachant en noir leur silhouette de casques romains auréolés d’or, lorgnaient le Consul gouailleusement. “Les Mayas,” luit”‘il tout haut, “étaient fort avancés dans l’astronomie d’observation. Mais ils ne soupçonnaient pas l’existence d’un système de Copernic.” Il rejeta le magazine sur le lit et s’assit à l’aise, jambes croisées, les bouts des doigts unis dans un calme singulier, sa strychnine à terre près de lui. “Pourquoi l’auraient”‘ils soupçonnée ?… Mais ce que j’aime, ce sont les années “vagues” des vieux Mayas. Et leurs “pseudo”‘années”, faut pas rater ça. Et leurs délicieux noms de mois. Pop. Uo. Zip. Zotz. Tzec. Xul. Yaxhin.” / “Mac”, Yvonne riait. “N’y en a”‘t”‘il pas un appelé Mac ?” / “Il y a Yax et Zac. Et Uayeb : j’aime entre tous celui”‘là, le mois qui ne dure que cinq jours.” / “Au reçu de votre honorée en date du 1er Zip ! —” / “Mais où nous mène tout cela en fin de compte ?” Le Consul buvait à petits coups sa strychnine […] “Le savoir, je veux dire. L’une des premières pénitences que je me sois jamais imposées fut d’apprendre par cœur la partie philosophique de La Guerre et la Paix. Bien sûr c’était avant que je ne puisse voleter de”‘ci de”‘là dans les agrès de la Kabbale comme un singe de St. Iago. Mais voilà que l’autre jour je me rends compte soudain que la seule chose que je me rappelais de tout le livre, c’est que Napoléon avait un tremblement dans la jambe…” » (Au”‘dessous du volcan 158”‘159)
[9] « [I]l n’y avait point à se méprendre, même dans la clarté indécise, sur l’écriture mi”‘ample mi”‘recroquevillée, et totalement ivre, du Consul lui”‘même, les e grecs, les d en arcs”‘boutants, les t comme des croix solitaires au bord de la route, sauf quand ils crucifiaient tout un mot, les mots mêmes dégringolant une côte à pic, quoique chaque lettre à part parût résister à la pente et, se raidissant, grimper en sens contraire. » (Au”‘dessus du volcan 86)