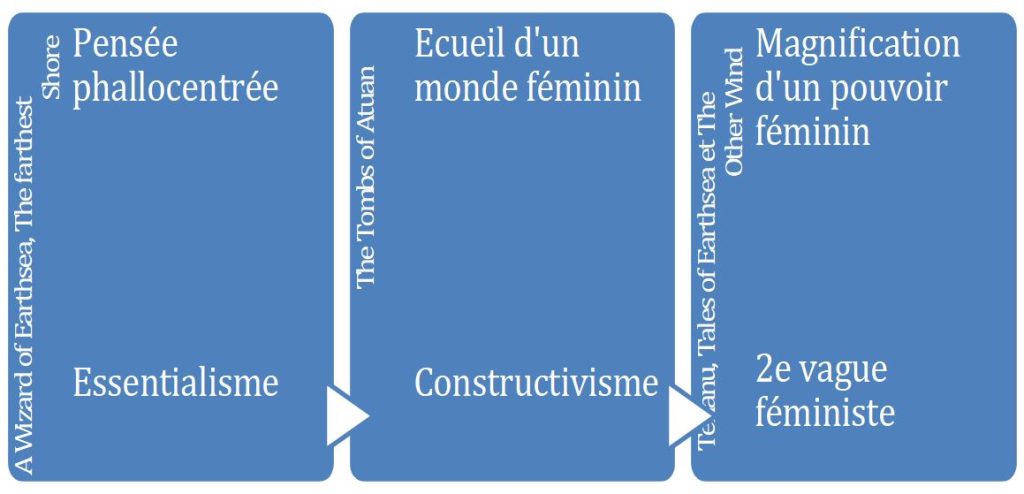11-Fatigue et repos des lettres. Travail, littérature, relecture
En engageant nos corps, les pratiques littéraires s’inscrivent dans un contexte économique et écologique particulier, aujourd’hui profondément marqué par le capitalisme néolibéral. Ce contexte promeut un usage éphémère du texte où la lecture, vécue comme production-consommation, s’accélère pour permettre une accumulation de connaissances et d’expériences. La littérature travaille; elle devient un travail. Mais elle s’affirme également, parfois, comme une activité non-rentable, synonyme de repos, voire de perte ou à tout le moins d’une certaine forme de stabilité. À cette relation travail / repos se superpose une autre, plus écosystémique : celle entre le jour, moment de l’effort et de l’accomplissement, et de la nuit, moment de paresse, de sommeil, de rêve.
Cet article prolonge la critique historique des rythmes imposés au vivant par la modernité industrielle, notamment capitaliste (mais pas que : la célébration du travail et de la productivité du stakhanovisme soviétique peut en témoigner). Cette critique s’énonce déjà au XIXe siècle avec Le Droit à la paresse de Paul Lafargue (1880) et prend les formes les plus diverses au siècle suivant : au cinéma avec Charlie Chaplin et son film Modern Times (1936), dans la gastronomie avec le mouvement slow food fondé par Carlo Petrini en 1986, ou dans le roman avec La lenteur de Milan Kundera (1995). Elle s’amplifie depuis la dernière décennie, à travers des publications telles qu’Alienation and acceleration de Hartmut Rosa (2010), La société de la fatigue de Byung-Chul Han (2010), Global burn-out signé par Pascal Chabot (2013), The slow professor cosigné par Maggie Berg et Barbara Seeber (2016), ou tout récemment Les hommes lents de Laurent Vidal (2020), et De si violentes fatigues de Romain Huët (2021). Nous nous proposons de reconsidérer notre rapport à la littérature à la lumière de cette critique. C’est en ce sens que nous envisagerons des rapports plus lents à la littérature, notamment la relecture, qui font du texte un espace habitable protecteur.
I. Régimes du travail et de l’épuisement infinis
Comme l’a étudié Roger Ekirch (2015), l’endormissement a une histoire : soumises à des forces sociales et économiques, les pratiques humaines de sommeil ont muté au fil du temps. Une des grandes transformations chez les dormeurs occidentaux, mise au jour par l’historien, est la transition d’un sommeil segmenté (biphasique) à un sommeil consolidé (monophasique). L’effet principal de cette transition serait la catégorisation de l’insomnie comme trouble ou maladie, alors qu’elle correspondrait plutôt à une manière de dormir ancestrale. Dans la mouvance de ces sleep studies, Jonathan Crary (2014) dénonce quant à lui une mutation brutale dans les vies humaines : celle de la perpétuité de la vie active, et la fin du repos, du sommeil et du rêve. Dans sa volonté de domestication biopolitique des corps et des populations, le régime du 24/7 ne saurait endurer la différence que représentent les rythmes circadiens, des rythmes géologiques et biologiques pourtant partagés par la quasi-totalité des choses sur Terre. Pour Crary, la corruption du sommeil et du corps par le travail atteint un point de non-retour avec les lumières du 18e siècle – celles littérales des lampes à gaz comme celles métaphoriques du libéralisme philosophique – qui permettent, intiment de travailler sans fin. Nous voici donc propulsés dans une nouvelle ère, une nouvelle version de l’éternité, réglée sur l’économie de marché.
L’informatisation et le développement des réseaux de radio, de télé, et l’étendue toujours grandissante du world wide web ont exacerbé le devenir infini du travail. L’employé peut, doit dorénavant travailler à toute heure du jour et de la nuit, alors que de plus en plus d’activités ont été ajustées pour transcender les fuseaux horaires d’une planète qui ne dort jamais complètement. Le roman d’anticipation de Cory Doctorow, Eastern Standard Tribe (2004), pousse cette logique jusqu’à imaginer un monde socioéconomique progressivement restructuré par des tribus d’individus qui échappent aux contingences de la géographie en ajustant leur rythme circadien à celui d’un fuseau horaire auquel ils s’identifient. Cette « libération » des rythmes circadiens permet aux systèmes gestionnaires d’envisager le travail permanent, dont le corolaire est la consommation permanente. Celle-ci n’est-elle pas d’ailleurs devenue l’utilité principale d’Internet, une forme technique qui favorise la transformation de la consommation en travail ? Contrairement aux commerces du quartier, Amazon, Cairn.info et Netflix sont ouverts à perpétuité. Nous avons intériorisé, au nom du progrès et de l’innovation technique, les contraintes, les impératifs et les rythmes du capitalisme contemporain, une nouvelle économie du travail qui renforce le caractère destructeur d’une compétition dérégulée, libérée des contraintes physiques et biologiques du cycle diurne-nocturne.
Une telle posture s’accorde bien avec la thèse connue de Max Weber selon laquelle, dans l’Europe luthérienne et calviniste des 16e et 17e siècles, « la valorisation religieuse du travail du métier temporel, exercé sans relâche et de façon permanente et systématique, est tenue pour le moyen suprême de l’ascèse » et constitue une condition de l’expansion de « l’esprit du capitalisme » (2008, 286). La valorisation de l’activité constante, du travail systématique et sans repos, participe ainsi à l’émergence du capitalisme industriel au 18e siècle. Si le contexte religieux local nourrit son développement, celui-ci est également tributaire du commerce triangulaire qui s’érige alors en système global venant encadrer une course à la productivité entre les nations d’Europe occidentale. Le rythme soutenu et toujours plus frénétique de cette course sera importé sur les autres continents et imposé à leurs populations dites « paresseuses »; elle marquera notamment l’industrie sucrière coloniale qui, dès le 17e siècle, développe des techniques de division et d’organisation du travail qui serviront de modèle aux manufactures européennes (Mintz 1986, 47). On pourrait ainsi mettre en continuité, en prenant soin de ne pas les confondre, les rythmes machiniques imposés aux esclaves dans les plantations de canne à sucre des Caraïbes, à ceux qui ont été imposés aux ouvriers des usines au 19e siècle – et qui demeurent aujourd’hui la source de nombreux conflits de travail. D’ailleurs ce n’est pas un moindre paradoxe que dans le capitalisme actionnarial postindustriel, les personnes-cadres s’imposent à elles-mêmes ces rythmes de travail jusqu’à l’épuisement (Chabot 2013, 13). Dans son analyse des sociétés gestionnaires, Vincent De Gaulejac note à ce sujet que « [l]e gestionnaire ne supporte pas les vacances. Il faut que le temps soit utile, productif, donc occupé. Le désœuvrement lui est insupportable » (2009, 83). Si l’« occupation » est déjà promue comme une vertu dans la culture monastique médiévale (Piron 2018, 15-16), et qu’un manuel du 16e siècle destiné au « gentilhomme campagnard » lui recommande de s’assurer que ses « gens ne demeurent oisifs et ne perdent pas une minute de temps sans l’appliquer à quelque besogne » (cité dans Vigarello 2020, 83), c’est bien l’ordre temporel productiviste qui se généralise avec l’organisation moderne du travail qui bouleverse le mode de vie de plus larges pans de la population. Ce nouvel ordre temporel va jusqu’à modifier notre manière de dormir et de vivre la nuit : dans un grand mouvement d’encadrement et de régulation du sommeil, les humains occidentaux aujourd’hui dormiraient en moyenne trois heures et demie de moins par nuit qu’il y a un siècle1. Ceci peut expliquer non seulement pourquoi nous sommes si fatigués (!), mais également le foisonnement de politiques de santé au travail qui insistent sur la qualité de vie. Un employé en santé, qui dort bien, est un employé lucratif : le bien-dormir est alors mis au service de la productivité et strictement adapté à la réalité du travail.
II. Les lettres dans le tourbillon du travail perpétuel
Les pratiques littéraires ne sont pas à l’abri de cette idéologie du travail et de l’épuisement. Un exemple bien connu : Gustave Flaubert associant son art à un dur labeur. Ses correspondances sont criblées de références à l’acharnement avec lequel il abat le travail, y compris ce conseil (souvent cité) à Louise Colet, formulé quelques années avant la rédaction de Madame Bovary : « on n’arrive au style qu’avec un labeur atroce, avec une opiniâtreté fanatique et dévouée » (Barthes 1968, 49). Ailleurs, Flaubert se plaint des journées peu productives, ou de ces centaines de pages de notes préparatoires.
Contemporain de Flaubert, l’américain Henry David Thoreau valorise également un rapport à l’art et à la culture placé sous le signe de l’effort conscient et de l’activité rentable. Personnage ambigu, Thoreau est à la fois une figure emblématique du self-made man (cet homme productif, libéral et démocratique qui réussit sa vie grâce à ses propres efforts et qui contribue à la formation de l’Amérique), et un oisif, ascétique, et environnementaliste assumé. Pourtant, dans Walden, Thoreau inféode régulièrement l’activité artistique au travail acharné. Il écrit en ce sens : « la réforme morale est un effort pour rejeter le sommeil […] Nous devons apprendre à nous ré-éveiller et à nous garder éveillés, non par des aides mécaniques, mais par l’attente infinie de l’aube, qui ne nous abandonne pas dans notre sommeil le plus profond » (2000, 85). Plus loin, Thoreau déclare que l’homme de lettres n’échappe pas à cette logique de travail, décrivant la bonne lecture comme « un exercice noble, une épreuve plus difficile que n’importe quelle activité dont nous avons coutume. Cela réclame un entrainement d’athlète, l’application d’une vie entière à cette tâche » (95-96). Et il ajoute : « Cela seul est lecture, dans un sens élevé, non ce qui nous berce comme un luxe et endort les facultés plus nobles, mais bien ce qui nous demande de nous tenir sur la pointe de pieds, en y consacrant les heures où nous sommes les plus alertes et éveillés » (99). Thoreau propose donc une axiologie des états de conscience, valorisant la lecture comme un travail diurne qui consiste à extraire une plus-value cognitive de l’œuvre d’art, et non comme un loisir nocturne, temps de repos et d’endormissement. Cet éthos de la croissance commande à l’individu une constante amélioration afin qu’il ou elle puisse participer activement et journellement au développement de la société.
Le caractère productif de la littérature est un motif récurrent. Dans « L’ère du soupçon », Nathalie Sarraute fait l’éloge du lecteur travailleur, celui qui « n’a jamais vraiment rechigné devant l’effort » (2019, 64). Autant le lecteur d’œuvres classiques que celui des œuvres plus exigeantes de l’après-guerre refusent « de demander au roman ce que tout bon roman lui a le plus souvent refusé, d’être un délassement facile » (78). Ainsi, ils emboitent le pas au romancier qui doit « découvrir de la nouveauté » et éviter de commettre le « crime le plus grave : répéter les découvertes de ses prédécesseurs » (79). Cette position n’est pas sans rappeler celle défendue quelques années plus tard par Roland Barthes. Dans Le plaisir du texte, Barthes pense une littérature qui serait libérée du stéréotype et de l’idéologie grâce à son rapport privilégié à la nouveauté et à la jouissance.
Pour échapper à l’aliénation de la société présente, il n’y a plus que ce moyen : la fuite en avant […] toutes les institutions officielles de langage sont des machines ressassantes : l’école, le sport, la publicité, l’œuvre de masse, la chanson, l’information, redisent toujours la même structure, le même sens, souvent les mêmes mots : le stéréotype est un fait politique, la figure majeure de l’idéologie. En face, le Nouveau, c’est la jouissance. (2002b, 243-244)
La « vraie » littérature servirait ainsi à créer de la nouveauté qui nous affranchit de la répétition. Pour jouir, il faut « fuir en avant », innover, rester en éveil face aux « machines ressassantes » de l’idéologie. Ailleurs, Barthes attribue à l’écriture la capacité de « produire des sens nouveaux, c’est-à-dire des forces nouvelles, s’emparer des choses d’une façon nouvelle, ébranler et changer la subjugation des sens » (2002a, 100). Ces commentaires participent d’une valorisation du nouveau en art répandue chez les intellectuels européens d’après-guerre. On trouve une de ses formulations les plus saisissantes dans la critique de l’industrie culturelle formulée quelques années plus tôt par Max Horkheimer et Theodor Adorno. Dans leur Dialectique de la Raison, ils dénoncent l’instrumentalisation commerciale de l’art aux mains de l’industrie culturelle :
[L]es éléments inconciliables de la culture, l’art, et le divertissement, sont subordonnées à une seule fin et réduits ainsi à une formule unique qui est fausse : la totalité de l’industrie culturelle. Celle-ci consiste en répétitions. (1983, 202)
L’intensification de la culture de masse s’impose par la réitération. Accompagnant un certain développement hégémonique de la science, de la technique et de l’économie au 20e siècle, celui de l’industrie culturelle aurait exacerbé l’aliénation des classes soumises à son emprise abrutissante. C’est pourquoi, d’après Horkheimer et Adorno, seules les avant-gardes autonomes auxquelles l’industrie culturelle « est totalement opposée » (137) peuvent nous libérer des ronronnements de l’idéologie que véhicule cette industrie.
Des pratiques littéraires désaliénantes, jouissives, seraient alors des pratiques marquées par l’éveil, l’innovation et la productivité. Ainsi, pour Umberto Eco (1965), ce qu’il nomme l’œuvre ouverte est celle qui est propice à l’accroissement de significations et qui invite les lecteurs à produire toujours plus d’interprétations. Il n’est pas anodin à cet égard que l’exemple type de l’œuvre ouverte que propose Eco soit Finnegans Wake de James Joyce : ce roman expérimental emblématique de la modernité investit les états limites du sommeil et du rêve, et exige un lecteur souffrant, dans les mots souvent cités de Joyce, d’une « insomnie idéale » (2012, 95). L’objectif n’est pas de bannir le sommeil afin de travailler le roman, mais, plus sournoisement, de mettre le sommeil au travail de l’interprétation. Dans le même esprit, la « mort de l’auteur » diagnostiquée par Barthes en 1968, libère les lectrices et les lecteurs tout en les faisant entrer dans le régime de la productivité. Barthes écrira justement, dans une perspective proche de celle d’Eco : « [l]e texte [authentique] est une productivité […] le texte ‘travaille’ [la langue], à chaque moment et de quelque côté qu’on le prenne » (2002c, 448).
Pour être clair, il ne s’agit pas ici d’accuser Sarraute, Barthes, Eco, Joyce, Adorno et Horkheimer d’avoir tenté de mettre en place d’un régime productiviste ou gestionnaire de la lecture. Mais il est curieux de constater qu’ils ont par moments mobilisé des références et des valeurs similaires à celles qui se déploient dans le monde du travail intensifié : comme si le projet moderniste visant la création d’expériences littéraires nouvelles et libérant les lecteurs avait trouvé son revers funeste dans un système économique basé sur l’accélération de la production et la croissance de la consommation.
Le caractère innovant incarné par des œuvres exigeantes a pu représenter une sorte de libération, une garantie de l’autonomisation des lettres. Or, le principe d’innovation est progressivement, mais sûrement devenu une nouvelle source d’aliénation. Les systèmes gestionnaires, qui se faufilent et s’imposent dans les milieux de l’enseignement et de la culture, possèdent leur logique propre. Ils normalisent une vision unidimensionnelle et instrumentaliste de la littérature où l’innovation apparaît comme une fin en soi. Aujourd’hui, la justification des lettres par le travail utile et rentable est reconduite, réaffirmée avec force. Une telle pression est à l’œuvre dans l’industrie de l’édition qui doit soutenir le rythme des rentrées littéraires, des salons et des foires, et qui doit se conformer aux exigences sans cesse renouvelées du numérique. Elle est évidente dans nos départements de lettres, notamment avec la quête perpétuelle de nouveaux axes de recherche et la course aux subventions qui investissent et consolident un imaginaire de l’innovation infinie. Pensons notamment aux subventions dites à haut risque / haut rendement, qui célèbrent l’innovation et l’audace, qualités que favoriseraient la flambée de sommes importantes sur de courtes périodes. Alors que les pratiques littéraires sont contraintes à explorer et à expérimenter avec le nouveau, nous sommes en droit de nous demander ce que vaut l’injonction d’innovation elle-même répétée. Paradoxalement, la nouveauté se trouve consacrée en stéréotype, voire, en termes barthésiens, en mythe. Ne gagnerait-on pas à interpréter cette injonction d’innovation comme le symptôme d’une culture prisonnière d’une « tradition du nouveau », dont la seule finalité est sa propre croissance?
III. Bis repetita placent : se reposer dans la relecture
En s’appropriant une éthique de l’innovation, de la production et de l’éveil, le champ de la littérature et les pratiques qui le structurent ont pu participer à l’accélération culturelle et à la dégradation de la vie naturelle. Comment réaménager le champ littéraire afin de résister à ces impératifs de productivité? Comment protéger ses voies d’évasion, et rester sensibles aux logiques cycliques du rêve, de l’oisiveté et du repos? Autrement dit, quels sont les usages homéostasiques de la littérature, des usages qui permettraient de réguler et de stabiliser nos manières d’habiter un quotidien régit une idéologie productiviste? Car ces usages existent bel et bien; or ils restent sous-théorisés. En ce sens, nous manquons de catégories critiques pour parler de ces œuvres qui ne demandent pas de travail et qui ne sont pas innovantes, des œuvres « paresseuses » qui nous emportent et nous absorbent, voire qui nous ennuient. Quelle place donnons-nous aux œuvres faciles et familières, qui refusent l’érotique du Nouveau (Barthes 2002b, 243) et qui ne sont pas cooptées par des régimes de productivité? On pourrait évoquer ici certains exercices d’écritures, par exemple l’écriture automatique des surréalistes, la tenue d’un journal, la fan fiction. Il est d’ailleurs probable que le refus du travail de l’intelligence motive une large part de lectrices et de lecteurs qui recherchent un état physiologique apaisant et réparateur, avoisinant le sommeil. C’est d’ailleurs souvent la lecture qui fait glisser enfants et adultes dans les bras de Morphée. La littérature mène donc aussi bien à l’effort innovant qu’au confort reposant, ou à des expériences divertissantes ou consolatrices, typiques par exemple des romans historiques ou sentimentaux, des genres populaires bien établis.
C’est justement à travers ces genres qu’Emma Bovary et un de ses amants, Léon Dupuis, abordent la littérature. Emma, on le sait, est une grande lectrice de romans sentimentaux et de romans de chevalerie; elle ne peut qu’être perdante dans le cadre réaliste du roman de Flaubert. L’impulsivité et l’insouciance d’Emma sont indissociables de la mise en garde, à peine voilée, que fait Flaubert à l’endroit de ce qu’on appellerait aujourd’hui, la chick lit et la fantasy. Dans une discussion sur leurs préférences littéraires, Léon souligne le grand plaisir qu’il a à lire au coin du feu :
– On ne songe à rien, continuait-il, les heures passent. On se promène immobile dans des pays que l’on croit voir, et votre pensée, s’enlaçant à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages; il semble que c’est vous qui palpitez sous leurs costumes.
– C’est vrai! C’est vrai! disait-elle. (1964, 602)
Assistant à la discussion, Charles Bovary ne peut s’empêcher de reprocher à sa femme : « elle aime mieux, quoiqu’on lui recommande l’exercice, toujours rester dans sa chambre à lire » (602). Entendons-nous ici Flaubert lui-même valoriser l’effort, l’entrainement et le travail, et condamner la paresse qu’encouragent des œuvres faciles?
Du haut de son poste dans une prestigieuse université de l’Ivy League, Vladimir Nabokov dénigrait Emma Bovary, ou ce qu’elle représente, cette « philistine » étalant sa « vulgarité mentale » (1980, 143)2 : « Emma Bovary est une mauvaise lectrice. Elle lit des livres émotivement, d’une façon superficielle et juvénile » (136). Nabokov qualifie Emma, sans détour, de bad reader, une formule qu’il réutilise dans l’analyse de la discussion littéraire entre Léon et Emma, selon lui une « bible du mauvais lecteur » (150). Nabokov écrit :
Les livres ne sont pas écrits pour ceux qui aiment les poèmes qui font pleurer, ou pour ceux qui aiment des personnages nobles mis en prose, comme le pensent Léon et Emma. Seuls les enfants peuvent être excusés pour s’être identifiés aux personnages d’un livre, ou pour aimer des histoires d’aventures mal écrites. Mais c’est ce que font Emma et Léon. (150)
Or, que Nabokov le veuille ou non, nous avons tous et toutes un peu d’Emma en nous. C’est pour un confort similaire à celui recherché par Emma que des lecteurs et lectrices compulsent ou dévorent des œuvres qui ne leur sont pas désignées (dont ils ne sont pas des « lecteurs idéaux » comme diraient Joyce-Eco), par exemple un adulte « cultivé » lisant une bande dessinée classique ou un roman jeunesse. La reconnaissance de ce partage n’entraîne pas l’abandon de la riche tradition moderniste, des avant-gardes et des œuvres ouvertes; elle n’entraîne pas le désaveu des approches critiques de la littérature. La lecture d’œuvres qui seraient, pour Nabokov, « bien écrites » peut certainement s’opposer aux rythmes machiniques de la Modernité en soustrayant du temps et de l’énergie à l’effort gestionnaire et en le dépensant dans une pratique littéraire. Or, placée sous le signe du progrès, de l’éveil et de la productivité, cette lecture exigeante reproduit la logique du travail infini. Face à cette lecture laborieuse, les lectures de loisir et les lectures-perte-de-temps paraissent alors comme des activités parasites qui contreviennent aux exigences de l’innovation. Tout compte fait, Emma Bovary nous enjoint à revivifier des pratiques de lecture immersive et sensible, de relecture et, pourquoi pas, les « histoires d’aventures mal écrites ».
La relecture – entendue ici comme le recyclage et la réutilisation des textes – est une pratique propre à déstabiliser tout particulièrement les conceptions linéaires du progrès. Étonnamment subversive, la relecture de loisir peut être frappée par l’opprobre (notamment dans un contexte universitaire) : elle est une stagnation mentale, un gaspillage de temps dans un monde où chaque seconde doit être rentable. La relecture devient un plaisir coupable, soumise aux mêmes pressions que le sommeil pris dans la nasse des systèmes gestionnaires. Elle implique le rejet d’une idéologie de l’innovation qui valorise avant tout l’acquisition, l’exploitation et l’élimination de produits culturels. Meyer Spacks, dans son ouvrage On rereading, nous rappelle justement que la relecture est sécurisante, qu’elle nous abrite du stress de la vie quotidienne, qu’elle facilite le sommeil et permet de revenir dans le temps, de ralentir la fuite en avant. Elle joue ainsi un rôle homéostasique car, comme l’explique Spacks, « bien que l’on puisse relire pour mieux comprendre un texte, on peut supposer que les habitués de la relecture (moi y compris) relisent surtout par plaisir, pour se détendre. On cherche parfois à atténuer plutôt qu’à intensifier notre conscience » 2011, 33). Ces caractéristiques cruciales de la relecture entrent en contradiction avec les normes cognitives et comportementales qui règlementent une partie importante du champ littéraire. En réglant la question du récit, de son déroulement et de son dénouement, en réglant aussi l’effet de surprise devant un texte nouveau, la relecture libère des ressources attentionnelles qu’il est possible d’attribuer à d’autres tâches, que ce soit la conscience de divergences entre l’intention de l’auteur et nos réactions de lecteur, ou l’établissement de nouveaux liens avec le contexte socio-historique, ou bien un investissement sensoriel et corporel plus fort. Spacks écrit : « Les relectures successives élargissent l’espace de liberté qui entoure un livre et, ce faisant, les réactions possibles du lecteur » (12). La relecture rend donc possible une nouvelle expérience du texte qui n’est pas fondée sur un travail volontaire :
La relecture, pour moi, est un processus d’attention rehaussée, même lorsqu’elle m’apparait comme un délassement ; et ‘faire attention’ constitue le geste fondateur de la critique littéraire. Cependant, je ne concentre pas délibérément mon attention sur des passages particuliers lorsque je relis. Il faut utiliser la voix passive : l’attention est donnée. Je n’ai pas l’impression de choisir ce que je remarque tout à coup ; c’est le texte qui demande mon attention en des endroits inattendus, et se révèle ainsi sous un jour nouveau. (16)
Spacks envisage ici une relecture réceptive, proche de la « sage passivité » de Wordsworth ou de la « capacité négative » de Keats, qui s’oppose à la « recherche irritée de faits rationnels », à cette lecture enchaînant jugements et interprétations, problèmes et solutions (70). La relecture dépend donc d’une capacité à se laisser affecter par un texte déjà connu, nous le montrant « sous un jour nouveau ». Cette capacité ne nous engage pourtant pas dans un travail délibéré et conscient que demandent la production d’interprétations nouvelles et la maîtrise intellectuelle de formes innovantes. Emma Bovary, faisant justement preuve de cette capacité singulière, serait alors une lectrice non plus mauvaise, mais experte, capable d’atténuer sa conscience et de recevoir le texte dans toute sa puissance expérientielle. Ce faisant, elle se repose sur une parole partagée, celle d’une littérature accueillante qui abrite temporairement ses lectrices de l’aliénation de la vie moderne; une littérature capable d’être lue sans les lumières de la rationalité qui voudrait s’imposer comme unique accès au monde.
Contrevenant au rythme soutenu de la productivité, la relecture favorise la suspension d’une certaine conscience réflexive, plongeant les lecteurs et les lectrices dans des textes déjà connus qui, lorsqu’ils sont largement partagés, participent au maintien d’une culture commune. Se « laisser aller » à ces récits revient donc, pour l’individu, à se reposer entre les mains d’un imaginaire collectif. Cela ne lui permet sans doute pas de rattraper les trois heures et demie de sommeil disparues au fil du dernier siècle, mais à tout le moins le relecteur « passe le temps » en marge de l’ordre temporel dystopique du 24/7 décrit par Crary. Que le repos de l’esprit rationnel passe par une plongée dans le fond commun des lettres, nous rappelle la structure même du sommeil. Dans « Le sommeil, la nuit » Maurice Blanchot faisait d’ailleurs remarquer que les effets bénéfiques du sommeil et du rêve dépassent largement les limites de l’individu. La dormeuse et le rêveur ne sont pas des solitaires qui perdent leur temps, arrachés à l’histoire. Ils vivent plutôt une autre forme de temps, un temps partagé, indissociable de l’organisation sociale, des vicissitudes et des accomplissements de l’espèce. Le sommeil extirpe l’individu de son action délibérée et le met entre les mains d’une communauté, des autres qui veillent. Blanchot note à cet effet que « le sommeil est un acte de fidélité et d’union » (1988, 358) avec le monde.
Comment intégrer nos usages de la littérature à ces trames cycliques de la vie ? La lectrice absorbée et détendue devant un texte familier fait, comme le dormeur, l’expérience d’une certaine désindividuation. Serait-il envisageable de ralentir les rythmes de la culture pour développer une relation familière à celle-ci, une relation habitationnelle où les corps s’abritent de la tension causée par les rythmes machiniques du capitalisme contemporain et de la consommation exhaustive des ressources qu’il implique ? Ainsi, ce ne serait plus par l’invention de nouveaux langages, célébrés par Sarraute, Nabokov, Eco, Barthes, Adorno et Horkheimer, que nous échapperions à la répétition aliénante des discours de pouvoir, mais en opposant, aux injonctions d’innovation et d’accélération, des manières plus tranquilles d’habiter les textes et nos corps, parmi nos semblables et au sein d’un environnement planétaire partagé.
1 « Au fil du vingtième siècle, il y a eu des offensives régulières contre le temps accordé au sommeil – maintenant l’adulte nord-américain moyen dort approximativement six heures et demie par nuit, une érosion des huit heures de la génération précédente, et (c’est difficile à croire), en diminution de dix heures depuis le début du vingtième siècle. Vers la moitié du vingtième siècle, l’adage familier selon lequel « nous passons le tiers de notre vie endormis » semblait avoir une certitude axiomatique, une certitude qui continue d’être minée » (Crary 2014, 11, traduction personnelle).
2 Suzanne Fraysse aborde cette situation par le biais de l’éthique et du désir, en envisageant la mauvaise lectrice que serait Emma à l’aune des habitudes de lecture (élitistes) de Flaubert et Nabokov. Elle dénonce « la mauvaise foi de [leur] posture moralisatrice ». Plus loin, Fraysse remarque, en parfaite résonance avec notre argument, que « [l]a déontologie de la lecture formulée par Nabokov s’entache indiscutablement de préjugés culturels éculés, et que le discours critique actuel, soucieux de légitimer l’étude littéraire au sein des universités, reprend bien souvent à son compte lorsqu’il distingue l’utilisation (libre, ludique, voire délirante) de l’interprétation (sérieuse, légitime) des textes » (2004, par. 37).
Bibliographie
Barthes, Roland, « Flaubert et la phrase », Word nº 24 vol. 1-3, 1968, p. 48-54.
_____ « Dix raisons d’écrire », Œuvres complètes III, Paris, Seuil, 2002a [1969].
_____ Le plaisir du texte, Œuvres complètes IV, Paris, Seuil, 2002b [1973].
_____ « Texte (théorie du) », Œuvres complètes IV, Paris, Seuil, 2002c [1973].
Berg, Maggie & Barbara Seeber, The Slow Professor. Challenging the Culture of Speed in the Academy, University of Toronto Press, 2016.
Blanchot, Maurice, « Le sommeil, la nuit », L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1988 [1955].
Chabot, Pascal, Global burn-out, Paris, Presses universitaires de France, 2013.
Chaplin, Charlie, Modern Times, United Artists, 1936.
Crary, Jonathan, 24/7. Terminal Capitalism and the Ends of Sleep, London, Verso, 2014.
De Gaulejac, Vincent, La société malade de gestion. Idéologie gestionnaire, pouvoir managérial et harcèlement social, Paris, Seuil, 2009.
Doctorow, Cory, Eastern Standard Tribe, New York, Tor Books, 2004.
Eco, Umberto, L’œuvre ouverte, Paris, Seuil 1965 [1962].
Ekirch, Roger, « The Modernization of Western Sleep: or, Does Insomnia Have a History? », Past & Present, vol. 1, nº 226, 2015 p. 149-192.
Flaubert, Gustave, Madame Bovary. Mœurs de province, in Œuvres complètes I, Paris, Seuil, 1964 (1857), p. 573-692.
Fraysse, Suzanne, « Madame Bovary est-elle une mauvaise lectrice? L’éthique de la lecture selon Flaubert et Nabokov », in Nicole Terrien et Yvan Leclerc (dir.), Le bovarysme et la littérature de langue anglaise, Mont Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2004, p. 123-144.
Han, Byung-Chul, La société de la fatigue, traduit de l’allemand par Julie Stroz, Oberhausbergen, Circé, 2010 [Müdigkeitsgesellschaft, 2014].
Horkheimer, Max et Theodor Adorno, La dialectique de la raison. Fragments philosophiques, traduit de l’allemand par Éliane Kaufholz, Paris, Gallimard, 1983 [Dialektik der Aufklärung, 1947].
Huët, Romain, De si violentes fatigues. Les devenirs politiques de l’épuisement quotidien, Presses universitaires de France, 2021.
Joyce, James, Finnegan’s Wake. The Restored Edition, London, Penguin, 2012 [1939].
Kundera, Milan, La lenteur, Paris, Gallimard, 1997 [1995].
Lafargue, Paul, Le droit à la paresse, Paris, Maspero, 1978 [1880].
Spacks, Patricia Meyer, On rereading, Cambridge, Harvard University Press, 2011.
Mintz, Sidney W., Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History, New York, Penguin Books, 1986.
Nabokov, Vladimir, « Gustave Flaubert. Madame Bovary », Lectures on Literature, New York, Harcourt, 1980 p. 125-178.
Piron, Sylvain, L’occupation du monde, Bruxelles, Zones Sensibles, 2018.
Rosa, Harmut, Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality, Aalborg, Nordic Summer University Press, 2010.
Sarraute, Nathalie, L’ère du soupçon. Essais sur le roman, Paris, Gallimard 2019 [1956].
Thoreau, Henry David, Walden and Other Writings, New York, The Modern Library, 2000 [1854].
Vidal, Laurent, Les hommes lents. Résister à la modernité XVe-XXe siècle, Paris, Flammarion, 2020.
Vigarello, Georges, Histoire de la fatigue. Du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 2020.
Weber, Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, traduit de l’allemand par Isabelle Kalinowski, Paris, Flammarion 2008 [Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1920].