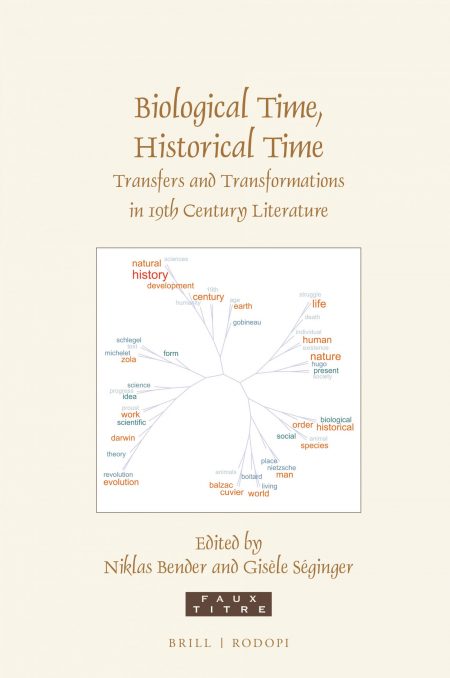Biological Time, Historical Time: Transfers and Transformation in 19th century Literature, Niklas Bender et Gisèle Séginger (dir.), Leyde, Brill | Rodopi, 2018, 411 pages.
Autant en emporte le temps… Tout au long du XIXe siècle, la perception du temps change au contact d’audacieuses théories scientifiques : biologie et géologie façonnent une temporalité plastique, se prêtant tantôt à l’observation des lois de l’hérédité, tantôt à la contemplation vertigineuse de l’abîme du temps profond. C’est cette temporalité nouvelle que se propose d’étudier cet ambitieux ouvrage collectif, par l’exploration de ses représentations littéraires dans un corpus français et allemand.
Cette étude magistrale est le fruit d’un travail collaboratif de grande ampleur, mené de front par les Biolographes, groupe international de chercheurs observant les interactions entre littératures et savoirs biologiques, et par d’autres chercheurs affiliés. L’introduction des deux directeurs de publication souligne à juste titre que, si nombre de réflexions critiques ont été consacrées à la temporalité, peu en ont observé la genèse scientifique et littéraire au XIXe siècle. Le dédoublement entre temps historique et temps biologique fait l’objet d’une problématisation érudite, avec des renvois aux premiers bouleversements de la conception du temps dans les Époques de la Nature (1778) de Buffon.
La première partie, « Rethinking the order of time », observe comment le temps peut être constitué en ordre de pensée propre à la subversion idéologique. Le temps profond de la géologie et de la transformation biologique s’oppose en effet à la téléologie fixiste chrétienne qui réduit l’âge de la terre à quelque six mille ans. Cette nouvelle vision du temps s’impose dans la science comme dans les consciences, comme l’explique Pascal Duris, mais de façon très progressive : Linné demeura toujours fixiste, Buffon fut censuré par la Sorbonne, Lamarck ne réussit jamais à convaincre Cuvier.
Ce temps géologique profond imprègne l’imaginaire littéraire romantique : ainsi Chateaubriand compare-t-il volontiers les strates des falaises à celles de ses souvenirs, comme le montre Paule Petitier. Sous la plume de l’écrivain des Mémoires d’outre-tombe, les révolutions historiques se superposent aux révolutions géologiques dans ce qui semble être une vision catastrophiste nourrie des incertitudes politiques de 1830. Cependant, Petitier souligne que c’est la vision uniformitariste de Lyell, et non le catastrophisme de Cuvier, qui l’emporte : Chateaubriand préfère généralement voir dans l’Histoire la somme de changements imperceptibles plutôt que des cycles ponctués de cataclysmes.
La pensée de Cuvier est également récusée par Pierre Boitard dans Paris avant les hommes, publication posthume de 1861. Claude Blanckaert nous invite à redécouvrir ce volume étonnant où le diable de Lesage, Asmodée, guide le lecteur dans le gouffre abyssal des siècles, tournant en dérision le fixisme de Cuvier et présentant un homme-fossile sauvage se nourrissant du sang des hyènes. Boitard, lui-même transformiste, avait avant Darwin conçu l’hypothèse d’une origine commune des êtres représentée par un système arborescent, en restant toutefois nominaliste comme Buffon (il ne souscrivait pas à l’idée d’un développement d’espèces différenciées).
Le « développement » est précisément la notion qui occupe Christophe Bouton dans son analyse méthodique de la pensée de plusieurs philosophes allemands, entre temps biologique et historique. Pour Kant, l’ontogenèse de l’homme récapitule la phylogenèse de la civilisation, à condition que le progrès de l’histoire permette sa réalisation. À l’inverse, aux yeux de Hegel, le développement de l’histoire permet à l’homme de prendre conscience de son libre-arbitre, par un développement singulier de l’esprit bien distinct des développements organiques. Enfin, pour Marx, la révolution fait partie du développement naturel de l’histoire, tel un fruit qui mûrit lentement. Herder utilise lui aussi une analogie entre biologie et histoire pour souligner la notion de progression.
David Schulz analyse la formation de cette pensée du temps profond de Herder, qui compare l’être humain à un « ephemeros », créature éphémère face à l’écrasante immensité du temps, reprenant une formule du baron d’Holbach. Ce dernier est aussi une source d’inspiration pour le poète Wilhelm Heinse à la fin du XVIIIe siècle, dont la correspondance révèle également l’influence de Buffon et de Saussure, témoignant d’un réseau intellectuel entre la France et l’Allemagne au sein duquel les théories géologiques les plus audacieuses circulaient librement.
La seconde partie, « Atavism and Heredity », s’interroge sur l’apparition de la notion d’atavisme au cours du XIXe siècle, principalement dans la littérature naturaliste. Arnaud Hurel retrace la genèse de l’homme préhistorique, tel qu’il fut imaginé par des générations de naturalistes : de Jacques Boucher de Perthes à Arthur Bordier, le transformisme s’articule à une téléologie du progrès, faisant triompher la rationalité et la civilisation de l’homo sapiens face à la violence brute de Néanderthal, dont les os sont découverts en 1856. La criminalité devient ainsi la marque d’un atavisme, comme Zola le suppose dans La Bête Humaine (1890).
Concevoir l’existence d’un tel ancêtre est à l’origine d’une crise de la pensée pour Nietzsche, comme le montre Emmanuel Salanskis : la théorie darwinienne prive l’homme de valeurs morales, religieuses ou esthétiques autrefois conçues comme éternelles. C’est cette crise que Nietzsche tente de résoudre en présentant une « généalogie » darwinienne de ces valeurs dans la Généalogie de la Morale (1887) : les valeurs supérieures, qui demeurent, sont celles qui sont profitables à l’homme qui les incarne. Nietzsche songe ainsi à la possibilité d’un homme supérieur, fruit d’une sélection morale sur des générations dans le laboratoire de l’Histoire.
Plus que la question des valeurs ou des caractères, c’est celle de leur transmission que se pose Henri Bergson. Arnaud François invite à relire l’Évolution Créatrice (1907), où Bergson suppose que l’hérédité n’est pas autant biologique que chimique. La transmission de caractères nouveaux serait donc l’exception plus que la norme, fondée sur une paradoxale hérédité de l’écart. De façon similaire, chez Zola, ce n’est pas l’alcoolisme que Gervaise transmet à ces cinq enfants, mais une certaine disposition, une pulsion de bonheur et de mort, qui se trouve renouvelée de façon toujours singulière chez chacun d’entre eux.
Zola est également le sujet de l’étude de Rudolf Behrens qui analyse les différents lieux de La Faute de l’Abbé Mouret (1875) : le village, le Paradou et l’église forment autant d’environnements biologiques et littéraires, véritable chronotope dans le récit zolien. S’ils semblent évoquer par leur archaïsme et par le jeu de l’intertextualité biblique les commencements de l’humanité, ils sont plutôt un terrain d’expérience épistémologique pour Zola, comme autant de mondes rêvés qui échappent au positivisme du docteur Pascal.
La troisième partie, « Nature and Culture », se penche sur quatre autres géants de la littérature française : Hugo, Baudelaire, Lautréamont et Proust. Niklas Bender analyse la façon dont la Nature et l’Histoire interagissent dans les romans historiques de Victor Hugo : l’auteur de Quatrevingt-treize (1874) défend certes une téléologie du progrès, dans laquelle l’Histoire doit s’émanciper de la nature. Cependant, dans ses scènes prophétiques, les deux se rejoignent en une vision cosmique harmonieuse, même si l’acte visionnaire demeure tributaire du voyant, dans une temporalité humaine et individuelle.
Chez Baudelaire, plusieurs ordres temporels coexistent également, pour former le beau. Dans Le Peintre de la Vie Moderne (1863), Baudelaire explique que le beau est dual, à la fois historique et anhistorique : le rôle de l’artiste, comme l’explique Thomas Klinkert, est donc de faire converger ces temporalités de la beauté vers un troisième ordre, celui du temps culturel. Ainsi, dans « Une Charogne », le pouvoir métaphorique du langage dédouble la temporalité biologique de la décomposition en une temporalité culturelle ouverte à la beauté, grâce à la vision de l’artiste qui sait discerner la « divine essence » éternelle des êtres et des choses.
Peut-être est-ce le temps biologique qui domine sur l’éternité esthétique dans les Chants de Maldoror (1869) de Lautréamont : Frank Jäger propose de voir en Maldoror l’incarnation d’une logique évolutionniste impitoyable, écrasant les moins aptes au fil des siècles, mais prenant aussi en compte l’extraordinaire diversité du vivant, comme en témoigne son foisonnant bestiaire. L’écriture poétique de Lautréamont serait elle-même un reflet de ce processus vivant, par les techniques de collage et d’hybridation textuelle, montrant à l’œuvre les croisements des espèces et la créativité de l’évolution toujours renouvelée.
Le temps biologique a également une importance décisive chez Proust, comme le montre Edward Bizub : les séances de psychothérapie avec le Dr Sollier étaient fondées sur la « kinesthésie » visant à faire ressurgir des souvenirs refoulés en stimulant la mémoire du corps. C’est cette temporalité corporelle et intime qui rythme la Recherche, comme dans la résurrection de Venise la faveur d’une simple sensation dans le pied du narrateur. Bizub précise que Proust a réagi avec virulence à la séparation de l’Église et de l’État car il concevait, de façon similaire, l’Église comme un corps indispensable au maintien d’une mémoire collective.
La quatrième partie, « Poetics of Time », propose de relire plusieurs grandes œuvres comme des « épopées de l’évolution », dont la Comédie Humaine de Balzac. Hugues Marchal relit l’éloge de Cuvier dans La Peau de Chagrin (1831) à la lumière de plusieurs poèmes sur le grand naturaliste. Or, si Cuvier est un poète pour Balzac, le poète lui-même se fait parfois paléontologue, cherchant dans les strates de la littérature quelque relique de poésie fossile : Marchal ajoute que, dans son roman Le Monde tel qu’il sera (1846), Émile Souvestre imagine la science de Cuvier appliquée aux belles-lettres, pour reconstituer une société à partir de ses vestiges littéraires.
Toutefois, selon Sandra Collet, il semble que ce soit Geoffroy Saint-Hilaire, plus encore que Cuvier, qui ait gagné toutes les faveurs de Balzac pour son principe d’unité de composition du vivant. Balzac, s’il montrait des hésitations manifestes, restait certes résolument fixiste, donc du côté de Cuvier. Cependant, sa description du milieu parisien pourrait sembler une frappante préfiguration littéraire du struggle for life darwinien, avec sa lutte pour la survie sociale, ses métaphores animalières et ses lois d’adaptation et de sélection, dont Rastignac est le meilleur exemple.
La poésie de Delille prend également les contours d’une épopée naturaliste… avec quelques licences poétiques, précise Nicolas Wanlin : le temps profond de la géologie est évoqué par des métaphores empruntées au temps court de l’histoire dans L’Homme des Champs (1800). La perception du temps profond permet cependant des « épopées universelles » teintées de darwinisme qui ne sont plus fondées sur les saisons, comme l’œuvre d’Edmond Emerich. La pensée du temps long se prête enfin à un imaginaire poétique décadentiste à la fin du siècle, ponctué par la dégénérescence, comme chez Raoul de la Grasserie.
Yohann Ringuedé s’intéresse plus spécifiquement à une de ces épopées : Antediluviana, Poème Géologique (1876) d’Ernest Cotty, dédié à Louis Figuier. La relation de Cottet à Cuvier est singulière : le poème est éminemment catastrophiste, par sa structure paratactique, allant de strate en strate. Il est aussi fixiste, par les irruptions de nouvelles créatures ex nihilo, comme l’étonnant « labyrinthodon ». Il répond en cela aux théories de Cuvier ; pourtant, il n’en reste pas moins ordonné d’après l’idée de finalité, téléologie dont l’homme serait le sommet et Dieu le grand créateur.
Alors que l’origine des temps fascine certains auteurs, d’autres sont davantage curieux de leur fin : Claire Barel-Moisan analyse ce motif deux romans d’anticipation. Dans La Fin du monde (1894) de Camille Flammarion, la narration effectue un saut temporel de plusieurs millions d’années jusqu’à un changement mortel de composition de l’atmosphère. La mort et la renaissance successives des galaxies aboutissent à un temps sans commencement ni fin. À l’inverse, dans La Mort de la Terre (1910) de Rosny aîné, le temps est assimilé à un fatum inexorable, une tragédie annoncée pour le narrateur, un des derniers humains luttant désespérément pour sa survie.
La pensée de Friedrich Schlegel n’est pas aussi pessimiste. Stefan Knödler montre son intérêt pour la Naturphilosophie et ses relations d’admiration mutuelle avec Cuvier. Schlegel applique les principes de l’histoire naturelle au langage, posant les bases de la philologie : à ses yeux, la poésie est progressive et universelle, c’est la langue première de l’humanité. Or, Schlegel, s’il a appliqué les méthodes de l’histoire naturelle à la langue, a aussi fait l’inverse, combinant histoire naturelle, littéraire et mythologique dans des articles scientifiques.
La cinquième et dernière partie porte sur « Biology and Ideology ». Juliette Azoulai y explique comment le temps de l’évolution se télescope avec celui de la révolution chez Michelet, Flaubert et Zola. Michelet suppose que la théorie anglaise de l’uniformitarisme serait liée à l’histoire de l’Angleterre, marquée par une progression constitutionnelle lente, alors que la théorie française du catastrophisme serait issue du séisme révolutionnaire. Flaubert, lui, préfère qualifier les théories de conservatrices ou de révolutionnaires selon leur taux de compatibilité avec le récit biblique. Enfin, dans Germinal (1885) de Zola, le temps biologique de la germination voit éclore celui de la révolution de la terre et des hommes dans la logique du Bildungsroman.
Michelet est aussi le sujet de l’étude de Gisèle Séginger : après avoir rappelé le développement de l’intérêt de Michelet pour les sciences naturelles, elle observe la pensée biologique à l’œuvre dans La Mer (1861). Michelet y développe un système original, conciliant idéalisme et matérialisme biologique, par une pensée imprégnée de vitalisme et de transformisme, également influencée par la théorie de la génération spontanée de Fouchet. La transformation des organismes marins, qui tend à la complexification, prend le pas sur la révolution, et le portrait des innombrables organismes du fond des océans peut être lu comme un vibrant hommage au peuple laborieux.
La représentation du peuple occupe aussi Carine Goutaland dans son analyse des théories proto-darwiniennes de Zola. Zola cite certes Darwin dans Le Roman Expérimental (1880), mais son darwinisme est plutôt social, hérité de Spencer, et manifeste par un réseau de métaphores sur « manger et être mangé ». Les comparaisons entre les maigres et les gras reviennent dans Le Ventre de Paris (1873) et Germinal (1885), où les relations des personnages peuvent être interprétées sur le mode du cannibalisme social ou du vampirisme. Enfin, le naturalisme lui-même, par la métaphore organique, se fait modèle biologique venant des entrailles de l’humanité, mêlant digestion et création.
La pensée évolutionniste peut toutefois fonctionner à rebours : comme le montre Pierre-Louis Rey, Joseph Arthur de Gobineau considère que l’homme est voué, non au progrès, mais à l’extinction par dégénérescence. Dans son Essai sur l’Inégalité des Races Humaines (1855), il affirme que la « race aryenne » a peu à peu dégénéré en se mêlant aux autres. Il admet d’heureuses exceptions, dont lui-même, qui descendrait directement du dieu Odin. Il établit ainsi une immortalité sélective, fondée sur le degré d’aristocratie.
Bien loin de Gobineau est la pensée de Louise Michel, analysée par Claude Rétat. Michel voit en Darwin comme en Élisée Reclus les deux penseurs d’une unité fondamentale : Darwin, celle des espèces, et Reclus, celle des espaces, par laquelle l’humanité est rassemblée. Elle s’oppose aux théories de Spencer, en faveur d’un darwinisme plus scrupuleux qui ne soit pas réduit à une simple loi du plus fort : son darwinisme n’est pas social, mais socialiste, comme dans À Propos des explosions (1892), où Michel justifie les actes de l’anarchiste Ravachol par la théorie de l’évolution.
L’ouvrage dirigé par Gisèle Séginger et Niklas Bender offre donc une analyse aussi riche que passionnante d’un vaste corpus franco-allemand qui, sans nul doute, fera date dans les études de littérature et d’histoire des idées. On voit mieux comment, dans une subtile guerre métaphorique, la « flèche » de la téléologie biblique est remplacée par le « cycle » géologique et biologique, comme le soulignait Stephen Jay Gould dans Time’s Arrow, Time’s Cycle (1987). Biological Time, Historical Time propose sur le temps profond une réflexion qui ne l’est pas moins, en interrogeant ce rapport complexe que nous avons construit avec le temps avant l’avènement de la phénoménologie et de la physique quantique.
La lecture de cet ouvrage nous montre également que cette temporalité aux multiples visages n’est peut-être, somme toute, pas autant une intuition pure kantienne qu’une modalité épistémologique de la subjectivité. Nos différentes conceptions du temps, avec cette plasticité poétique qui le caractérise, seraient autant de tentatives de reconstruire notre rapport au monde, qu’il s’agisse du temps catastrophiste de Cuvier ou de l’évolution créatrice de Bergson, car, comme le conclut avec grâce Carlo Rovelli : « nous sommes le temps. Nous sommes cet espace, cette clairière ouverte dans les traces de la mémoire à l’intérieur des connexions de nos neurones » (L’Ordre du Temps, Paris : Flammarion, 2018, p. 230).
Caroline Dauphin, doctorante, Université Sorbonne-Nouvelle (Paris)
Caroline Dauphin est doctorante à l’Université Sorbonne-Nouvelle (Paris). Sa thèse porte sur les passions animales et végétales dans la poésie d’Erasmus Darwin et de William Blake. Ses centres d’intérêt sont les relations entre sciences et littérature, l’écocritique, la poésie romantique anglaise et les études comparatistes. Elle a publié un article sur « Erasmus Darwin et la théorie de la séduction naturelle » dans la revue L’Atelier en 2018 ainsi que deux chapitres d’ouvrages sur le romantisme anglais. Quatre autres chapitres et articles sont en cours de publication, dont « A brief history of deep time in Romantic poetry », dans l’ouvrage collectif Romanticism and Time, dirigé par Sophie Musitelli (à paraître).