Le XVIIe siècle a vu croître la dissociation, à la fois théorique et pratique, dans l’expérience individuelle comme dans les institutions culturelles, entre ce qui relève du savoir savant et ce qui relève de l’esthétique, les Sciences (au sens large, y compris la science critique des textes, la philologie) et les Arts : d’un côté des sciences qui, mettant en doute la « littérature » au sens de la chose écrite, s’appuient de plus en plus sur le raisonnement critique, l’observation et l’expérience, la lecture des sources premières, à la recherche du vrai et des idées claires et distinctes ; de l’autre une littérature (au sens moderne cette fois) de plus en plus nettement définie comme fiction ornée, devant passer par le plaisir pour instruire, et vouée au vraisemblable. Si l’on adopte le vocabulaire de Charles Sorel, dans sa Bibliothèque française (1664-1667) , on assiste alors à la séparation entre les bonnes lettres, lieu de la « doctrine » (c’est-à-dire des savoirs), et les belles lettres, lieu de l’agrément.
L’histoire des institutions le confirme. La création en 1635 de l’Académie française, à qui l’on donne pour charge de produire un dictionnaire, une grammaire et une poétique, manifeste la volonté politique de soutenir avant tout « ceux qui écrivent bien en notre langue » par rapport aux préoccupations encyclopédiques, tout autant scientifiques que littéraires, voire davantage, des cercles d’érudits, notamment celui des frères Dupuy dont l’Académie est issue. Cela peut-être parce que les sciences du début du siècle sont le lieu d’âpres débats, entre les observateurs et les partisans des avancées épistémologiques modernes et le parti religieux, appuyé sur et par les aristotéliciens purs et durs, débats dans lesquels le politique n’a guère à profiter. Au contraire, il apparaît urgent à Richelieu de renforcer l’imposition d’une langue française normée à l’ensemble du territoire et de soutenir la création littéraire, instrument de propagande et source de prestige international : comme le dit Alain Viala, le choix de l’État alla d’abord davantage vers la « promotion des arts verbaux » (les belles lettres, ce qu’il appelle les Sirènes) que vers la doctrine et érudition (les bonnes lettres, les Muses à l’antique) . Si, après la mort des frères Dupuy, le « Cabinet Dupuy », et bien d’autres savants, continuent (avec prudence dans certains domaines) leurs efforts pour la connaissance de la nature et l’exploration de la diversité de ses phénomènes, il faudra attendre 1666 pour que Colbert crée l’Académie des Sciences, qui est vouée à s’occuper « à cinq choses principales : aux mathématiques, à l’astronomie, à la botanique ou science des plantes, à l’anatomie et à la chymie » , sous l’égide d’un cartésianisme qui convainc de plus en plus de savants, manifestant ainsi clairement, en tout cas dans l’ordre des institutions d’État, comme des institutions culturelles (le Mercure galant, fondé en 1672, fait pendant au Journal des Savants, fondé en 1665) la dissociation des sciences et des lettres.



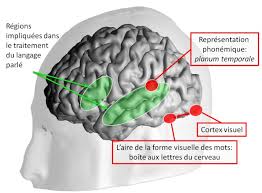


![Lire la suite à propos de l’article Les effets narratifs de la science dans la littérature : Stifter et Flaubert <a href="#ftn1">[1]</a><br />](https://epistemocritique.org/wp-content/uploads/2014/12/arton394.jpg)






