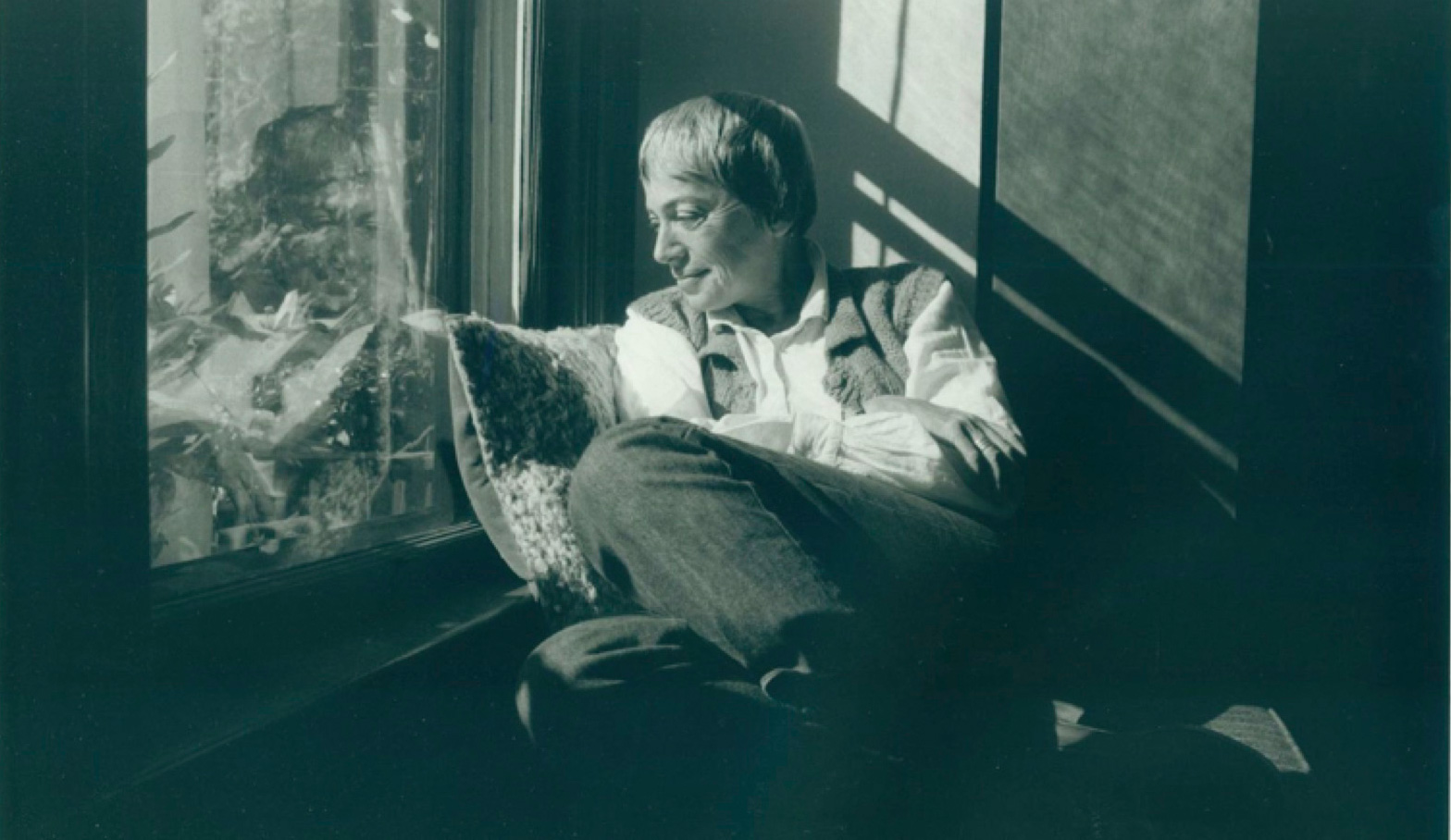Je voudrais d’abord remercier les organisateurs et organisatrices pour cette occasion, qui est pour moi, et peut-être pour nous, une épreuve1.
Dans le très beau film que Fabrizio Terranova a consacré à Donna Haraway, « Story Telling for Earthly Survival » (2019), Haraway pose la question « Comment se fait-il que l’écriture et les auteur.e.s de SF ne deviennent pas des illustrations d’arguments ou des illustrations de pensées, mais des pensées elles-mêmes ? » (33m 50s)
Cette question fait épreuve, non pas bien sûr pour les lecteurs et lectrices que les romans d’Ursula Le Guin ont fait sentir, penser et imaginer, mais pour ceux d’entre nous, penseurs académiques, qui sommes mis usuellement en position de commenter, mais qui sentiraient, comme Haraway, qu’il s’agit de résister à la tentation de commenter au sens de ramener ses textes à l’illustration de thèmes qui nous sont familiers. Je voudrais tenter de commenter au sens de « penser avec », d’explorer avec Le Guin l’expérience pensante (et donc aussi affective) que ses textes nous proposent.
Je partirai de la célèbre nouvelle, Ceux qui partent d’Omelas (1973), parce que, dans ce cas, Ursula Le Guin prend elle-même le relai d’un autre penseur.
C’est en effet William James, qui a imaginé, dans « Les moralistes et la vie morale », « un monde qui assure à des milliers d’êtres un bonheur permanent à la seule condition qu’une âme isolée, à la frontière lointaine des choses, soit condamnée à mener une existence de torture et de solitude. » (1896, 204)
William James était un esprit libre. Il ne théorisait pas mais faisait confiance à ses lecteurs. Ici, il les appelait à éprouver avec lui « le caractère hideux d’un bonheur accepté à ce prix. » (Ibid.)
Mais Ursula Le Guin quant à elle a peut-être senti que William James était allé trop vite. Car dans cette nouvelle, la narratrice prend la parole, s’adresse directement à ses lecteurs, leur demande d’accepter qu’à Omelas, le bonheur des habitants est, malgré ce marchandage, noble et intelligent. Et cela, alors même, insiste-t-elle, que tous savent que la souffrance d’un enfant enfermé dans un sinistre caveau est la condition sine qua non de ce bonheur.
Ursula Le Guin me semble avoir délibérément adopté ici le style des « expériences de pensée » qui peuplent aujourd’hui la philosophie morale. Je pense surtout aux situations mettant en scène un dilemme, par exemple celui du conducteur de tramway hors contrôle, qui, s’il choisit de prendre une voie latérale, épargnera la vie de cinq personnes travaillant sur sa voie, mais au prix d’en écraser une sur la voie latérale.
De telles expériences de pensée demandent que nous acceptions la situation telle qu’elle est posée, car elles sont faites pour illustrer un problème général. En l’occurrence il s’agit de choisir entre la morale kantienne du devoir qui interdira de sacrifier la vie d’un seul, même pour en sauver cinq, et la morale utilitariste du calcul coût/bénéfice. Ou alors, il s’agit d’outiller une recherche empirique faisant varier le coût et le bénéfice. Deux ou cinq personnes ? Des enfants ou des adultes ? Travaillant sur les voies ou se promenant imprudemment ?
Or, ce qui est frappant dans Ceux qui partent d’Omelas, ce qui fait tant la vibration propre à la nouvelle que la différence avec la plupart des questions philosophiques qu’elle a suscitées, est que nul n’y discute, nul ne met en doute la véracité du dilemme, nul ne dénonce ou ne tente d’en convaincre d’autres, nul ne calcule le coût et le bénéfice. Et ceux qui, la nuit, en silence, quittent la ville n’aident en rien l’enfant – ils n’ont même pas pris de décision collective. Le Guin l’écrit, ceux qui partent d’Omelas s’en vont seuls, et nul ne sait où ils vont.
En d’autres termes, la nouvelle de Le Guin semble parfaitement amorale, dénuée de tout message, frustrant toute prétention à en faire l’illustration d’un argument conclusif. Tant la noble intelligence des habitants d’Omelas que l’impuissance de ceux qui partent à modifier la situation entravent toute discussion.
La nouvelle de Le Guin n’est ni une expérience de pensée, ni une allégorie dénonçant l’injustice de notre société. C’est, me semble-t-il, une pensée qui répond à une autre pensée, en l’occurrence celle de William James. Car dans le texte où William James évoque le caractère obscène d’un bonheur payé au prix du malheur d’un enfant, il s’agissait avant tout de préparer les lecteurs à sentir le caractère tout aussi obscène de la tâche d’un philosophe moral qui entreprendrait de fonder un système moral quel qu’il soit. Car il ratifierait par là l’exclusion, voire la persécution, d’innombrables autres manières de donner valeur au monde et à nos vies.
Le philosophe moral selon William James devrait se laisser hanter par les plaintes de tout ce dont le système moral auquel lui-même adhère demande le sacrifice. Un tel philosophe ne serait pas relativiste ou cynique pour autant, plaide James, mais il s’interdirait d’ajouter le poids d’une quelconque autorité aux valeurs qui, de fait, prévalent déjà dans la société où il vit. Il s’interdirait de bâtir un système moral fondé sur un idéal qui l’autorise à ignorer la multitude de ses victimes. Et c’est peut-être là ce qui a fait penser Ursula Le Guin lorsqu’elle a décrit Omelas.
Ceux qui partent d’Omelas le font en silence, mais peut-être leur absence hante-t-elle les habitants, comme James demandait que le philosophe se laisse hanter par les plaintes des victimes. Car nul, à Omelas, ne semble s’étonner de ces départs, ne semble défendre la légitimité du choix dont dépend leur bonheur. Ils savent, et ils savent que d’autres n’ont pu supporter ce savoir.
Et, qui sait, peut-être est-ce là ce qui donne à leur bonheur cette intelligence noble sur laquelle Le Guin insiste tant. Elle-même ne sait pas. Ne pourrait-on dire alors que cette œuvre de fiction traduit un engagement qui relaie celui de William James, « garder les portes et les fenêtres ouvertes » (voir James 1911, 94-95) ?
Je le souligne, garder ouvert n’a pas la passivité d’un « laisser ouvert ». C’est par un exercice de ce mode de pensée que l’on appelle « imagination » que l’on peut, sans cynisme ni relativisme, résister à la tentation de souscrire aux raisons que nous nous donnons pour accepter l’ordre des choses, pour soutenir qu’il ne pouvait être autrement.
Et c’est ici qu’il est crucial pour moi de distinguer entre imagination et imaginaire.
Dans « Sita Dulip’s Method », qui introduit le recueil Changing Planes (2003), Le Guin raconte la découverte que fit Sita Dulip lors d’une escale interminable, l’avion qu’elle devait prendre étant, comme cela arrive, en retard. Cette attente d’un avion en retard donne à l’aéroport ce qui est sans doute, écrit Le Guin, sa vérité :
L’aéroport n’est pas le prélude au voyage, ni non plus un espace de transition : c’est un arrêt. Un point de blocage. Une constipation. L’aéroport est l’endroit d’où vous ne pouvez aller nulle part ailleurs. Un non-lieu dans lequel le temps ne passe pas et où n’existe aucun espoir de vie qui ait du sens. Un terminus : la fin. L’aéroport n’offre rien d’autre à l’être humain que l’accès à l’intervalle entre deux avions. (2, traduction personnelle)
Sauf que, bien sûr, en anglais, changing planes, c’est changer d’avion mais aussi changer de plan. Et être entre deux avions, c’est aussi être entre deux plans. Sila Dilup a découvert que, pour les humains, ce qui est subi à l’aéroport, la « combinaison spécifique d’inconfort énervé, d’indigestion et d’ennui était ce qui facilitait le voyage interplanaire, déjà usité par bien d’autres espèces habitant d’autres plans, mais dont la plupart n’ont pas à souffrir comme nous le faisons » (6, traduction personnelle).
L’expérience de ce temps arrêté, stérile vécu dans un aéroport, en attente d’une correspondance, peut évoquer la manière dont je voudrais caractériser l’imaginaire, pour le distinguer de l’imagination. On est dans l’entre-deux mais on y reste coincé, parce que l’image qui vous habite est dénuée de toute capacité de faire monde. C’est le cas de beaucoup de promesses d’inspiration technoscientifique. « Un jour, nous pourrons… », que ce soit échapper à cette planète que nous aurons dévastée, et en terraformer une autre, ou ressusciter les espèces disparues à partir de leurs génome conservés, ou vaincre la vieillesse, voire la mort…
Mais ces possibles, parce qu’ils sont imaginaires, restent abstraits, résolument muets quant à leurs implications et à leurs conséquences. Ce qui se présente comme « progrès technique », notamment, n’est jamais qu’un simple instrument pour des fins inchangées. Et, s’il se concrétise, il aura des conséquences d’autant plus imprévues et souvent non désirées que l’imaginaire du progrès a présidé à sa naissance. Pensez au rôle, aujourd’hui, des réseaux sociaux.
En revanche, la possibilité de voyages interplanaires est la possibilité de visiter des mondes, non pas des mondes rendus prévisibles par le tourisme de masse mais des mondes qui surprennent, avec lesquels il s’agit de se familiariser. Ursula Le Guin nous dit comment c’est souvent l’imagination d’une situation qui, pour elle, est au point de départ d’une fiction, mais cette situation doit recevoir la capacité de réclamer un monde auquel elle appartiendrait. Un monde fictif bien sûr, mais qui se doit d’être consistant, c’est-à-dire de rendre indissociables sa création et l’exploration de ce qu’il demande.
L’imagination, lorsqu’elle tisse les implications et les conséquences, les tenants et les aboutissants enchevêtrés, met en jeu des forces propositionnelles et transformatrices qui obligent l’auteure à devenir habitante de ce monde, ou en tout cas visiteuse. Et pour ce faire, elle doit transformer des possibles qui rôdaient dans les interstices de sa propre époque en ressources pour faire exister autre chose.
Si, dans Omelas, Ursula Le Guin a relayé William James, c’est peut-être parce que sa nouvelle a pour vocation de nous hanter, refusant toute solution imaginaire, que ce soit celle d’une décision collective de libérer l’enfant et de remplacer le bonheur offert par un bonheur construit, ou celle d’une Omelas bis, fondée par ceux qui ont quitté la ville. La voix de la narratrice, omniprésente dans la nouvelle, s’adressant directement à ses lecteurs et lectrices, me semble leur demander de ne s’identifier imaginairement ni avec les habitants d’Omelas, ni avec ceux qui partent.
Et c’est peut-être parce qu’il s’agit précisément ici de ne pas nous raconter d’histoires. Nous pouvons rêver d’échapper au point de blocage que constitue pour nous Omelas, mais il n’est pas sûr que notre époque nous rende capables d’imaginer l’histoire qui permettrait de débloquer la situation, d’échapper au dilemme.
Garder les portes ouvertes, cultiver ce que j’appellerais une attitude spéculative, c’est-à-dire répondant aux possibles qui insistent effectivement dans les interstices de notre expérience, c’est refuser l’imaginaire qui permet de s’évader du monde dont nous avons l’expérience. Dans Words Are My Matter (2016), Le Guin remarque que « pour pouvoir ouvrir des portes, vous devez avoir une maison » (25, traduction personnelle). Ce qui signifie aussi que, contrairement à l’imaginaire qui est littéralement sans histoire, nous faisant penser et sentir en rond sur le mode d’une abstraction lancinante, l’imagination mise en œuvre par la science fiction spéculative est située.
Les portes qu’Ursula Le Guin ouvre, ou garde ouvertes, sont celles dont l’insistance se fait sentir dans nos maisons, à notre époque. La possibilité de résister aux états de fait qu’elle manifeste et met en histoire est celle dont son époque a rendu l’écrivain capable.
En novembre 2014, dans le discours prononcé lors de la remise de la médaille de la National Book Foundation, Ursula Le Guin annonça qu’elle partageait cette récompense avec « tous les écrivains qui ont été depuis si longtemps exclus de la littérature – mes camarades auteurs de fantasy et de science fiction, écrivains de l’imagination » (Words, 113, traduction personnelle).
Et elle ajouta :
Des temps difficiles s’annoncent, et nous aurons besoin de la voix d’écrivains capables de discerner des alternatives à la manière dont nous vivons aujourd’hui, capables de percevoir, au-delà de notre société paralysée par la peur, au-delà de ses obsessions technologiques, d’autres façons d’exister, et capables même d’imaginer des raisons réelles d’espérer. Nous avons besoin d’écrivains qui puissent se souvenir de la liberté – des poètes, des visionnaires – des réalistes pour une réalité plus vaste. (Ibid., je souligne)
Et c’est peut-être à ce besoin que Donna Haraway (2016) a fait écho lorsqu’elle a proposé de faire de l’acronyme SF la signature de ce que j’appellerais un « mode de pensée ». SF se décline alors en un ensemble apparemment disparate, qui inclut Science Fiction, mais aussi Speculative Fabulation, Speculative Feminism, et encore Scientific Fact et So Far.
So Far, est le cri même de la résistance contre la normalité à laquelle prétendent les états de fait. Cela a pu s’imposer comme « normal », mais seulement jusqu’ici ! Et même si nous sommes incapables d’imaginer une issue à la situation d’Omelas, nous n’avons pas à nous incliner devant un dilemme indépassable. Nous n’avons peut-être que des échappées imaginaires à proposer, mais seulement so far : les choses pourraient être autrement.
C’est un cri qui, proféré avec d’autres accents, convient aussi aux féministes des années soixante-dix, et à cette nouvelle génération de femmes qui, à cette époque, publièrent de la science fiction en tant que femmes, et non plus dissimulées derrière un pseudonyme masculin. Elles avaient été rendues capables par leur époque, les unes avec les autres et grâce aux autres, de percevoir que les choses pouvaient effectivement être autrement. Elles étaient réalistes, mais la réalité qu’elles faisaient percevoir incluait la force dont les femmes avaient été séparées, donnait des mots et des histoires à ce qui rôdait dans les interstices de l’expérience de leurs lectrices.
Et l’œuvre d’Ursula Le Guin témoigne en elle-même de ce que science fiction, la fabulation spéculative ou la fantasy spéculative, ne se distinguent entre elles que par les moyens mis en œuvre pour élargir le sens de la réalité, pour la libérer de l’opposition entre possible et impossible.
Ainsi que la magie soit pratiquée sur Terremer (le Cycle de Terremer comprend cinq romans et des nouvelles publiées entre 1964 et 2018) ne nous confronte pas au « tout est possible » qu’on serait tenté d’associer à la « fantasy », en l’occurrence à l’idée intemporelle et abstraite d’une toute puissance de l’esprit capable de plier magiquement la réalité à ses désirs ou à sa volonté. Le cauchemar que constituerait une telle toute puissance est plutôt le thème central de De l’autre côté du rêve (The Lathe of Heaven, 1971). Sur Terremer, la magie est un art ou une technique qui a ses règles et ses dangers, et qui pose des problèmes déontologiques à ceux et celles qui la manient.
Fille d’anthropologue, Le Guin suit en ce sens les récits ethnographiques, qui nous font sentir que d’autres manières de faire monde sont possibles. Notre rapport à ce que nous appelons « le » monde n’a pas de privilège ni de droit à en exclure d’autres en les renvoyant à la superstition.
Il reste que ce qui est possible sur Terremer est impossible dans le cadre de la réalité dite scientifique, alors que le cycle de Hain, qui relève à sa manière de la science fiction baptisée dure, met en scène des techniciens et des chercheurs directement inspirés de ceux qui nous sont familiers, tel le physicien Shevek, dont les travaux vont rendre possible le célèbre ansible. N’avons-nous pas affaire ici au thème classique du progrès, de l’avancée des connaissances, bien plutôt qu’à cette réalité plus large dont parle Le Guin ? Mais aussi, que viennent donc faire les « faits scientifiques » dans le mode de pensée SF que propose Haraway ?
Cependant, on peut retourner la question. Que signifierait le mode de pensée SF si les faits scientifiques en étaient exclus ? Une telle exclusion confirmerait, me semble-t-il, le genre d’opposition stable qui domine aujourd’hui nos modes de pensée académiques.
Pour les spécialistes de ce qu’on appelle aux États-Unis les humanités critiques, les « faits scientifiques » sont associés à l’idée d’une autorité qui les rendrait foncièrement hostiles à toute contestation de l’ordre assigné aux choses. Les faits demanderaient notre soumission, autoriseraient à dire : « Vous pouvez toujours rêver, mais les faits sont là, et on ne lutte pas contre les faits. » C’est pourquoi bien des critiques ont fait le choix de combattre l’autorité des faits, d’en faire des fictions dont seuls les humains seraient responsables, des constructions purement humaines à propos d’une réalité foncièrement muette. Et aujourd’hui les scientifiques que ce choix rendit furieux ont beau jeu de rétorquer que les critiques récoltent maintenant ce qu’ils ont semé : « Vous avez préparé le cauchemar d’un Donald Trump tournant le dos à la menace du désordre climatique parce qu’elle le dérange. »
Le mode de pensée SF n’a jamais été mobilisé par ce dilemme abstrait : « Qui est responsable de ce que nous savons, la nature ou l’humain ? » La science fiction spéculative n’a que faire d’abstractions lourdes, telles que responsabilité, nature ou humain, qui nous donnent l’impression de savoir ce dont nous parlons mais ne communiquent qu’avec des arguments polémiques, pas avec des histoires.
Si les faits scientifiques figurent dans la déclinaison SF, ce n’est pas en tant que faisant autorité mais comme participant à la fabrique des mondes, de mondes qui posent la question des rapports qui les tissent, de ceux qui prévalent aujourd’hui, de ceux qui pourraient exister demain. En tant que tels, les faits scientifiques sont relatifs non pas à nos catégories humaines, mais aux rapports que nous nous rendons capables de créer avec autre chose que nous-mêmes, et à ce que nous faisons de ces rapports – et c’est ici qu’intervient la différence à faire les faits scientifiques comme création de rapports et les faits scientifiques comme armant les prétentions de « la science ».
Dans « L’Auteur des graines d’acacias » (1974), le sens du message inscrit par une fourmi sur une graine d’acacias est débattu pas les chercheurs en thérolinguistique, et ils spéculent à propos d’un avenir où leurs collègues s’étonneront de ce que, à leur époque, on ne déchiffrait même pas le langage des aubergines. L’humour de la nouvelle de Le Guin tient au contraste entre l’histoire bouleversante de création de rapports nouveaux que suppose la thérolinguistique et le type de prose de l’académicien, qui, lui, reste ce qu’il est aujourd’hui, comme si cette institution qu’on appelle « la science » s’était maintenue inchangée.
Mais l’humour lui-même pourrait nous situer. Il pourrait rendre sensible un point de blocage qui fait que nous louons ou dénonçons « la science » mais envisageons fort peu les devenirs dont elle pourrait être susceptible. Et c’est ici que penser en mode SF me mène à la question du rôle des sciences sociales et humaines dans ce blocage. Car c’est à elles qu’aurait pu ou dû appartenir d’explorer les devenirs possibles de cette institution appelée « la science » qui, dans sa forme actuelle, ne remonte qu’au 19ème siècle. Qu’elles aient accepté la pseudo-unité des pratiques scientifiques comme normale, même si c’est pour dénoncer l’emprise de « la science », signifie qu’elles ont accepté le modèle du fait faisant autorité que porte cette institution. Et la première victime de ce modèle a été l’imagination – leur propre imagination non celle des véritables créateurs de faits, les expérimentateurs.
Si j’ai commencé mon intervention en montrant que toute transformation de Omelas en expérience de pensée massacrait le sens de cette nouvelle, c’est parce qu’il se serait agi alors d’une expérience de pensée propre aux sciences humaines. Rappelons-nous du conducteur du tramway hors contrôle. On peut aussi penser à la fameuse chambre chinoise de Searle. Chaque fois le protagoniste est privé de toute possibilité d’échapper à une situation définie de manière purement discursive, littéralement pris comme un rat, forcé de jouer le rôle que lui confère l’argument.
De telles mises en scène ressemblent à, mais n’ont rien à voir avec, les fameuses expériences de pensée propre à la physique, qui, elles, imaginent des mondes dramatisant les conséquences d’une hypothèse risquée, sur le mode du « si j’ai raison, alors… »
Ainsi lorsque Galilée posa la question de savoir où tomberait une pomme lâchée du haut du mât d’un bateau en mouvement, il intervenait dans la grande controverse académique de l’époque. S’il avait raison, contre les aristotéliciens pour qui elle tombera en avant ou en arrière du mât selon le mouvement du bateau, si, comme il le soutint, elle tombe au pied du mât, alors la terre peut se mouvoir sans que nous puissions observer les conséquences de son mouvement. Nous verrons les corps tomber à la verticale comme si la terre était immobile.
Or, l’expérience du bateau en mouvement n’avait jamais eu lieu. C’était une expérience de pensée. Nous pourrions la faire aujourd’hui mais essayez, à l’époque de Galilée, de lâcher une pomme du haut d’un mât d’un bateau poussé par le vent, ou descendant une rivière agitée : l’endroit où la pomme tombera dépendra des circonstances.
C’est au laboratoire que Galilée a appris à redéfinir le mouvement, et pour dramatiser les conséquences de ce qu’il avait appris, pour donner à ce qu’il savait désormais la force d’intervenir dans une controverse astronomique, il a dû raréfier la scène, éliminer tout ce qui brouillerait les conséquences. Son bateau ressemble plutôt à un train, un espace clos se mouvant à vitesse uniforme. Toutes les expériences de pensée des sciences expérimentales mettent en scène de tels mondes fictifs, raréfiés, mais ces fictions n’illustrent pas une thèse, elles prolongent l’imagination propre à la pratique expérimentale.
Au laboratoire, l’imagination a pour leitmotiv la question « et si ? » : « Et si mon hypothèse était juste, et cette question ouvre sur la possibilité d’un suspense : « Je devrais obtenir ce résultat. » C’est pourquoi, en cas de réussite il arrive que les expérimentateurs dansent dans leur laboratoire. Puis viennent des questions dont le leitmotiv est « mais alors ! » qui explorent imaginativement les conséquences envisageables de cette réussite, par exemple le « Mais alors la terre peut tourner sans que l’on observe les conséquences de son mouvement ! »
Et c’est précisément pourquoi les expériences de pensée des expérimentateurs constituent leur manière propre d’envisager une réalité plus vaste, celle que demandent leurs hypothèses pour pouvoir déployer toutes leurs conséquences. Les descendants de Galilée pratiquent à leur manière un mode de pensée SF car ils font de l’imagination un usage actif et spéculatif, ne s’adressant jamais à des états de fait mais à des faits qui les intéressent en tant que « conséquents », porteurs de conséquences possibles.
Bien sûr, la manière dont l’imagination expérimentale met à l’aventure nos idées et nos définitions ne peut être imitée. S’il n’y a pas de véritables expériences de pensée en sciences humaines, c’est parce que toute hypothèse portant sur ce dont sont capables les humains devrait s’adresser à un monde dense, où ses conséquences devraient pouvoir proliférer sur des modes multiples et enchevêtrés. Impossible dès lors de dramatiser une seule conséquence en éliminant toutes les autres, c’est-à-dire d’imaginer des « si… alors » qui susciteront la production de faits interprétables. Impossible de mettre en scène un monde fictif raréfié sans le mutiler, sans priver ceux qui l’habitent de leurs puissances de sentir, d’imaginer, de penser.
D’où ces situations imaginaires qui sont autant de cauchemars pour le conducteur du tramway hors contrôle ou pour le malheureux enfermé dans la chambre chinoise.
Mais les scientifiques qui font œuvre d’imagination dans leur laboratoire sont aussi dans l’imaginaire lorsqu’ils prêtent aux faits qu’ils y ont obtenus le pouvoir de rester fiables lorsqu’ils sortent de ce lieu. C’est-à-dire lorsqu’ils entrent dans un monde dense et enchevêtré, un monde qui se rit bien des preuves obtenues, parce qu’il ne connaît que des conséquences en cascade, des changements de signification inopinés, des interdépendances fécondes ou inquiétantes.
Prendre au sérieux ce monde qui ne cesse de décevoir les « si j’ai raison… » scientifiques, qui multiplie les conséquences enchevêtrées, demanderait des chercheurs l’exercice d’une imagination que l’institution que l’on appelle « la science » non seulement ne leur apprend pas mais qu’elle proscrit activement. Malheur à celui ou celle qui pose des questions dites non scientifiques, c’est comme s’il se laissait séduire et corrompre, il est perdu pour la science. Le mode SF doit inclure les faits scientifiques pour que les scientifiques prennent le goût d’une réalité plus vaste, au lieu d’en faire un lieu de perdition.
La question du fait scientifique en mode SF, demande d’envisager le fait expérimental, celui qui fait ses preuves dans le milieu raréfié que constitue le laboratoire, comme ce qui a mis les autres sciences, depuis la biologie et l’écologie jusqu’aux sciences humaines et sociales, face à un choix : soit conserver l’association entre faits et ambition de prouver, soit prolonger autrement le « et si ? » de l’imagination expérimentale.
L’institution de « la science » traduit le choix de la généralisation de l’association entre fait et preuve. Elle empêche donc de penser la variété des faits et transforme la preuve en droit. Contre l’imagination, elle impose la méthode, chargée d’extraire des faits dits objectifs, quelle que soit la violence mutilante de l’opération. En revanche, on pourrait dire que la science fiction dont Ursula Le Guin a fait l’éloge, a hérité à sa manière du prolongement de l’imagination expérimentale. Elle fabrique des mondes qui mettent à l’aventure nos idées et nos définitions. Elle met ce qui semble aller de soi sous le signe de la spéculation, du « cela aurait pu être autrement ».
Il m’est difficile, de ce point de vue, de séparer l’œuvre d’Ursula Le Guin des années soixante / soixante-dix, cette époque de contestation pratique, politique et culturelle qui mit à l’aventure l’ensemble des évidences portant sur la rationalité de notre dite « civilisation ». C’est l’époque que le philosophe Stephen Toulmin a, dans Cosmopolis (1990), associé non à une contre-culture, mais à une seconde renaissance, brisant la chape des savoirs autorisés qui exigent la certitude de la preuve.
C’est à partir de cette époque que, me semble-t-il, la science fiction que je nomme spéculative a bel et bien occupé la place de l’imagination exclue par nos sciences sociales et humaines, aussi bien positives que critiques. Elle a survécu à l’écrasement de la Seconde renaissance de Toulmin et au blocage général de l’imagination. À sa manière elle a repris la question « et si ? » mais les mondes qu’elle crée ne sont pas raréfiés pour dramatiser les conséquences d’une hypothèse, ils se densifient à mesure que l’hypothèse explore ses répercussions.
Les fictions spéculatives ne mettent pas en scène une idée mais un monde peuplé de personnages aux prises avec une situation qui les affecte, qui les fait sentir, penser et agir sur des modes contrastés, conflictuels, hésitants. Certains peuvent être porte-paroles d’une idée, mais cette idée, elle est ce par quoi ils sont habités, et, en tant que telle, elle participe à l’épaisseur de la situation, mais elle n’a pas le pouvoir de définir le sens de cette situation.
Lorsqu’elle nie avoir des idées quand elle écrit, Le Guin n’est donc pas modeste. Elle défend la densité enchevêtrée des mondes qu’elle crée. C’est pourquoi il est toujours dangereux pour un commentateur de croire reconnaître l’idée qui serait au centre de son histoire ou le personnage qui serait son porte-parole.
Ainsi, remarque-t-elle dans Words Are My Matter (86) beaucoup de commentateurs de Tehanu (1990) se sont attardés sur la manière dont la vieille Mousse répond à Tenar, qui l’interroge sur les pouvoirs des femmes. Mousse, dont la voix se met à chanter comme un instrument de musique, évoque des racines immémoriales plongées dans l’obscur, plus profondes que l’océan, plus anciennes que l’émergence des terres. « Personne, absolument personne ne sait ni ne peut dire ce que je suis, ce qu’est une femme, une femme de pouvoir, le pouvoir d’une femme » (107), déclame-t-elle. Et elle conclut : « Qui se risquerait à questionner les ténèbres ? Qui serait prêt à demander leur nom aux ténèbres ? » (Ibid.)
Le Guin note que cette évocation incantatoire de ce qui n’a pas de nom a fait l’objet de commentaires mettant en avant l’idée d’une mystique féminine, d’un savoir des profondeurs qui met au défi la rationalité masculine. Mais, écrit-elle, ces commentaires ont négligé ce que Tenar répond au « qui se risquerait » solennel de Mousse : « Moi, déclara-t-elle. […] J’ai vécu suffisamment longtemps dans les ténèbres. » (Ibid.)
Et c’est ce « moi » de Tenar que Le Guin revendique. Avec Tenar, elle résiste à une proposition qui mène à « transformer la connaissance des femmes en culte, nous flatter de connaître des choses que les hommes ne savent pas, parler de la sagesse profonde et irrationnelle des femmes » (Words, 85, traduction personnelle). Mais cela n’en fait pas pour autant la porte-parole d’une idée. Ni Tenar ni Le Guin n’ont d’idée à opposer à Mousse. Ce qu’elles partagent est un refus de laisser les mots aux hommes, de renoncer à la fabrique de mots qui vibrent juste, qui font exister ce qu’ils nomment, qui activent l’imagination et évitent l’obscurité envoûtante des profondeurs. Tenar refuse l’imaginaire, elle est cette réaliste d’une réalité plus large.
C’est pourquoi Ursula Le Guin – même si, écrit-elle, elle a appris des auteurs féministes des années 60-70 à écrire en tant que femme à propos des femmes – n’en est pas devenue pour autant théoricienne du féminisme, ni non plus militante. Terremer, dans le roman Tehanu, inclut désormais de manière explicite la différence entre les sorcières méprisées et les mages dont le pouvoir se paie par une chasteté rigoureuse. Mais Ursula Le Guin ne théorise pas les genres. Elle découvre plutôt, avec ses personnages, ce dont, hommes ou femmes ou autres, ils pourraient devenir capables.
Lorsqu’elle dit son accord avec Ténar, elle écrit :
Femmes, sortez de la cave, de la cuisine ou de la chambre des enfants. La maison toute entière est nôtre. Et vous, les hommes, il est temps que vous appreniez à vivre dans cette cave obscure dont vous semblez avoir si peur, et aussi dans la cuisine et la chambre des enfants. Et lorsque vous l’aurez fait, venez, parlons ensemble, autour du foyer, dans la salle de séjour de notre maison commune. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à apprendre. (Words, 86-87, traduction personnelle)
Et la nécessité d’apprendre n’implique pas la condamnation de ce qui a été. Dans Un Homme du peuple (1995), Havzhiva, envoyé de l’Ékumen, est plongé dans un monde dont les esclaves ont conquis la liberté mais qui est toujours marqué par une profonde inégalité de genre. Il sait que les choses vont changer, et il sait que sa présence contribuera inévitablement à activer ce changement, mais il sait aussi que son savoir d’historien ne doit pas lui servir de guide.
De l’extérieur, note-t-il, on peut voir les motifs, ce qui ne va pas, ce qui manque. « On veut réparer. Mais on ne peut pas. Il faut être à l’intérieur, dans le tissage. Il faut faire partie du tissage. » (189) Il faut apprendre à appartenir à un monde pour apprendre la manière dont les choses peuvent y changer. Et ce changement n’implique pas forcément la condamnation de ceux qui ont manié un pouvoir oppressif et dévastateur.
Dans Le vent d’ailleurs (2001), les mages craignent que l’art magique, qui a été mis au service du refus de la mort, ne disparaisse lorsque les morts, que ce refus a voués à une éternité stérile, pourront enfin rejoindre la terre. Mais le Portier ne partage pas cette crainte. Le choix de la maitrise, qui a séparé les humains des dragons, a pu entraîner une catastrophe, mais il implique aussi le bonheur de créer, de façonner. « Mais nous avons appris la Création. Nous l’avons faite nôtre. On ne peut pas nous la reprendre. Pour la perdre, nous devons l’oublier, la jeter. » (213)
Faire l’hypothèse que le Portier, comme Tenar et Havzhiva, parlent à l’occasion pour Ursula Le Guin, c’est peut-être aussi faire l’hypothèse que le Portier, parlant de l’art magique, parle aussi de tous les arts de création, scientifiques et techniques notamment, qui ont servi le pouvoir et qui peuvent être dénoncés comme tels. Mais bien sûr, Le Guin parle aussi de son art, art de fiction et de poésie, art de façonner les mots et les phrases. L’art des mots n’est pas innocent. Peut-être la science est-elle, comme les théoriciennes du féminisme ont bien des raisons de l’affirmer, une institution redoutablement genrée, reléguant dans les caves obscures ce qui échappe au pouvoir de prouver. Mais nommer, sur Terremer, est tout aussi redoutable. Pour Le Guin, rien de ce qui suscite la joie de créer, de fabriquer n’est condamné à être rejeté mais, comme elle l’écrit, « nous avons beaucoup de choses à apprendre.
Associer Ursula Le Guin au mode de pensée SF proposé par Donna Haraway, c’est donc ne pas avoir peur d’associer les arts de la magie et ceux de la preuve, mais leur demander à tous deux d’apprendre à se libérer de la peur qui leur fait se vouer à la chasteté, à la crainte de la corruption, d’apprendre à accepter que ce que nous créons, nous ne le maîtrisons pas.
Et accepter, pour Le Guin, n’a rien à voir avec se résigner. Là encore, je crois, Havzhiva parle pour elle : « Ouvrir mon esprit et accepter. C’est ça que j’ai appris en grandissant. À accepter. Pas à changer le monde : à changer l’âme. Pour qu’elle puisse s’intégrer au monde. Trouver sa juste place dans le monde. » (« Un Homme du peuple », 192)
Elle-même, comme auteure, doit également accepter sa juste place dans le monde que crée sa fiction. L’histoire n’a pas été construite pour permettre à l’auteure de dire ce qu’elle pense. Certes certains protagonistes le lui permettent parfois, mais ce qui importe est que ce soit le tissage même de l’histoire qui le permette, en des moments où ils rencontrent une vérité qu’ils sont devenus capables de formuler.
Ursula Le Guin le dit et le redit, « Quand je l’écris, une histoire ou un poème peut me révéler des vérités. Je ne les y mets pas. Je les trouve dans l’histoire à laquelle je travaille. » (Words, 48, traduction personnelle)
Peut-être pourrions-nous imaginer que ce que dit Le Guin de l’histoire qu’elle tisse, mais qui la tisse tout aussi bien, un physicien ou un chimiste pourrait le dire de son laboratoire, et certains biologistes d’aujourd’hui de ce que les vivants les obligent à apprendre, les forçant à abandonner les généralités abstraites qu’ils avaient confondu avec la vérité enfin scientifique de la vie. Et chaque fois ils le diraient sur un mode qui est celui de la gratitude. Réalisme et gratitude sont liés. On n’éprouve pas de gratitude envers-soi-même, mais envers quelque chose d’autre qui aurait pu se refuser.
Chaque praticien, l’écrivain, l’expérimentateur, le biologiste, tant d’autres, peut vivre des moments de gratitude lorsqu’il obtient la perception d’une réalité plus vaste. Car sa pratique était obligée par la possibilité de cet événement, mais ne lui en garantissait pas le droit.
Nous pourrions alors transposer aux rapports entre scientifiques et créateurs de fiction ce que Le Guin dit des rapports entre hommes et femmes : « Nous avons beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à apprendre. » Et nous pourrions le dire avec cette confiance que seule peut donner ce que Gilles Deleuze appelait la vérité du relatif pour l’opposer à la relativité du vrai. Car la vérité du relatif, la vérité issue d’une pratique, la vérité née des obligations qui tissent cette pratique à ses praticiens, n’a aucun besoin de s’imposer contre une autre, née d’autres obligations. C’est l’imaginaire qui rêve de vérité transcendant la diversité des pratiques et des circonstances. L’imagination n’est jamais hors sol, abstraite, il lui faut être située, attachée, avoir une maison pour ouvrir des portes.
Dans Le vent d’ailleurs, Ursula Le Guin met en garde contre la tentation d’imaginer pouvoir nous émanciper de nos attaches terrestres, à la manière des dragons de Terremer. Les dragons, qui parlent la langue de la création sans avoir besoin de l’apprendre, n’ont pas de maison. Ils n’ont donc pas à ouvrir de porte pour échapper à ce qui les paralyse. Ils ont la liberté du vent. Nous, qui avons fait le choix d’attachements qui nous situent, il nous appartient d’apprendre à ouvrir ces portes, d’expérimenter avec les possibles. À honorer les vérités qui nous situent sans leur prêter le pouvoir imaginaire d’échapper à la contingence et au changement.
Pour finir ce trajet tout en méandres, peut-être pourrions-nous revenir à la question qui l’a accompagné, celle de ces sciences humaines et sociales qui sont hantées par l’objectivité et ont abjuré la spéculation. Comment les penser en mode SF ? Comment pourraient-elles cultiver la gratitude ? Comment pourraient-elles échapper au vœu de chasteté qui les protège de ce qu’elles assimilent à des croyances ? Comment pourraient-elles créer des vérités qui fassent percevoir une réalité plus vaste et non des généralités abstraites qui semblent avoir pour vocation de vider cette réalité de tout possible ? Comment pourraient-elles trouver leur juste place dans ce monde ?
C’est par sa pratique, et avec sa pratique, qu’Ursula Le Guin a pensé et imaginé. D’autres, telles les femmes de Yeowe ont pensé à travers la création de pratiques de lutte. Mais ce sont peut-être les envoyés de l’Ékumen, dont la pratique est au centre de la nouvelle « Un Homme du peuple » qui ont été pour Le Guin l’occasion d’une expérimentation spéculative portant sur la manière dans les sciences sociales, humaines et historiques pourraient trouver leur juste place dans nos mondes.
On le sait, les envoyés de l’Ékumen ne doivent surtout pas penser leurs savoirs comme arme de lutte et de dénonciation. Ils savent beaucoup de choses mais leur pratique leur demande de rester neutres. Et cela, non pour être « objectifs » mais par obligation pratique. S’il doit y avoir changement, ce sera celui dont les peuples qui les accueillent se seront rendus capables. Si des portes doivent s’ouvrir, ce sera parce que celles et ceux qui habitent cette maison les auront ouvertes.
La pratique des envoyés ne traduit ni tolérance, ni détachement. Ils savent que leur seule présence fissure l’évidence de l’ordre établi, fait penser et imaginer, implique que les choses pourraient être autrement. Havzhiva ne s’en cache pas. Il n’a rien à cacher, mais la manière dont il fait attention, pose des questions, écoute, raconte, sont autant de manières de faire savoir ce qui lui importe, ce qui importe à tout envoyé de Hain : que le changement soit l’œuvre de ceux qui le porteront. Par sa seule présence, il apporte certes les germes du changement, mais ces germes doivent être nourris par le sol qui les reçoit.
Et Havzhiva, lui aussi, peut faire l’expérience de la gratitude lorsque son propre savoir s’est tissé avec ce monde où il a été envoyé et qui lui a appris comment il pouvait changer. Si la fiction que j’appelle spéculative et les sciences sociales et humaines ont des choses à se dire, ce pourrait être à partir d’une question commune, susceptible d’être partagée sur des modes différents. Cette question serait : comment notre époque nous rend-elle aujourd’hui capables de penser et d’imaginer comment elle pourrait changer ? Cette question demanderait d’apprendre à penser sur le mode du so far, attentif aux possibles qui poussent dans les interstices.
Ce que j’ai appelé un mode de pensée SF, que j’ai repris de Donna Haraway, est une proposition sérieuse, une proposition pour aujourd’hui. Car aujourd’hui les définitions faisant autorité nous étranglent et nous condamnent. Nous sommes dans la situation de blocage qu’Ursula Le Guin associait au transit entre deux vols. Nous sommes comme en suspens, coupés de toute prise autre qu’imaginaire, dans une réalité rétrécie, aux vitres incassables et aux portes verrouillées. C’est pourquoi nous autres, académiques, avons vitalement besoin des récits que rapportent ceux et celles qui explorent des possibles, et cela pour nous en faire les relais plutôt que pour les commenter, ou alors devrions-nous les commenter au sens de « penser avec eux ». Oser penser sur le mode SF, c’est-à-dire tenter de transmettre à nos étudiants d’autres choses que des raisons de désespérer, me semble pour nous un devoir.
Bibliographie
Haraway, Donna J., 2016, Staying with the Trouble. Making Kin in the Chthulucene, Durham and London, Duke University Press. Voir aussi Haraway 2013, « SF: Science Fiction, Speculative Fabulation, String Figures, So Far », Ada – A Journal of Gender New Media & Technology, n° 3 [adanewmedia.org/2013/11/issue3-haraway/], consulté le 18 avril 2020.
James, William, 1916 [1896], « Les moralistes et la vie morale », La Volonté de croire, trad. Loÿs Moulin, Paris, Ernest Flammarion [gallica.bnf.fr], p. 200-229.
_____ 2006 [1911], Introduction à la philosophie, trad. Stéphan Galetic, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond.
Le Guin, Ursula K., 2018 [1973], « Ceux qui partent d’Omelas », Aux douze vents du monde, Saint-Mammès, Le Bélial’.
_____ 1988 [1974], « L’Auteur des graines d’acacia », Les Quatre vents du désir, trad. Martine Laroche & Philippe Rouille, Paris, Presses Pocket.
_____ 1991 [1990], Tehanu, trad. Isabelle Delord-Philippe, Paris, Robert Laffont, coll. « Ailleurs et demain » (version epub).
_____ 2007 [1995], « Un Homme du peuple », Quatre chemin de pardon, trad. Marie Surgers, Nantes, L’Atalante, p. 127-193.
_____ 2012 [2001], Le vent d’ailleurs, trad. Patrick Dusoulier, Paris, Robert Laffont, coll. « Ailleurs et demain ».
_____ 2014 [2003], Changing Planes: Stories, Boston, Houghton Mifflin Harcourt.
_____ 2019 [2016], Words Are My Matter: Writings on Life and Books, Boston, Houghton Mifflin Harcourt.
Terranova, Fabrizio, 2019, Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, New York, Icarus Films.
Toulmin, Stephen, 1990, Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity, Chicago, University of Chicago Press.
1 Cet article est tiré d’une conférence plénière donnée lors du colloque Héritages d’Ursula Le Guin, organisé à la Sorbonne Nouvelle du 18 au 21 juin 2019.