5-De quoi les romans peuvent-ils nous rendre capables ? Ursula K. Le Guin, Tenar et le feu de l’imagination
Thierry Drumm I. Les idées n’expliquent rien En novembre 1975 paraissait un numéro spécial de la revue Science Fiction Studies, consacré…
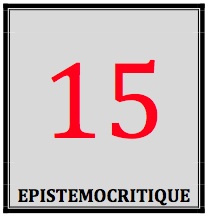 Epistémocritique, Volume 15. Savoirs et littérature dans l’espace germanophone.
Epistémocritique, Volume 15. Savoirs et littérature dans l’espace germanophone.
On assiste aujourd’hui à une véritable explosion des recherches sur les savoirs et la littérature en Europe. Il devenait urgent de rendre compte de la vitalité de ces recherches en faisant un tour d’horizon des travaux qui essaiment aujourd’hui à travers toute l’Europe. Cette quinzième livraison d’Epistemocritique initie ce tour d’horizon par un état des lieux de la recherche dans les pays de langue allemande (Allemagne, Autriche, Suisse), où une variété d’approches et de positions différentes se sont développées, donnant lieu à des controverses parfois très vives. Réalisé par Hildegard Haberl, ce numéro d’Epistemocritique propose un éventail de quelques-unes de ces approches et orientations ainsi que des tensions et débats qu’elles ont suscités, témoignant de la vitalité d’un champ aujourd’hui en plein essor dans le monde germanophone.
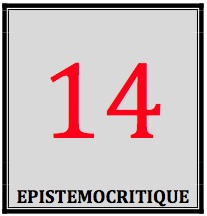 Epistémocritique, Volume 14. GREFFES.
Epistémocritique, Volume 14. GREFFES.
Greffes, hybridations, percolations… les métaphores ne manquent pas pour décrire la circulation des modèles, des idées et des représentations entre sciences et littérature. Parmi ces métaphores, celle de la greffe jouit d’une mémoire culturelle et d’une épaisseur historique toutes particulières : aux XVIIIe et XIXe siècles, elle a été mobilisée de façon massive par les scientifiques et les écrivains pour figurer différentes modalités du dialogue entre discours littéraires et savants. Les études réunies dans ce volume illustrent quelques-unes de ces modalités, interrogeant à partir d’exemples précis les rapports réciproques de la science et de la littérature, leur concurrence possible dans le champ du savoir, mais aussi la manière dont se constituent l’une par rapport à l’autre la « connaissance de l’écrivain » et la « connaissance du savant.
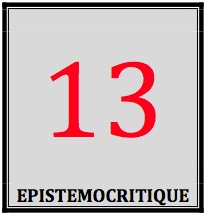 Epistémocritique, Volume 13. Littérature et savoirs du vivant.
Epistémocritique, Volume 13. Littérature et savoirs du vivant.
Depuis le 19ème siècle, moment où naissent les sciences du vivant, la circulation des modèles et des théories liés à ce domaine crée un espace de production épistémique qui permet aux représentations culturelles du vivant de se diffuser et de percoler dans la pensée historique, politique et sociale grâce à une série d’analogies, de déplacements métaphoriques, de généralisations et d’extrapolations. Les études réunies dans ce numéro visent à cerner la diversité de ces appropriations et des usages qui ont été faits des sciences du vivant dans le champ plus vaste des savoirs sur l’homme, mais aussi dans la production littéraire et, plus généralement, dans l’imaginaire, afin de mettre en évidences leurs enjeux idéologiques ainsi que les effets de culture qu’elles ont produit.
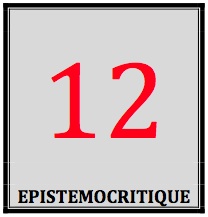 Epistémocritique, Volume 12. Littérature et économie.
Epistémocritique, Volume 12. Littérature et économie.
Le monde économique et le monde de la littérature et des arts ont souvent, depuis le Romantisme, été considérés comme antithétiques. Cependant les relations économiques sont présentes dans de nombreux textes et dessinent même une tradition littéraire. Après un bref parcours historique, du marchand dans la littérature du XVIIe siècle au Robinson de Defoe, des tribulations des personnages de Balzac dans le contexte du libéralisme naissant aux textes de Masséra, la littérature mettant en scène l’économie, surtout en période de crise, ne se contente pas de la représenter mais elle interroge les principes et l’éthique qui la fondent et entretient avec elle un dialogue constant .
Thierry Drumm I. Les idées n’expliquent rien En novembre 1975 paraissait un numéro spécial de la revue Science Fiction Studies, consacré…
Il s’agit de revisiter, dans une première partie, la notion de geste au travers des œuvres des préhistoriques. Les facultés d’attention, de perception, de création mettent en évidence la complexité qu’engage le geste dessiné. S’attachant aux œuvres de Giuseppe Penone, de Patrick Neu et Miguel Barceló, l’article montre dans une seconde partie l’appropriation de ces gestes dans certaines œuvres de ces artistes.
This essay asks what crisis does to critique, but also how critique can help theorize, and orient ourselves in, crisis, by thinking about breathing and race in the literature of the nineteenth-century United States “in the wake” of the pandemic of COVID-19. Drawing on Christina Sharpe’s In the Wake, as well as on studies of the atmospherics of power in the field of cultural anthropology, health humanities, environmental humanities and literary studies, I seek to elaborate a critical vocabulary for thinking about the specific crisis produced by a contagious disease travelling in the very air we share and breathe and, by extension, for thinking about the power dynamics of the airy yet material atmosphere that surrounds us. Moving from “suspension” to “distribution,” from “breathlessness” and “asphyxiation” to “aspiration” and “conspiration,” I reflect on the politics of contagion, on the risk and the promise of contamination.
La littérature s’est-elle jamais distinguée de l’univers des savoirs au point de s’en isoler totalement ? Ne trouve-t-on pas au contraire,…
Cet article aborde sous l’angle de l’exemple la reconnaissance exceptionnelle dont bénéficient les écrits Zola auprès des historien·ne·s étudiant l’olfaction au XIXème siècle. Cela permet d’éclairer la tension entre le caractère exceptionnel du traitement des odeurs chez Zola qui le distingue des autres auteurs, notamment naturalistes, et le caractère significatif, exemplaire, de ces évocations olfactives qui fait de Zola un témoin privilégié des senteurs de son époque. Cette double fonction de l’exemple qui relève autant de la norme que de l’exception, fait écho à une autre tension qui habite particulièrement la perception olfactive : les odeurs évoquent à la fois des souvenirs individuels, parfois même intimes, et des catégories très codifiées ou des conventions partagées par des sociétés entières. Pour mieux comprendre l’exemplarité de Zola en matière d’olfaction et expliquer les prérogatives que lui accordent les historiens actuels qui appuient souvent leurs démonstrations à la fois sur la singularité et la généricité de ses descriptions olfactives, il s’agira de mettre en perspective la fortune critique que connait l’écrivain auprès des historiens actuels avec l’histoire longue de la réception critique du sens de l’odorat chez Zola et des senteurs évoquées par ses romans.
Il est fréquent de comparer les expériences de pensée à des contes de fées pour en dévaluer le crédit épistémologique. Il s’agit ici de renverser cette analogie et de se demander si certains contes ne pourraient pas être conçus sur le modèle de ce genre d’expériences. "Les contes du temps passé" constituent à ce propos un cas paradigmatique, car en dépit de leur allure enfantine, ces histoires reproduisent de manière allégorique les idées que Charles Perrault avait défendues dans des écrits comme son "Parallèle des Anciens et des Modernes". Héraut de la modernité, Perrault n’a cessé de défendre une nouvelle poétique exacte et rationnelle et de prôner les méthodes scientifiques modernes de Galilée et de Descartes dont il s’est largement inspiré pour écrire des histoires comme "La belle au bois dormant" ou "Le chat botté". Mais c’est dans "Le petit chaperon rouge" que l’écrivain coule surtout ces nouvelles idées et méthodes, qu’il en fait l’application au moyen d’un style qui l’apparente à une expérience de pensée. Sous ce jour, cette fameuse histoire du temps passé apparaît comme un laboratoire imaginaire où s’exercer à la lecture moderne.
Eliane Beaufils Cette contribution part des intuitions théoriques développées par Ursula K. Le Guin dans son bref essai de 1986 « La…
Par l’entremise des notions d’entropie et de néguentropie, le présent article propose d’aborder la question de la préhistoire dans les deux récits La Grande Beune et La Petite Beune de Pierre Michon. L’univers fictionnel michonien, qui au premier coup d’œil semble immobilisé dans un épais brouillard archaïque, offre aussi différentes stratégies littéraires permettant de déployer une énergie susceptible de contrecarrer ce devenir uniforme et « informe » du monde. Dans un premier temps, nous chercherons à comprendre comment les paysages extérieurs et les environnements souterrains des grottes du paléolithique se contaminent mutuellement, ralentissant ainsi les diverses forces entropiques présentes dans le récit. Nous chercherons à ouvrir les strates du temps, permettant ainsi à un passé enfoui et oublié de refaire surface en se manifestant dans le monde visible. Dans un deuxième temps, en abordant la question de la calligraphie et de la chasse, nous souhaitons montrer comment l’écriture peut « se saisir » de la préhistoire sans la figer dans le temps. L’écriture et l’art pariétal apparaitront comme des gestes néguentropiques mettant en scène une production collective permettant de résister aux catastrophes de l’histoire.
During a discussion of her novel, Sing, Unburied, Sing, on National Public Radio (NPR), Jesmyn Ward recalls her experience of Hurricane Katrina: “I sat on the porch, barefoot and shaking. The sky turned orange and the wind sounded like fighter jets. So that’s what my mother meant: I understood then how that hurricane, that Camille, had unmade the world, tree by water by house by person.” The “weight of history in the South of slavery and Jim Crow makes it hard to bear up,” she continues. The future is full of worry, “about climate change and more devastating storms like Katrina and Harvey.” In Ward’s depiction of the wind as fighter jets, she imbues the violent elements of the hurricane with a martial quality that demonstrates how weather and, in particular, storms, hold the capacity to unmake the world. Her words reveal the fungible nature of oikos, or home, and a methodological process of undoing—waters that uproot trees that uproot houses that displace persons. And the details of the aftermath left unsaid—the racism laid bare by the storm, those attempts at unmaking, human by human. Yet it is the history of the US South, of slavery and Jim Crow, that Ward uses as the preface to her concern about a future full of storms wrought by climate change. In doing so, she foregrounds the racial dimensions of the Anthropocene by placing the carceral in conversation with the environment. Sing, Unburied, Sing also explores this much over-looked connection. By examining Sing, Unburied, Sing’s spectral twinning of racial and ecological violence, this essay traces what I call carceral ecology. Crafted from Ward’s imagining of a martial meteorology, carceral ecology transforms climatic phenomena like heat, rain, and storms into tools of western power. The novel thus unearths a southern history in which environmental design and manipulation have been used to maintain a carceral state of control. Looking to Sing, Unburied, Sing, allows us to sift through the different evolutions of carceral ecology—from its toxic presence in the communities of the US South, to its early stages on the plantation, and ending, finally, with the worldly arena of the Anthropocene.
Se situant dans la perspective d’une réflexion critique sur l’écriture de l’histoire de la vision, cet article étudie la manière dont l’œil et ses fonctions ont été appréhendés par la médecine au XIXème siècle. Il se base sur une analyse des publications à caractère médical et scientifique savantes et de vulgarisation du début des années 1850 aux premières décennies du XXème siècle, correspondant à la période où l’ophtalmologie s’affirme comme une spécialité médicale et à l’époque de l’essor de la presse scientifique de masse. La première partie montre comment l’exploration de l’œil entreprise par les médecins à travers l’ophtalmoscope et d’autres instruments optiques conduit à une reconfiguration profonde des connaissances sur l’anatomie et la physiologie de la vision. La deuxième partie décrit comment les études physiologiques portent à reconnaitre le caractère subjectif des perceptions visuelles et la fragilité du sens. La dernière décrit comment, à travers un rigoureux processus de classification et de rationalisation des connaissances nouvellement acquises, les ophtalmologues arrivent à re-objectiver les perceptions visuelles. Cet article met ainsi en question la théorie explicitée par Jonathan Crary qui soutient que la découverte du caractère subjectif de la vision au XIXème siècle entraîne une irréversible perte de confiance en ce sens comme moyen d’accès à la réalité du monde extérieur. Ce texte montre également que les recherches médicales autour de la vue trouvent une large diffusion dans la presse scientifique populaire, contribuant de cette façon à consacrer la médecine comme la science la plus autoritaire au sujet de la vision.
Appliquée aux humains, la notion de « préhistoire » est encore souvent entachée de connotations péjoratives. De plus, quand on l’ausculte, elle se révèle très floue, désignant une immense période dont les débuts sont difficiles à fixer, ce qui est tout bonnement impossible pour la fin sauf à défendre une vision dangereusement ethnocentrée de l’histoire des humains. De fait, l’archéologie révèle depuis peu combien le cours de cette histoire a varié, et cela depuis les temps très anciens. Il nous faut trouver aujourd’hui les moyens pour écrire cette diversité, sa connaissance précise nous prémunissant contre deux mythes plus ou moins vivaces, celui d’un progrès continu et celui, symétrique, de la déchéance depuis le Néolithique. Pour mieux saisir la multiplicité des imbrications entre humains et autres vivants au cours des temps, il reste aussi à proposer des récits moins anthropocentrés, l’histoire très ancienne constituant un terrain de choix pour s’y exercer.
Jonathan Hope, Université du Québec à Montréal, et Pierre-Louis Patoine, Sorbonne Nouvelle En engageant nos corps, les pratiques littéraires s’inscrivent dans…
En 1987, méditant sur sa visite de l’abri du Cro-Magnon en Dordogne après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, l’écrivain Clayton Eshleman conçoit avec sidération deux infinis ouverts en l’homme, notre “bigholeness” se creusant à la pensée de l’ancienneté humaine matérialisée par les crânes de nos ancêtres préhistoriques, aussi bien qu’à la prise de conscience d’une nouvelle menace née de mains d’hommes. Aucun lien de cause à effet n’existe entre la peinture préhistorique et l’usage, militaire ou civil, de l’énergie nucléaire. Pourtant, la confrontation des deux phénomènes apparaît comme un trope contemporain que ressassent les créateurs. Cet article interroge ce télescopage récurrent dans la création contemporaine qui n’a cependant rien d’évident de prime abord. Comment la conscience actuelle met-elle en résonance la très ancienne aptitude créatrice de l’homme et l’angoisse d’une auto-destruction de l’espèce par l’usage incontrôlé de l’énergie atomique ? À travers plusieurs exemples culturels de chocs signifiants entre éblouissement pariétal et hantise nucléaire, nous mettons en lumière l’émergence d’une poétique du carambolage temporel qui, en explorant conjointement la chance de l’inestimable et la peur de l’irréversible, exacerbe la conscience de notre fragilité humaine.
Ce 16e numéro de la revue Épistémocritique est né dans le dessein de rendre un peu plus visibles les diverses lignes…
L’intérêt de la contribution des humanités à la politisation de la crise climatique réside dans la façon dont elles ont rendu sensible un continuum entre nature et culture. Elles se sont pour cela appuyées sur certaines disciplines en particulier, dont la littérature et l’histoire, premiers instruments et objets d’une relecture environnementale de la culture. L’histoire de l’art, quant à elle, vient plus récemment de se saisir de cette même urgence : la nécessité d’adopter une approche écocritique. Dans ce contexte, l’art britannique offre un point de vue privilégié sur les origines industrielles du trouble. Les artistes britanniques furent en effet les premiers et les premières à représenter les effets d’un climat changeant, mais aussi à faire l’expérience professionnelle de points de vue modifiés par la pollution, par l’érosion du paysage, et plus généralement par le bouleversement du lien de l’humain à son environnement. Habitants et habitantes d’un Royaume qui s’est déployé sur des échelles variables allant de la nation à l’empire, ils et elles ont inauguré les mises en relation du planétaire et de l’infiniment petit. En avançant la proposition d’un concept intitulé « angloseen » permettant de synthétiser la notion géologique d’anglocène et les nouveaux modes d’attentions qu’elle nécessite, cet article s’applique à identifier les possibilités d’une démarche écocritique dans l’étude de l’art britannique, tout en confirmant la possibilité d’avoir une approche nationale de la question environnementale.
La société de production Composite Films s’est imposée ces dernières années dans le paysage des documentaires historiques, pour son expertise dans la colorisation de films d’archives. Cet entretien se propose d’expliquer les méthodes de travail utilisées, ainsi que de les inscrire dans la perspective de l’histoire des techniques cinématographiques, et de l’histoire des sens.
Partager, c’est bouger. Tout partage, qu’il soit social, économique, anthropologique ou scientifique, implique un déplacement de personnes, de valeurs et d’idées en réponse à une invitation ou à une question. Dans une collaboration, partager une pluridisciplinarité scientifique suppose d’accepter de pouvoir faire bouger les postures et trajectoires de recherche des partenaires mais aussi de repenser en les modifiant les points de vue de départ, voire de revisiter sa propre discipline. Cette disposition intentionnelle favorable à l’écoute, à l’échange, à la construction et au changement de point de vue qui fonde la démarche d’altérité a été placée au cœur d’un programme de recherche en Terre d’Arnhem (Territoire du Nord, Australie) à la demande de la communauté ethnique Jawoyn. Il est ici utilisé comme cas d’étude.
Les Actes du Colloque international Projections: Des Organes hors du corps sont en ligne ci-dessous au format PDF. Lien par articles.
Laurence Dahan-Gaida, Université de Franche-Comté La notion d’expérience de pensée connaît aujourd’hui une extension qui permet de l’appliquer à tous les…
This article examines Jonathan Franzen’s different writings on birds inspired by his intense birding around the world in the past twenty years. The autobiographical approach, close to Derrida’s redefinition of man as a suffering animal and exposition of animal plight, has gradually given way to the ethical fashion of the Great American Novel Freedom (2010) on endangered species and a number of ornithological essays contradicting the Audubon Society’s position on climate change.
Dans quelle mesure l’œuvre poétique, mêlant par nature facteurs socioculturels et convictions empiriques d’ordre anthropologique et esthétique, peut-elle être investie par les questionnements de l’histoire des sens ? Pour contribuer à répondre à cette question, cet article aborde le cas de Rilke, dont l’œuvre et les prises de position théoriques fournissent un remarquable exemple de trajectoire artistique où la sensorialité est sollicitée de façon multiple et originale, interrogeant aussi bien la manière d’être au monde de l’homme occidental que le rôle de l’artiste dans le contexte de la modernité industrielle.
Si l’acquisition de la notion de « préhistoire » a indéniablement pu correspondre à une véritable avancée scientifique lorsqu’elle est forgée au milieu du XIXème siècle, elle est depuis devenue un véritable obstacle épistémologique. S’opposant naïvement à la notion d’histoire, elle masque la compréhension d’une distinction plus profonde : celle du Paléolithique récent et du processus de néolithisation. Or avoir accès à une telle distinction permet de développer un autre type d’analyse et de comprendre l’art qui se déploie lors de chacune de ces deux périodes naïvement nommées « préhistoriques » en termes de modes d’être au monde.
Bruno Trentini, Université de Lorraine Ce travail sur les processus attentionnels et les états cognitifs afférents provient d’un constat sociétal qui…
A case study in the aesthetic genealogy of the now widely debated Gaia hypothesis, this article charts out a critical position for the environmental humanities within such a paradigm. Beginning with a historical assessment of William Golding’s major role in the development of a Gaian aesthetics, I then turn to his 1954 novel Lord of the Flies to explore its articulation between literature, ecology, and politics. Revealing the critical potential of Simon’s character, I develop a new way of approaching Golding’s canonical work by emphasizing its evental and experimental nature. Although Simon’s character has been approached as the tragic victim of an irredeemable human nature, I use a Deleuzian approach that grants him an immanent position and offers perspectives for the contemporary critical moment, at a time when critique is attacked on every front.
Mylène Pardoen est à l’initiative de nombreux projets de reconstitution historique du paysage sonore dont le Projet Bretez qui prend la forme d’une promenade virtuelle dans dans le quartier du Châtelet à Paris au XVIIIème siècle. À travers cet entretien, elle évoque le travail effectué en amont, sur les sources, et la méthodologie nécessaire à la réalisation d’un tel projet.
Dès sa découverte en 1856, Néandertal a été l’objet de représentations se voulant pour la plupart scientifiques. Cependant, ces associations entre savants et artistes n’ont pas échappé à de nombreux stéréotypes, poncifs, voire caricatures sur une supposée animalité d’Homo neanderthalensis. Le tout baignant dans une époque marquée par une volonté de hiérarchisation des « races humaines » fondée sur des arguments scientifiques, sur le colonialisme européen, et sur les débat philosophique et religieux sur la place de l’Homme, entre autres suite à la bombe darwiniste.
Penser avec Isabelle Stengers c’est courir plusieurs risques. D’abord celui d’être stengerisé (ou, comme un clin d’oeil à Mesmer, Stengerized), c’est-à-dire…
Je voudrais d’abord remercier les organisateurs et organisatrices pour cette occasion, qui est pour moi, et peut-être pour nous, une épreuve1.…
This essay addresses a diffuse category of matter figuring with increasing urgency in our imaginaries of the sea, its subsurfaces, and landfalls: mobile, shapeless biological and geophysical phenomena that are among the most devastating and unsettling evidence of our ongoing planetary ecological crisis. Drawing on an image of a massive jellyfish bloom in Jean-Marc Ligny’s 2012 post-Anthropocene novel Exodes, I briefly explore the relevance of the subjective experience of abjection to the churning, boundary-crossing structure of the image, before turning to George Bataille’s related concept of the formless (l’informe) and its leveling of anthropomorphism as a defining structure of human and non-human experience. I argue that Ligny’s vision of a clotted, pinkish soup churning at the ocean’s surface signals the tasks of the formless in imagery of the Anthropocene’s decline: the unsparing foreclosure of a naïve anthropomorphism and the basis of a utopian post-anthropology.
Expériences de pensée - dossier dirigé par Christine BARON et Charlotte KRAUSS Table des matières Introduction - Christine Baron 1 -…