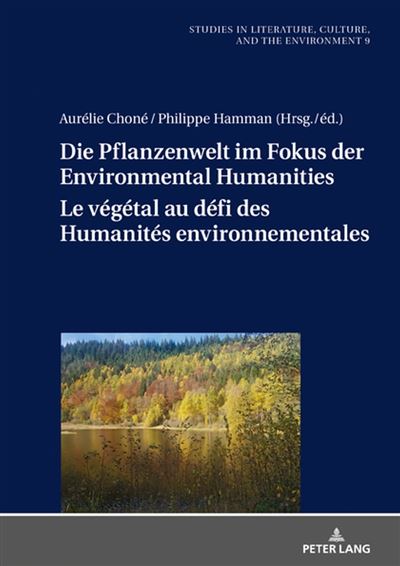Die Pflanzenwelt im Fokus der Environmental Humanities. Le végétal au défi des Humanités environnementales. Deutsch-französische Perspektiven/Perspectives franco-allemandes. Peter Lang, Berlin 2021, 348 pages.
Aurélie Choné (Éditeur de volume), Philippe Hamman (Hrsg./ed))
Avec ce volume, Aurélie Choné et Philippe Hamman poursuivent leur investigation des Humanités environnementales dont un temps fort fut la publication, avec Isabelle Hajek, du Guide des Humanités environnementales paru en 2016 aux éditions du Septentrion, suivi d’une version en anglais et de nombreuses publications sur le sujet, et y apportent une nouvelle contribution. Le présent ouvrage comporte, en plus de l’introduction qui replace les différents articles dans leur contexte, onze chapitres, six en français, cinq en allemand. Une première partie s’applique à faire le tour des dynamiques et enjeux du champ à l’échelle franco-allemande, qui permet de dépasser l’étroitesse des focalisations nationales voire nationalistes d’usage et s’ouvre également aux perspectives plus globales (comme par ex. dans la contribution de Jawad Daheur). Une deuxième partie, elle-même subdivisée, se penche sur des études de cas du règne végétal, en l’occurrence les jardins et les forêts. Chaque contribution est précédée d’un résumé en anglais et suivie d’une bibliographie témoignant de l’importance de l’existant et de sa fécondité en perspective.
Tenter de penser autrement le rapport de l’homme à la nature, tel est, selon A. Choné et P. Hamman, l’un des enjeux majeurs des Humanités environnementales et signifie questionner autant l’homme que son milieu et leurs interactions, en s’éloignant du paradigme de la maîtrise, ou du moins de la domination. Cela implique de multiplier les angles d’approche disciplinaires et méthodologiques et de les amener à se compléter, de réexaminer les perspectives historiques et géographiques et de redéfinir les objets de l’investigation.
La proclamation de l’anthropocène place ces volontés de renouveler les sciences humaines sous le signe de l’urgence. Elle met également en lumière la nécessité d’élargir la perspective des sciences qui en ont proposé le concept (chimie, biologie, géologie) comme le souligne Christopher Schliephake en attirant l’attention sur cet « anthropos » dont le singulier interroge, un singulier qui gomme les dimensions politiques, socio-économiques, culturelles, autant que la profondeur historique. Les humanités environnementales ne sauraient en effet se limiter à la période relativement récente où l’impact géophysique de l’homme sur la terre est visible. Réinterroger l’Antiquité signifie aussi réexaminer sous de nouveaux angles la division entre nature et culture, telle qu’on peut l’appréhender notamment dans la/les mythologies, en amplifiant également la perspective géographique. Que l’on puisse attendre des pistes esquissées de nouveaux savoirs ne fait aucun doute, a fortiori — ajouterions-nous volontiers — si l’on intégrait dans la réflexion la richesse des nombreux travaux consacrés à l’origine des sciences modernes sans lesquelles les encouragements à maîtriser le monde, qu’ils soient bibliques ou cartésiens, n’auraient pas eu les effets que l’on sait. Remarquons également — et cela vaut pour l’ensemble de l’ouvrage — que les références bibliographiques ne sont pas souvent antérieures à l’an 2000, ce qui revient aussi à se priver de travaux anciens et néanmoins précieux.
L’élargissement disciplinaire, historique et géographique, des études environnementales nécessite de toute évidence des moyens en recherche importants. Un tour d’horizon des centres déjà actifs — avec un point sur Augsbourg, Munich, Fribourg — et des projets en cours, dressé par Hubert Zapf et Evi Zemanek montre que la situation en Allemagne semble prometteuse et pour l’heure plus dynamique qu’en France, et n’oublie pas les ouvertures vers la Suisse et l’Autriche. Soulignant d’entrée de jeu que d’affronter les problèmes écologiques ne saurait être l’apanage des sciences de la nature et de la technique, H. Zapf et E. Zemanek font valoir les atouts de la littérature comparée, plus largement des études littéraires — « le concept de littérature en tant qu’écologie culturelle » (p. 79) —, l’importance de l’écologie politique, les apports du champ « culture et communication », les multiples réseaux et synergies en train de se structurer.
Urte Stobbe en donne une première démonstration en esquissant tout d’abord une présentation globale de l’inscription des plant studies dans les études littéraires et culturelles, déterminée par les recherches récentes — encore controversées il est vrai – engageant à porter un regard nouveau sur les végétaux auxquels on attribue désormais des « capacités cognitives, sensitives et communicatives » (103) telles qu’il devient nécessaire de s’interroger sur le statut d’objet auquel on les cantonnait jusqu’alors, voire de les envisager comme sujets de droit. Ici, le monde anglo-saxon s’avère en avance sur le plan théorique. Puis, U. Stobbe illustre son propos par une étude de Pfaueninsel (2014) de Thomas Hettche, en s’appuyant sur les analyses déjà nombreuses de ce roman où l’on discerne le souci d’une nouvelle manière de concevoir les relations entre les divers êtres organiques vivants, plantes et animaux apparaissant non plus comme des choses dont l’homme pourrait disposer à sa guise, mais comme des êtres avec lesquels il s’agit de partager le monde (Mit-Wesen). Pfaueninsel (l’ile en question fut aménagée à la fin du XVIIIe siècle près de Potsdam pour le roi Frédéric Guillaume II) présente un modèle réduit de l’intrusion autoritaire de l’homme dans la nature, l’aménageant, déplaçant les espèces, leur imposant des modes de vie inaccoutumés et des cohabitations inédites. La présence d’humains que leurs propres différences rendent particulièrement sensibles et réflexifs, permet des changements de perspectives, des déviations des modes de penser et de sentir habituels. U. Stobbe reconnaît que le roman n’échappe pas à l’anthropomorphisme, mais porte à son crédit le point de départ éthique postulant que tous les êtres sont égaux, à partir duquel doit pouvoir se poser autrement la question de leur cohabitation.
Jawad Daheur introduit quant à lui au deuxième volet de ces études sur le monde végétal, l’histoire des forêts, en partant des interactions au niveau franco-allemand, replacé dans un contexte d’histoire globale, prenant en compte les transferts et échanges les plus divers, afin de « sortir du “grand récit” de l’occidentalisation de la planète » (124). La vue d’ensemble de l’histoire forestière qu’il esquisse, intimement liée au développement du capitalisme marchand depuis le 16e siècle, propose le cadre indispensable dans lequel s’inscriront les trois dernières contributions de l’ouvrage.
La deuxième partie du volume, consacrée à des études de cas, traite tout d’abord de textes littéraires, confrontant des auteurs de langue allemande et de langue française, respectivement Valérie Fritsch (Winters Garten, 2015) et Pascal Quignard (Dans ce jardin qu’on aimait, 2017) pour Hildegard Haberl, et Jean-Jacques Rousseau, Goethe, George Sand et Hermann Hesse pour Corinne Fournier Kiss. Toutes deux ancrent leurs analyses dans un retour historique au XVIIIe siècle et adossent leurs relectures des textes étudiés à des historiens du jardin, en particulier Gilles Clément. H. Haberl tente de saisir la spécificité de l’engouement contemporain pour le jardin, successivement sous l’angle du « tournant environnemental », du « tournant spatial » et du « tournant émotionnel ». Dans Winters Garten, le jardin est à la fois le paradis perdu et peut-être l’ultime refuge face à la catastrophe imminente, chez Quignard plus particulièrement sous forme poétique, il est le lieu par excellence d’une nouvelle manière de sentir. C. Fournier Kiss adopte une perspective temporelle inverse : les textes choisis, parus à 50 ans de distance les uns des autres, nous introduisent dans des jardins traduisant « une véritable préoccupation pour la nature en tant que telle ; une alternative, donc, qui promet un équilibre plus sain entre nature et culture, et qui en appelle par là même à une éthique que nous pourrions appeler “écologique” avant la lettre. » (188) Manipulation de la nature ou jardin naturel ? Cette alternative est au cœur des échanges entre Saint-Preux et M. et Mme de Wolmar, dans le chapitre XI de la quatrième partie de la Nouvelle Héloïse, sans trouver de réponse univoque. C. Fournier Kiss interprète les commentaires et objections de Saint-Preux comme des critiques de ce lieu selon lui inutilement dispendieux, malgré tous ses charmes, critiques qu’elle rapproche du rejet rousseauiste de la clôture. Dans les Affinités électives, le jardin est le milieu omniprésent au sein duquel se déroulent les événements qui bouleverseront les relations entre les quatre protagonistes, « manifestant une conscience écologique en creux » (197) dans la mesure où la nature « trop contrariée, trop manipulée » (197) finit par se venger, la catastrophe culminant dans la mort de l’enfant de Charlotte et d’Edouard. George Sand, dans les Mémoires de Jean Paille, met en scène un petit-fils de Rousseau, lequel dans leur unique entrevue, se déclare « jardinier selon la nature » (199), une caractérisation correspondant à l’idéal sandien du jardin naturel. Enfin, de l’œuvre de Hermann Hesse, C. Fournier Kiss retient Iris et son « jardin vivant », où « les frontières entre humains et non -humains ne semblent plus faire loi » (205). Cependant, c’est la richesse même des textes étudiés qui embarrasse, lorsqu’il s’agit de les lire comme des témoignages précoces de « l’écologie humaniste du paysagiste français Gilles Clément » (205). Peut-on vraiment parler « des prises de position exprimées par les quatre écrivains » (205) dans ces fictions ? Saint-Preux est-il Rousseau, le narrateur des Affinités électives Goethe ? Mais surtout : la nature qui intéresse Saint-Preux est-elle celle dont parlent les Humanités environnementales ? Lorsque ce dernier souffre des contraintes auxquelles la nature est soumise, n’est-ce pas avant tout de l’ordre social et patriarcal qui entrave les sentiments emportant l’un vers l’autre Julie et son amant qu’il souffre, et n’est-ce pas à cela qu’il fait allusion lorsqu’il donne à entendre que le bosquet devant la maison (cf. lettres XIII et XIV de la première partie) devait faire de l’Élysée un « amusement superflu » ? Et n’est-ce pas Ottilie qui cause la mort accidentelle de l’enfant de Charlotte et d’Edouard, après la bouleversante rencontre avec Edouard qui la fait agir dans une précipitation fatale ? Que signifie l’affirmation que tout se passe comme si la nature se vengeait ? Le fameux glissement de terrain n’est pas dû aux jardiniers téméraires, mais à l’affluence excessive lors de la fête démesurée en l’honneur d’Ottilie. Analyser ces œuvres sous l’angle principal du jardin, qui plus est avec une grille de lecture contemporaine, revient à en écraser la dimension symbolique, pourtant fondamentale ; les lire comme des précurseurs « à leur façon et avec leurs mots » (207) de la conscience écologique de l’humanité actuelle dessert cette conscience écologique parce qu’elle sape les bases historiques et contextuelles des notions qu’il s’agit de repenser, la nature, l’humain, la culture.
C’est sur une tentative de mettre en pratique « une expérience d’écologie radicale » (209), l’histoire d’une communauté rurale, Sieben Linden, établie à proximité de Gorleben, l’un des sites les plus célèbres des luttes antinucléaires des années 1980 que se conclut cette partie de l’ouvrage. Anne-Marie Pailhès analyse l’échec de cette expérience, échec de son point de vue autant que de celui des acteurs qui s’exprimèrent publiquement sur leur vécu, sans qu’il apparaisse très clairement à quelles conditions on aurait pu parler de réussite. Visait-on l’autosuffisance ou la décroissance ? Vivre en pesant le moins possible sur l’environnement, telle semble avoir du moins été l’ambition des participants les plus motivés auxquels on a reproché, ou qui se sont reproché à eux-mêmes, de s’enliser dans les contradictions, incapables par ex. de se passer des subventions et formations publiques, ou des chutes et déchets de la société industrielle. Notons que se servir des déchets de la société industrielle s’appelle aussi recyclage et passe pour une base du développement durable ; bénéficier des biens communs (subventions de l’État) est un droit de tout citoyen. Quoi qu’il en soit, l’expérience semble pourtant bien avoir survécu1, ou du moins avoir trouvé un nouveau souffle, moins ascétique sans doute.
La partie de l’ouvrage consacrée aux jardins ne se situe pas sur le même plan que la partie consacrée aux forêts. La première n’envisage guère le jardin vivrier et se place surtout sur le plan éthique, alors que la question forestière est d’emblée abordée sous l’angle de l’utilité et de l’intérêt économique.
La contribution sur la forêt de Philippe Alexandre, centrée sur le XIXe siècle, fait le récit des analyses et préconisations de forestiers de part et d’autre du Rhin, en suivant la circulation de leurs études, leurs échanges et divergences et les controverses qu’elles entraînent, sur la base des besoins en bois divers selon les périodes et les lieux, plus généralement du fait de l’industrialisation. Les différends théoriques et pratiques sur les objectifs à atteindre et les méthodes à mettre en œuvre ont pour trame commune l’opposition entre ceux qui privilégient les sources de revenus à court terme (l’État français intéressé par le bois de marine, par ex.) et ceux qui, prenant en compte l’importance du facteur temps pour la croissance des forêts, retiennent la nécessité de se projeter dans l’avenir. C’est là que s’infiltre l’argument éthique de l’intérêt des générations futures. L’étude de la circulation des personnes et des visions entre l’Allemagne et la France fait apparaître, derrière le recours aux arguments identitaires et culturels, les intérêts et désaccords souvent plus triviaux, différences des sols, populations d’arbres, étendue des forêts, marchés, etc. Autour de 1900, ce sont « les besoins du marché » qui donnent le ton, entre bonne gestion d’une richesse à exploiter ingénieusement et négociation habile des intérêts impliqués.
Michel Dupuy se focalise sur la forêt en tant qu’écosystème, toujours une « co-construction avec les sociétés humaines » (271) et déchiffre mythes et crises traduisant une insuffisante prise en compte de cette réalité. Ainsi, la représentation d’une « forêt naturelle » fait-elle partie des mythes qui peuplent désormais nos imaginaires et nos attentes. Les interventions de l’homme sur la forêt sont en effet loin d’être un phénomène récent, comme le confirment les moyens techniques les plus avancés (le LIDAR). Quant aux crises, nombre d’entre elles ne sont que des postulats souvent invalidés par la suite des événements ou des analyses, le cas le plus récent étant la crainte de la mort des forêts qui s’empara tout particulièrement de l’Allemagne en 1981. Cependant, elle eut pour conséquence heureuse une lucidité nouvelle face aux dommages effectifs causés à la nature, et des mesures incontestablement utiles (en France, l’usage du pot catalytique). Et sans doute a-t-elle contribué à accélérer la prise de conscience de la complexité des interactions entre l’homme et son environnement et la nécessité de comprendre mieux les multiples enjeux des actions humaines sur la nature, ce à quoi s’emploient précisément les Humanités environnementales.
Enfin, Paul Averbeck, Florence Rudolf et Julie Gobert resserrent davantage encore la perspective, géographiquement en se penchant sur deux partenaires de part et d’autre de la frontière franco-allemande, le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et la Réserve de Biosphère du Pfalzerwald, et en interrogeant les positions des « acteurs » de la forêt. Leur travail repose sur une enquête et des interviews. Si la forêt naturelle s’avère être un mythe, qu’en est-il de cette naturalité dans un Parc qui lui est consacré ? Comment cette notion oriente-t-elle les décisions à prendre en matière de choix d’espèces, d’aménagement des espaces, de gestion de la faune, etc. ; comment les différents acteurs font-ils valoir leurs attentes ? Cette catégorie de l’acteur permet une analyse différenciée, mais reste peu définie. Elle désigne visiblement professionnels, industriels, écologistes ; enfermés dans leurs antagonismes, ils devront s’en remettre à la médiation du politique, dit la conclusion. Cependant, nulle trace de « l’acteur » auquel s’adresse le site web du Parc : le touriste, le randonneur, l’amateur d’escape game au four à chaux, l’habitant du Parc, etc.
Les Humanités environnementales contribuent-elles à désenchanter le monde, « par leur démarche scientifique » (M. Dupuy, 288), ou au contraire le réenchantent-elles lorsque, par exemple, elles décèlent une nouvelle empathie entre êtres humains et animaux ou végétaux (U. Stobbe, 116) ? Il faut porter au crédit de l’ouvrage la diversité des perspectives et la part belle faite aux études littéraires, qui assurent la médiation entre les sciences, quelles qu’elles soient, et la réalité des êtres. En l’occurrence, pour les études littéraires, il semble acquis que la maîtrise de la nature, ou plutôt la volonté de l’homme de s’imposer à la nature, est désormais inacceptable. La nouvelle voie, celle de la conscience écologique contemporaine s’appuie sur une éthique qui gagnerait cependant à être précisée. Le changement climatique invite-t-il à une révolution des comportements humains par respect pour la planète menacée, ou tout bonnement pour la survie de notre espèce ? Quant à l’anthropocène, est-il vraiment une « nouvelle ère géologique » (23) ou ne vaudrait-il pas mieux affronter les nombreuses et riches controverses que sa « proclamation » a suscitées (cf. Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène, La Terre, l’histoire et nous [Le Seuil, nouvelle édition 2016] ? Et s’il est vital de mobiliser une nouvelle interdisciplinarité pour en combattre les menaces, il pourrait être tout aussi vital de ne pas s’en tenir à une cohabitation distante entre Humanités environnementales et technosciences qui laisserait ces dernières dire le vrai sur la nature, mais de les intégrer, elles aussi, dans un dialogue critique.
1 https://siebenlinden.org/de/