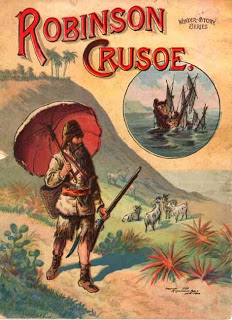Introduction
Le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoé, est, pour reprendre l’expression de Jean-Paul Engélibert, un « mythe littéraire de la modernité ». Le succès immédiat du roman, l’éloge qu’en fait Rousseau dans l’Émile, les hommages de Stevenson ou Conrad, le nombre et la variété des réécritures – robinsonnades collectives apparues dès le XVIIe siècle, robinsonnades inversées du XXe siècle – font de Robinson un personnage qui à la fois reflète et construit la représentation que l’homme moderne se fait de lui-même.
Les économistes se sont emparés de ce mythe pour le dénoncer ou au contraire pour y trouver confirmation de leurs approches. Robinson est sans doute l’un des rares personnages romanesques à avoir imprégné, même superficiellement, l’économie politique : le New Palgrave, dictionnaire de référence dans la profession, comporte une entrée « Robinson Crusoé » dans laquelle le roman est mentionné et discuté. C’est certainement le seul roman qui, en économie, jouisse d’un tel statut.
On observe pourtant une ambivalence dans l’usage que font les économistes du roman, ambivalence qui reflète et redouble celle du personnage lui-même. Dans le roman comme dans les commentaires qui en sont donnés, en économie comme en littérature, l’économiste est frappé par la confusion en un même personnage de plusieurs types d’agents économiques, non seulement différents mais contradictoires. On discutera ici les motifs et les enjeux de cette confusion des personnages, en faisant l’hypothèse que cette confusion est peut-être ce qui permet d’exprimer au mieux les contradictions des agents économiques que nous sommes.
Après avoir établi un état des lieux des interprétations et usages du roman en économie et en littérature, on montrera comment l’expérience de l’île déserte transforme Robinson qui, d’agent soumis à un désir d’enrichissement illimité, devient un homo œconomicus au sens où le terme est employé dans la théorie économique depuis le XIXe siècle, cherchant à accroître son bien-être grâce à son travail. Mais on fera aussi apparaître comment, paradoxalement, Robinson annonce un anti-homo œconomicus, défini par le dépassement des contraintes d’une économie vouée à la subsistance.
I.Etat des lieux : les ambivalences d’un mythe
L’ambivalence du personnage de Robinson s’observe aussi bien dans les usages qui en ont été tirés par les économistes que dans les interprétations qui en ont été données en littérature. En économie tout d’abord, il faut distinguer le personnage de Robinson des robinsonnades qu’imaginent les économistes classiques de la fin du XVIIIème et du début du XIXème siècle. Ceux-ci s’intéressent peu au personnage de Defoe et mettent en scène des agents isolés – semblables en cela, mais en cela seulement, à Robinson – dont le hasard organise la rencontre. Ces robinsonnades illustrent la théorie de la valeur : elles ont pour fonction d’établir les conditions de l’échange, abstraction faite des circonstances historiques.
Marx, on le sait, dénonce ces robinsonnades (Marx, Critique, 235) pour affirmer la différence essentielle entre le travail de Robinson, immédiatement social, et le travail privé de l’agent marchand, dont le caractère social est possiblement problématique. Il inaugure ainsi une tradition critique du naturalisme de l’économie politique, tradition dans laquelle qualifier une théorie de robinsonnade revient à la disqualifier : à la fois parce que l’aventure de Robinson est la fiction d’un individu isolé que l’on présente comme un homme ‘naturel’, alors que toute réalitééconomique est historique ; et parce que les questions essentielles de l’économie tiennent moins à l’individu et à son comportement qu’à la coordination de ces comportements à travers des procédures collectives et qu’alors, ramener les questions de l’économie à celles de Robinson, c’est s’interdire de poser correctement les problèmes économiques (Marx, Capital, 611).
Quand Marx ironise sur le goût de l’économie politique classique pour le robinsonnade, les premiers auteurs néo-classiques de la fin du XIXème siècle revendiquent à l’inverse le personnage de Robinson pour affirmer la vérité psychologique de leur approche : chez Jevons, Menger, Wicksteed, Böhm-Bawerk ou Marshall (voir l’article du New Palgrave de White), Robinson Crusoé est évoqué pour incarner l’élément individuel immuable qui exprime une nature humaine au fondement de toute économie :
« Le rôle de l’économie de Robinson Crusoé, chez les auteurs de la fin du XIXème siècle, n’était pas simplement d’illustrer des éléments variés de la théorie de l’offre et de la demande, mais qu’il était aussi de soutenir l’affirmation selon laquelle les principes du comportement rationnel, tel qu’il était décrit par cette théorie, pouvaient s’appliquer à n’importe quel type d’économie, de l’individu isoléà la civilisation moderne » (White).
Ce sont ces auteurs qui définissent ce qu’il est convenu depuis d’appeler homo œconomicus, dont Robinson est l’archétype et dont on retrouve la trace dans la théorie économique la plus récente et la plus élaborée (Mas Colell et alii, 526).
Si le personnage de Robinson et la conception qu’il véhicule de l’économie sont, chez les économistes, ambivalents, la tradition littéraire d’interprétation du roman ne l’est pas moins. Deux interprétations prédominent : la première, économique et réaliste ; la seconde, allégorique et religieuse[1]. Selon l’interprétation religieuse, fondée sur une lecture symbolique du texte, l’aventure de Robinson est une allégorie inspirée de la tradition puritaine, le récit d’une conversion, et le séjour dans l’île se lit comme une épreuve spirituelle d’un héros en quête de salut.
On s’appuiera ici essentiellement sur l’interprétation économique, représentée notamment par Ian Watt. Le personnage de Robinson y incarne l’homo oeconomicus moderne à la recherche d’une réussite économique et sociale, et sa réclusion insulaire est la métaphore de la solitude de l’homme du début des Lumières. D’un point de vue plus contextualisé, cette interprétation lit le roman de Defoe comme l’expression du développement des classes moyennes après la révolution de 1688 : le roman traduirait l’émergence de la bourgeoisie.
Cette interprétation s’appuie sur 3 thèmes que développe le roman :
i) Le premier est le retour à la nature qui inscrit l’économie de Robinson dans la nature des choses. Cette lecture du roman comme le récit d’un retour à une vie agricole et sans société est principalement pour Ian Watt, la lecture de Rousseau : Robinson, dit Rousseau, développera l’imagination d’Émile vers le travail matériel et lui apprendra à accorder ses jugements non à ceux d’autrui, mais à l’utilité des choses. Il faut ajouter qu’elle est aussi, assez paradoxalement, la lecture des premiers économistes néo-classiques qui définissent l’agent, avant même l’échange, dans ce rapport à la nature qu’est la production non socialisée.
ii) Le second thème économique du roman, sans doute le plus important, est l’exaltation de la dignité du travail, credo du capitalisme qui fournit une contrepartie idéologique à la division du travail. Robinson récapitule l’histoire heureuse du développement économique de l’humanité en se réappropriant les savoir-faire très divers et en se procurant, par ce travail, une multitude d’objets qui améliorent son bien-être. La place du travail dans la construction de l’agent, de l’individu, est y semblable à celle qu’elle commence à occuper dans la société.
iii) Le troisième thème économique enfin est la solitude de Robinson, qui devient la métaphore de l’isolement de l’individu moderne après la dissolution des liens sociaux traditionnels, c’est-à-dire, dit Watt, la métaphore de l’atomisation de l’homo œconomicus. Mais cette solitude métaphorise aussi l’isolement de la bourgeoisie anglaise du XVIIe siècle, qui vit comme Robinson dans un no man’s land politique. C’est pourquoi Robinson transpose sur l’île une économie rudimentaire qui à la fois rappelle et innocente le capitalisme naissant en Angleterre.
La nature, le travail, la solitude : trois thèmes à travers lesquels le capitalisme naissant se trouve transposé dans une économie qui définit l’homo œconomicus hors de l’histoire, dans un rapport à lui-même et à la nature, médiatisé par son seul travail. Cette première lecture économique du roman, qui naturalise le rapport de chacun à l’économie, est toutefois étroitement imbriquée à des thèmes historiques et sociaux puisque l’éloge de la solitude peut aussi être lu comme l’expression d’une situation historique particulière, celle de la bourgeoisie émergente dont Robinson est le héros. On trouve alors deux récits dans ce roman, ou le récit de deux conceptions de l’économie : le récit d’une économie hors de l’histoire, qui dirait la vérité de tous les agents économiques dans toutes les sociétés ; ou bien, en même temps, le récit d’un moment du développement économique de l’humanité : le capitalisme et l’émergence de la bourgeoisie.
Il faut enfin convoquer Marthe Robert qui, à partir du « roman familial des névrosés » exposé par Freud, propose une interprétation en partie économique, mais à travers des caractéristiques différentes de celles que l’on vient d’évoquer. Dans ce roman familial, l’enfant, lorsqu’il perçoit que la position sociale de ses parents n’est pas celle qu’il avait rêvée, élabore un récit de ses origines plus satisfaisant. Freud identifie alors deux récits : celui de l’enfant trouvé, qui, selon Marthe Robert, est incarné dans la littérature romanesque par Don Quichotte ; celui du bâtard, acharnéà faire son chemin, incarné par Robinson. Plus précisément, Robinson serait le récit du passage du roman de l’enfant trouvéà celui du bâtard : Robinson, dépité de la médiocrité de la position paternelle, se débarrasse de ses parents en fuyant. Cette fuite est un parricide dont le naufrage est le châtiment. Il est encore là dans le mythe de l’enfant trouvé. Mais le naufrage est aussi un baptême qui lui permet de commencer une nouvelle vie où il reconquiert laborieusement une place et un pouvoir dans la société : là est le récit du bâtard.
Cette interprétation est économique d’abord par le rôle qu’y tient le travail : c’est par le travail que Robinson substitue le mythe de l’enfant trouvéà celui du bâtard. Mais elle l’est aussi par le parallèle qu’établit Marthe Robert entre le désir de l’enfant d’échapper à des origines qui manquent de gloire et le fait que la civilisation bourgeoise, société de classes et non de castes, est précisément celle où l’on peut passer d’une classe à l’autre. Politiquement et économiquement, c’est la bourgeoisie qui permet l’expression et la réalisation de ce désir enfantin d’échapper à la condition de naissance. Robinson incarne alors un désir – désir d’échapper à sa condition d’origine – qui peut exister hors de la bourgeoisie, mais qui trouve dans la société bourgeoise les conditions idéologiques de sa légitimité et les conditions politiques de son accomplissement :
« Robinson Crusoé (…) ne peut être écrit que dans une société en mouvement, où l’homme sans naissance ni qualité a quelque espoir de s’élever par ses propres moyens, quitte à lutter durement contre les survivances qui l’empêchent de monter. (…) C’est le génie de Daniel Defoe d’avoir pressenti combien le genre romanesque tient par essence aux idéologies de la libre entreprise » (Robert : 140).
On retrouve ici encore l’articulation entre un désir défini hors de l’histoire, concevable dans toute société, et la réalisation possible de ce désir dans des conditions historiques particulières. Mais qu’il s’agisse du désir ou de sa réalisation, le travail dans l’interprétation de Marthe Robert n’est pas ce qui lie l’agent économique à la nature, ce qui permet d’avoir un rapport aux choses qui ne serait pas perverti par autrui. Il est immédiatement un rapport social, le moyen de résoudre des rivalités de position, de s’élever dans une hiérarchie sociale. C’est l’idéologie officielle du capitalisme naissant : tout homme peut changer sa vie par son travail. Cette idéologie est fondée sur la dénégation de ce qui anime l’individu, et qui n’est pas seulement le désir de bien-être de celui que l’on nommera bientôt homo œconomicus, mais un désir de gloire et de pouvoir social.
On trouve donc là des conceptions de l’économie très variées. C’est pourquoi il est assez insuffisant de présenter Robinson comme un homo œconomicus, car il présente un mélange de traits qui renvoient à plusieurs types d’agents économiques : d’abord marchand soucieux d’enrichissement, bourgeois inquiet de sa position sociale, capitaliste dans son comportement accumulateur, il devient sur l’île l’agent désireux d’accroître seulement son bien-être. Or tous ces personnages ne définissent pas un homo œconomicus qui exprimerait toutes ces dispositions ou ces aspirations. Il ne suffit pas que ces dispositions relèvent toutes de l’économie pour qu’elles définissent un agent économique. Au contraire, l’homo œconomicus s’est construit en économie comme un type d’agent bien particulier, opposéà d’autres types d’agents économiques. Et Robinson incarne tout à tour mais aussi parfois simultanément ces divers types d’agents qui se contredisent.
Cette capacité du personnage à incarner des types d’agents contradictoires lui vient en partie de ce que le séjour sur l’île est une expérience qui le transforme. Cette transformation s’observe en particulier dans son attitude à l’égard de l’argent. Mais au-delà du récit d’une transformation, il reste une confusion et l’on ignore jusqu’où va cette transformation. Certains éléments démentent son ampleur ou, au moins, expriment la permanence des traits anciens du personnage sous les bouleversements que produit la réclusion insulaire. C’est pourquoi, même si Robinson est défini en grande partie par l’économie, il n’est pas certain qu’il soit un personnage économique bien défini. C’est là qu’est, pour l’économiste, son intérêt.
II.L’expérience de l’île déserte et la fabrication d’un homo œconomicus
Comment l’expérience insulaire construit-elle Robinson comme ce que l’on désigne en économie comme l’homo œconomicus ? A travers la transformation de l’attitude du personnage à l’égard de ces deux objets économiques que sont l’argent et le travail.
1. Argent et désir d’enrichissement
L’expérience insulaire produit une mutation du comportement du personnage à l’égard de l’argent, qui passe d’un comportement de marchand désireux d’enrichissement rapide à un comportement d’homo œconomicus soucieux seulement de son bien-être et pour qui l’argent ne signifie rien parce qu’il est sans utilité intrinsèque.
Parmi les éléments qui soulignent cette transformation, il faut signaler d’abord ceux qui indiquent que le Robinson d’avant le naufrage désire s’enrichir (ainsi les mises en garde de son père contre un trop prompt désir d’enrichissement, la vente de son serviteur et compagnon d’infortune, qui l’a pourtant aidéà fuir l’esclavage et lui est resté fidèle) et ceux qui expriment sa transformation après le naufrage, où il éprouve l’inutilité de l’argent. Ainsi s’écrie-t-il en trouvant de l’or et de l’argent sur l’épave de son bateau : « O drogue ! à quoi es-tu bonne ? Tu ne vaux pas la peine que je me baisse pour te prendre ! » (Defoe, 67) ; la scène se répète lorsqu’il trouve de l’or sur une autre épave. Ce sont aussi ses regrets d’avoir vendu son serviteur, regrets non pas moraux mais intéressés et matériels, car il songe combien il lui aurait été bien utile pour l’aider à exploiter l’île, alors que l’argent ne lui sert à rien. En somme, le Robinson d’avant le naufrage veut faire fortune ; celui de l’île ne s’intéresse plus qu’à son bien-être, à sa production, et maudit le désir d’enrichissement qui fut la cause de son voyage et donc de son naufrage. Du point de vue économique, cette transformation est celle d’un désir d’enrichissement monétaire en désir de bien-être.
Or c’est une caractéristique de l’économie politique, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, d’affirmer l’absence d’utilité intrinsèque de l’argent, le fait que jamais l’argent n’est désiré pour lui-même, qu’on ne le demande ‘que pour s’en débarrasser’, qu’il n’est qu’un intermédiaire dû aux difficultés du troc. C’est par ce discours sur l’argent que l’économie politique qui se construit au XVIIIe siècle rompt avec les idées économiques développées par le mercantilisme, qui au contraire identifie richesse et monnaie et fait de la recherche de l’argent un objectif essentiel de politique économique. C’est aussi à travers ce discours sur l’inutilité intrinsèque de l’argent que l’économie politique affirme son caractère inoffensif et en cela rompt avec l’idée aristotélicienne d’un danger possible dans l’économie lorsque la bonne économie fait place à la mauvaise chrématistique, au désir d’enrichissement illimité. Enfin, ce discours sur l’argent est ce qui permet de naturaliser l’économie en la séparant de la politique puisque l’argent est le fait du prince, et que l’économie politique, qui veut aller au-delà de l’apparence monétaire, s’occupe non d’argent mais de travail, qui est l’une des expériences humaines les mieux partagées[2].
De ce point de vue, le Robinson d’avant le naufrage incarnerait la conception mercantiliste de l’économie, qui veut que, pour l’individu comme pour le pays, s’enrichir équivaut à accumuler des métaux précieux ; celui d’après le naufrage, transformé par l’expérience insulaire, annoncerait l’agent des physiocrates, des classiques et même, au-delà, de la théorie néo-classique de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos jours.
L’opposition entre ces deux Robinsons n’est pourtant pas si tranchée. D’abord parce qu’il n’est pas certain que le Robinson d’avant l’île incarne sans ambiguïté le marchand désireux de s’enrichir : c’est son père qui lui attribue le désir de faire fortune alors que lui parle surtout de son goût pour les voyages : « il voulait me faire avocat ; mais mon seul désir était d’aller sur mer » (Defoe, 11). Ensuite, parce que le mépris de l’argent qu’il professe sur l’île ne suffit pas à le dissuader de le conserver et de ne pas l’oublier lorsqu’il pourra quitter. Ce mépris affiché de l’argent ne va pas si loin qu’il le refuse complètement. Ainsi, trouvant sur l’épave du bateau qu’il visite à la fin de son séjour diverses marchandises, il en fait l’inventaire détaillé : rhum, confitures, chemises, mouchoirs, cravates, et donc or et argent, dont il détaille la forme : « Trois grands sacs de pièces de huit, qui contenaient environ onze cent pièces en tout (…) six doublons d’or enveloppés dans un papier, et quelques petites barres ou lingots d’or qui, je le suppose, pesaient à peu près une livre » (209). La précision de la description semble démentir l’affirmation qui suit : « Pour l’argent, je n’en avais que faire : il était pour moi comme de la boue sous mes pieds ». Robinson est en réalité si peu indifférent à cet argent qu’il en trouve davantage –« je tirai du second coffre environ cinquante pièces de huit en réaux, mais point d’or »– le conserve –« Je portai néanmoins cet argent dans ma caverne, et je l’y serrai comme le premier que j’avais sauvé de notre bâtiment »– et regrette de n’en pouvoir récupérer davantage : « Ce fut vraiment grand dommage que l’autre partie du navire n’eût pas été accessible, je suis certain que j’aurais pu en tirer de l’argent de quoi charger plusieurs fois ma pirogue ; argent qui, si je fusse jamais parvenu à m’échapper et à m’enfuir en Angleterre, aurait pu rester en sûreté dans ma caverne jusqu’à ce que je revinsse le chercher » (209).
Car Robinson sait bien que l’inutilité de l’argent ne vaut que sur l’île, qui pour cela lui apparaît à la fois comme prison et refuge. L’enfermement contraint certes dépouille l’argent de toute utilité et permet ainsi d’échapper à la corruption de l’argent. Mais Robinson ni le lecteur n’oublient jamais ni que cet argent, hors de l’île, retrouverait toute sa valeur, ni qu’il souhaite lui-même échapper à l’île. L’ambivalence de ses désirs apparaît alors dans l’opposition entre le sentiment d’être prisonnier sur l’île : « bien que je fusse dans un lieu étendu, cependant cette île était vraiment une prison pour moi » (109), et la conscience que cet emprisonnement le protège : « Je commençai à sentir profondément combien la vie que je menais, même avec toutes ses circonstances pénibles, était plus heureuse que la maudite et détestable vie que j’avais faite durant toute la portion écoulée de mes jours » (126).
L’attitude à l’égard de l’argent fait donc cohabiter dans le personnage au moins deux aspirations économiques opposées, à la fois dans le comportement, mais aussi dans la conception de l’économie qui sous-tend ces comportements : le désir d’une richesse monétaire, opposé au désir d’une richesse réelle, faite de choses utiles. Si toute l’économie politique, depuis le XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, est bâtie sur l’idée d’une richesse composée de choses utiles et non de monnaie, l’ambivalence de Robinson, qui éprouve pourtant l’inutilité de l’argent dans sa réclusion, dit la permanence d’une conception plus mercantiliste de la richesse.
Sans être identique à l’argent, l’un des traits de Robinson qui lui est lié est sa disposition à l’inventaire, à la comptabilisation et au calcul. Il dénombre ce qu’il retire des épaves comme ce qu’il fabrique. Il imagine avec fierté la surprise de qui visiterait sa grotte comme un magasin. Dans le même mouvement qui lui fait rejeter l’argent, il évalue en monnaie ce qu’il désire :
« J’avais une petite somme de monnaie, environ trente-six livres sterling : hélas ! Cette triste vilenie restait là inutile ; je n’en avais que faire et je pensais souvent en moi-même que j’en donnerais volontiers une poignée pour quelques pipes à tabac (…) ; voire même que je donnerais le tout pour six penny de semence de navet et de carotte d’Angleterre ou (..) pour une bouteille d’encre » (145).
Lorsqu’il ne calcule pas, comme dans la construction d’une pirogue qui, lui ayant coûté« un travail infini », « une peine indicible », est inutile car trop lourde pour qu’il puisse la transporter jusqu’au rivage, il s’en repend : « Je compris alors quelle folie c’était d’entreprendre un ouvrage avant d’en avoir calculé les frais et d’avoir bien jugé si nos propres forces pourraient le mener à bonne fin » (143).
White, dans l’article du New Palgrave consacréà« Robinson Crusoé» juge que le personnage du roman de Defoe, à la différence de l’homo œconomicus des marginalistes, calcule mal. Cela n’est pas si sûr mais ce qui apparaît nettement et importe n’est pas tant que Robinson sache bien calculer mais qu’il s’en soucie, qu’il témoigne d’un intérêt pour ces questions, qu’elles ne soient pas passées sous silence.
2. Travail, subsistance et suffisance
Le second élément qui fait de Robinson un homo œconomicus est son rapport aux besoins et au travail, la manière dont il s’inquiète de sa subsistance. Marthe Robert fait remarquer qu’aucun des héros qui l’on précédé, Ulysse ou Don Quichotte, ne s’en soucie de cette manière. Ils se nourrissent certes mais sans travailler comme des hommes ordinaires pour assurer leur subsistance. Ils la conquièrent plutôt dans des combats glorieux. Robinson au contraire se soucie des moyens d’obtenir sa subsistance sans être héroïque, comptant non sur son courage, mais sur son industrie et sur les outils et marchandises récupérés de l’épave : « Il était superflu de demeurer oisif à souhaiter ce que je ne pouvais avoir », dit-il dès le lendemain de son arrivée sur l’île ;« la nécessitééveilla mon industrie » (57). Nul combat glorieux pour assurer sa subsistance. Chacun peut s’identifier à ce héros bien peu héroïque.
Or il est d’autant moins héroïque que, très vite, sa survie même n’est plus en jeu. Car il parvient à extraire du navire échoué près du rivage des outils et des matières grâce auxquels il comprend que sa subsistance n’est pas une menace :
« Je compris de nouveau combien j’étais largement pourvu pour ma subsistance. (…) Quel eût été mon sort, s’il eût fallu que je vécusse dans le dénuement où je me trouvais en abordant le rivage, sans les premières nécessités de la vie, et sans les choses nécessaires pour me les procurer et pour y suppléer! (…) J’étais à peu près assuré d’avoir tant que j’existerais une vie exempte du besoin (73).
De ce moment, Robinson ne craint jamais de manquer du nécessaire et s’en réjouit régulièrement : dans le « compte très fidèle de [ses] jouissances en regard des misères qu’[il] souffr[e] », il oppose au malheur de sa solitude : « je suis retranché du nombre des hommes ; je suis un solitaire, un banni de la société humaine », le bonheur de ne manquer de rien pour sa subsistance : « Je ne suis point mourant de faim et expirant sur une terre stérile qui ne produise pas de subsistance » (76).
La subsistance assurée, la nécessité fait place au bien-être. Son travail ne s’exerce pas en vue de la subsistance, qu’importe. Il sera destiné au bien-être. Le personnage se réjouit qu’il n’y ait pas de combats à mener, de bêtes féroces à dompter. Ses exploits ne sont que des travaux très ordinaires, qui supposent un temps long, monotone et fastidieux, alors que les héros antérieurs mènent des combats glorieux, ou utilisent des ruses subtiles, dont les résultats sont immédiats. On peut suivre Marthe Robert lorsqu’elle fait remarquer combien Robinson
« brise les conventions de l’Utopia purement théorique, où la vie se maintient miraculeusement elle-même sans soulever de problèmes concrets. Pour la première fois dans la littérature romanesque, la réalité ne peut plus être vaincue à la seule force du désir, il y faut des outils, des calculs, toute l’expérience et la patience de l’ouvrier. Jusque là le roman est un genre notoirement désœuvré (…), l’étiquette veut qu’on n’y travaille jamais. Robinson met fin à cette oisiveté obligée (…). Avec lui, le travail, la peine, le besoin, s’installent au cœur même de l’utopie, il ne s’agit plus de nier le monde empirique pour se venger ou de se consoler de son aridité décevante, mais bien de le transformer à tout instant en un vaste atelier où l’esprit et les mains sont également actifs » (141).
III.Robinson, anti-homo oeconomicus : le statut du travail
1.L’arbitrage entre consommation et loisir
Cette disposition à travailler pour satisfaire des besoins ou améliorer le bien-être exprime sans ambiguïté le comportement de l’homme ordinaire qu’est l’homo oeconomicus, qui use des ressources rares que sont les ressources naturelles et le temps de travail pour satisfaire des besoins, ou des désirs, possiblement infinis. Il semble illustrer de manière évidente l’arbitrage entre consommation et loisir, entre l’utilité procurée par les biens et la désutilité entraînée par le travail, pour reprendre les termes de la microéconomie. Et l’on comprend pourquoi les économistes marginalistes de la fin du XIXe siècle se sont emparés du personnage de Defoe pour en faire la preuve de la justesse de leurs analyses : Robinson, plus encore qu’il n’exprime les aspirations du bourgeois à s’élever dans une hiérarchie sociale, annonce l’homo œconomicus calculateur, agent atemporel vivant dans un rapport à lui-même et détaché des contingences historiques.
Pourtant, les conditions mêmes dans lesquelles l’arbitrage entre loisir et consommation se pose à Robinson sont en deux points au moins très différentes de celles de l’agent maximisateur de son utilité que met en scène la théorie économique. La première de ces différences provient de sa relation aux besoins, la seconde de son rapport au travail.
2.La modération des besoins
Commençons par dire que l’homo œconomicus est défini par le désir de consommer toujours davantage : c’est une constante de la pensée économique depuis le XVIIIe siècle, de manière plus ou moins explicite, plus ou moins tranchée, que de supposer une rareté des ressources relativement aux besoins. Du « désir d’améliorer notre condition, désir qui, quoique généralement calme et sans passion, naît avec nous au monde, et ne nous lâche plus jusqu’à la tombe »évoqué par Smith dans la Richesse des Nations (429) à l’hypothèse de non-satiété de la théorie contemporaine de l’équilibre général[3], l’agent toujours fait face à des désirs qui excèdent ses ressources et il n’est jamais mis en avant en théorie économique une abondance des moyens relativement aux besoins. Or si Rousseau au XVIIIe siècle, s’opposant à l’économie politique naissante et promouvant une modération des besoins, donne Robinson en exemple à Emile (Rousseau, 455), c’est que l’économie de Robinson sur l’île se caractérise par une grande modération des besoins. Cette modération qui ne vient pas de ce que Robinson serait raisonnable, comme précisément il s’agit d’éduquer Emile. Elle provient de sa situation d’homme privé de la socialisation, dont les besoins sont en conséquence extrêmement limités.
C’est donc l’île qui impose à Robinson la modération des besoins qui ravit Rousseau et fait de Robinson, en ce sens, un anti-homo œconomicus. Car cette modération altère sensiblement le problème économique qu’il doit résoudre, relativement à celui de l’homo œconomicus décrit par les économistes. Il ne lui faut produire que ce qui suffit à la consommation, et celle-ci ne peut pas être infinie :
« L’accroissement de mes récoltes me nécessita à agrandir ma grange. (…) je reconnus que quarante boisseaux d’orge et de riz étaient plus que je n’en pouvais consommer dans un an. Je me déterminai donc à semer chaque année juste la même quantité que la dernière fois, dans l’espérance qu’elle pourrait largement me pourvoir de pain » (139).
Seule l’arrivée de Vendredi autorisera une expansion de l’exploitation, mesurée par ce qui lui sera nécessaire : « Je commençai alors à réfléchir qu’ayant deux bouches à nourrir plutôt qu’une, je devais me pourvoir de plus de terrain pour ma moisson et semer une plus grande quantité de grain que de coutume » (228).
Le personnage lui-même exprime ce qui distingue l’île déserte de l’économie anglaise qu’il a quittée :
« J’étais éloigné de la perversité du monde : je n’avais ni concupiscence de la chair, ni concupiscence des yeux, ni faste de la vie. Je ne convoitais rien car j’avais alors tout ce dont j’étais capable de jouir. (..) Je n’avais point de rivaux, je n’avais point de compétiteur, personne qui disputât avec moi le commandement et la souveraineté. J’aurais pu récolter du blé de quoi charger des navires ; mais n’en ayant que faire, je n’en semais que suivant mon besoin (…). Ce dont je pouvais faire usage était seul précieux pour moi. J’avais de quoi manger et de quoi subvenir à mes besoins, que m’importait tout le reste ! (…) Si j’avais semé plus de blé qu’il ne convenait pour mon usage, il se serait gâté (…). En un mot la nature et l’expérience m’apprirent, après mûre réflexion, que toutes les bonnes choses de l’univers ne sont bonnes pour nous que suivant l’usage que nous en faisons, et qu’on n’en jouit qu’autant qu’on s’en sert ou qu’on les amasse pour les donner aux autres, et pas plus. (…) Je possédais infiniment plus qu’il ne m’était loisible de dépenser. Je n’avais rien à désirer, conclut-il, si ce n’est quelques babioles qui me manquaient et qui pourtant m’auraient été d’une grande utilité » (144-5).
Cette modération des besoins imposée par la solitude fait de Robinson un agent économique dont le problème est moins celui de la rareté des ressources que celui de la permanence des désirs : « ses besoins satisfaits, le désir de société le tenaillait tout autant et il lui semblait qu’il était le moins nécessiteux quand tout lui manquait » (cité par Barthes, 55), écrit Defoe.
Alors qu’aujourd’hui Robinson est le nom donnéà l’agent de l’analyse néo-classique dont les désirs sont donnés par la nature, antérieurement à toute socialisation, celle-ci étant soumise à un objectif de satisfaction de ces désirs, le roman soulève au contraire comme un problème les désirs et les besoins d’un homme livréà la solitude. Robinson ne survit que par un semblant de vie sociale : il écrit un journal, prie Dieu, apprivoise un perroquet pour pouvoir parler, ne vit que dans l’espoir d’un retour à la vie sociale. S’il intéresse les économistes puisqu’ils en reprennent la figure, cet intérêt est très superficiel : l’économie retient moins le personnage et la difficulté qu’il rencontre à exister hors de la société des hommes que le cadre dans lequel il est artificiellement placé. Alors que le Robinson de Defoe, et tout particulièrement avant sa rencontre avec Vendredi, se heurte moins à la question de l’utilisation efficace de la nature pour satisfaire ses besoins qu’au regret de la société des hommes.
3.Le rapport du travail et au temps de travail
La seconde différence majeure entre le Robinson de Defoe et l’homo œconomicus est son rapport au travail : alors que l’homo oœconomicus veut limiter autant que possible le temps de travail, Robinson, qui dispose d’un temps infini, ne cherche pas à ménager sa peine. Son temps sur l’île est entièrement occupé par le travail et ce temps long du travail s’oppose à la rapidité d’un enrichissement dans le commerce. Il rappelle souvent que, pour produire le moindre objet, son travail est « infini », sa peine « indicible ». Lorsqu’il fabrique des meubles, sans lesquels, dit-il, « je ne pouvais jouir du peu de bien-être que j’avais en ce monde », il lui faut « un temps très long » et c’est n’est pas « sans une peine infinie » : « ces travaux témoignent que je n’étais pas oisif et que je n’épargnais pas mes peines pour accomplir tout ce qui me semblait nécessaire à mon bien-être » (69).
De même lorsqu’il parvient à produire son pain, il ne cache pas la lenteur et la difficulté de l’affaire. Il énumère les outils qui lui manquent, charrue, bêche, pelle, en fabrique mais de très imparfaits et qui s’usent vite, et décrit minutieusement les travaux de semence, récolte, conservation du blé.
« Résignéà tout, je travaillais avec patience, et l’insuccès ne me rebutait point (…) Je fus réduit à faire toutes ces choses sans aucun de ces instruments, et cependant mon blé fut pour moi une source de bien-être et de consolation. Ce manque d’instruments, je le répète, me rendait toute opération lente et pénible, mais il n’y avait à cela point de remède » (34).
S’il travaille autant, c’est bien sûr comme l’homo œconomicus pour accroître son bien-être. Mais cette raison n’est ni unique ni même première. Il faut remarquer d’abord qu’il éprouve un plaisir de la contemplation du travail effectué autant qu’un plaisir de la consommation. Ainsi imagine-t-il un visiteur découvrant sa grotte : « Si quelqu’un avait pu visiter ma grotte, à coup sûr elle lui aurait semblé un entrepôt général d’objets de nécessité. J’avais ainsi toutes sortes de choses si bien à ma main, que j’éprouvais un vrai plaisir à voir le bel ordre de mes effets, et surtout à me voir à la tête d’une si grande provision » (80). Ce plaisir de la contemplation se double d’un plaisir de la possession : « ma maison de campagne, ma tonnelle, ma tente, mon bétail » (168).
Mais surtout, le travail même est aussi pour Robinson un plaisir, une source de satisfaction. Il exprime l’émerveillement qu’il éprouve à accéder, à force de persévérance, à tous les métiers, alors qu’il n’est qu’un homme ordinaire sans talent particulier. Alors qu’il a abordé l’île le 30 septembre 1659, il écrit dans son journal, à propos du 4 novembre de la même année : « Tout mon temps de travail de ce jour là fut employéà me faire une table ; car je n’étais alors qu’un triste ouvrier ; mais bientôt après le temps et la nécessité firent de moi un parfait artisan, comme ils l’auraient fait je pense, de tout autre » (83). Lorsqu’il parvient à produire son pain, il s’émerveille d’accomplir seul ce qui l’est d’ordinaire à travers une division du travail très poussée : « C’est alors que je pouvais dire avec vérité que je travaillais pour mon pain. N’est-ce pas chose étonnante, et à laquelle peu de personnes réfléchissent, l’énorme multitude d’objets nécessaires pour entreprendre, produire, soigner, préparer, faire et achever ‘une parcelle de pain’» (133).
On peut remarquer avec Ian Watt que cet émerveillement, partagé par Rousseau qui veut à son tour le transmettre àÉmile, n’est une surprise que pour l’individu inséré dans une division du travail très poussée. Robinson exprimerait alors la nostalgie d’une autosuffisance qui n’a peut-être jamais été, mais qui, avec le développement de la société marchande et capitaliste, n’est plus à un point extrême. Cette nostalgie est anti-économique, au sens où, au contraire, l’économie est du côté de la division du travail parce qu’elle accroît la productivité.
Une telle relation au travail inscrit Robinson dans une utopie paradoxale. Utopie car Robinson sur l’île est heureux. Ce bonheur lui vient d’un rapport heureux au travail. Paradoxale, parce que l’utopie généralement exclut ou au moins limite le temps du travail. L’utopie de la science économique serait de réduire le temps consacré au travail tout en jouissant de la consommation possiblement infinie. Alors que l’utopie de Robinson, à laquelle est sensible Rousseau, est celle du goût non d’une consommation mais d’un travail infini.
Car non seulement les ressources naturelles ne sont pas rares sur l’île, mais le temps de travail l’est encore moins et Robinson ne cherche pas à le réduire : « Quel besoin aurais-je eu de m’inquiéter de la lenteur de n’importe quel travail ; je sentais tout le temps que j’avais devant moi, et que cet ouvrage une fois achevé je n’aurais aucune autre occupation, au moins que je pusse prévoir, si ce n’est de rôder dans l’île pour chercher ma nourriture » (76). De même, doit-il, lorsqu’il produit ses meubles, couper un arbre entier pour n’en tirer qu’une planche : « Non plus qu’à la prodigieuse somme de temps de travail que j’y dépensais, il n’y avait d’autre remède que la patience. Après tout, mon temps ou mon labeur était de peu de prix, et il importait peu que je l’employasse d’une manière ou d’une autre » (p.80).
Robinson ici est bien éloigné de la figure de l’agent économique rationnel : plus qu’un homo œconomicus affrontant la rareté de la nature et désirant économiser son travail et sa peine, il est semblable à deux agents économiques ou, précisément, post-économiques.
Semblable d’abord à la figure du travailleur non aliéné qu’évoque Marx dans les Manuscrits de 1844, en distinguant l’homme de l’animal par « l’activité vitale consciente » qu’il exerce dans le travail. Car lorsque « l’animal construit son nid, son habitation, tels l’abeille, le castor, la fourmi, il ne produit que sous l’empire du besoin physique immédiat, alors que l’homme produit alors même qu’il est libéré du besoin physique et ne produit même vraiment que lorsqu’il en est libéré » (Manuscrits, 63-64).
C’est pour Marx « en façonnant le monde des objets que l’homme commence à s’affirmer comme un être générique » (65) et l’éloge du travail sous-tend et explique la place de l’aliénation du travail : si la production des objets du monde n’était pas ce par quoi l’homme accède à lui-même et à autrui, l’aliénation du travail, la dépossession du travailleur, n’entraîneraient pas « la vie aliénée, l’homme aliéné » qui caractérise la condition du travailleur dans le capitalisme (67). La Critique du programme de Gotha expose aussi que la phase supérieure de la société communiste sera atteinte lorsque le travail sera devenu « non seulement le moyen de vivre, mais encore le premier besoin de la vie » (1420). Le travail exercé non en vue de la satisfaction des besoins mais comme l’expression de l’humanité de chacun, c’est précisément ce que vit Robinson, sans que ce travail cesse pour autant d’être travail et se conçoive en pur loisir. Le travail lorsqu’il devient le premier des besoins reste vécu dans la peine, la difficulté, et dans l’attente d’un résultat[4].
On pense aussi à l’agent économique évoqué par Keynes dans les « Perspectives économiques pour nos petits enfants », agent affranchi des nécessités de la subsistance. Dans ce texte écrit en 1930, Keynes annonce que le problème économique de l’humanité, qu’il définit par la lutte pour la subsistance, disparaîtra bientôt, et qu’ainsi, « pour la première fois depuis sa création, l’homme fera face à son problème véritable et permanent : comment employer la liberté attachée aux contraintes économiques ? Comment occuper les loisirs que la science et les intérêts composés auront conquis pour lui, de manière agréable, sage et bonne ? » (136).
Cette situation, prédit Keynes, sera d’autant plus difficile à résoudre, que l’homme, contraint depuis le début de l’humanitéà employer son temps pour satisfaire ses besoins, se trouvera dépourvu de cette justification à son activité.
Conclusion
Il est paradoxal sans doute que le héros de Defoe, supposé témoigner des débuts du capitalisme en Europe, repris de manière récurrente par les économistes comme illustration de l’analyse du comportement de l’agent devant la nature avaricieuse, que ce personnage donc identifiéà l’homo œconomicus représente un agent semblable à celui qu’imaginent Marx ou Keynes pour les temps futurs de l’humanité, au-delà du développement des forces productives du capitalisme, « dans le giron de l’abondance économique » (Keynes, 136). Le Robinson de Defoe, s’il est indéniablement un personnage envahi par les questions économiques, diffère pourtant essentiellement de celui qu’imaginent les économistes. Son comportement relatif au travail et au désir témoigne de ce que le problème économique qu’il affronte, plus que celui d’une nature avaricieuse devant des besoins infinis, concerne la construction, ou plutôt la permanence, d’un désir de vivre. Mais que Robinson incarne un agent affranchi des nécessités de la subsistance, que le problème économique qui le définit soit moins celui de la rareté que celui de l’usage du temps et des ressources, ne signifie pas que l’économie disparaisse. Elle demeure d’abord par le travail, entendu au sens de Marx comme premier des besoins humains ; mais aussi par le rattachement du désir de vivre aux actes matériels visant à l’entretien de la vie et à la construction d’un monde d’objets. La littérature ici exprime, dans un langage qui n’est pas celui de l’explication mais celui du constat incrédule devant ce qui se dérobe à l’argumentation scientifique, combien l’économie, dans son acception la plus large, façonne nos vies d’individus modernes.
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XII
Bibliographie
R. Barthes, Comment vivre ensemble. Cours et séminaires au collège de France, 1976-77, Paris, Seuil, 2002.
C. Benetti et J. CARTELIER, « L’économie comme science. La permanence d’une conviction mal partagée » in A. d’Autume et J. Cartelier L’économie devient-elle une science dure ?, Paris, Economica, 1995, p.216-232.
A. Berthoud, Essais de philosophie économique. Platon, Aristote, Hobbes, Smith, Marx, Lille, Presses universitaires du septentrion, 2002.
D. Defoe, Robinson Crusoé, traduction de Pétrus Borel, Paris, Marabout, (1719) 1962.
J.-P. Engélibert, La postérité de Robinson Crusoé : un mythe littéraire de la modernité, Genève, Droz, 1997.
J. Geanakoplos, « Arrow–Debreu model of general equilibrium » in S.N. Durlauf and L. E. Blume (ed.), The New Palgrave Dictionary of Economics, second edition, Palgrave Macmillan, 2008, <http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_A000133>
J. M. Keynes, « Perspectives économiques sur nos petits enfants » in J.M. Keynes, Essais sur la monnaie et l’économie, Paris, Payot, 1971, p.127-141.
K. Marx, Introduction générale à la critique de l’économie politique in K. Marx, Œuvres, tome 1, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1965.
K. Marx, Le Capital, in K. Marx, Œuvres, tome 1, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1965.
K. Marx,Critique du programme du parti ouvrier allemand in K. Marx, Œuvres, tome I, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1965.
K. Marx, Economie et philosophie (Manuscrits parisiens 1844) in K. Marx, Œuvres, tome 2, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1968.
K. Marx, Le Capital, in K. Marx, Œuvres, tome 1, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1965.
A. Mas-Colell, M. Whinston and J. Green, Microeconomic Theory, Oxford, Oxford University Press, 1995.
M. Robert, Roman des origines et origines du roman, collection Tel, Paris, Gallimard, 2000.
J.-J. Rousseau, Emile in Œuvres Complètes tome IV, bibliothèque de la Pléïade, Paris, Gallimard, Paris, 1969.
A. Smith, Recherches sur la Nature et les Causes de la Richesse des Nations, Paris, Garnier-Flammarion, 1991.
M. V. White, « Robinson Crusoe » in S.N. Durlauf and L. E. Blume (ed.), The New Palgrave Dictionary of Economics, second edition, Palgrave Macmillan, 2008, <http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_R000163>
I. Watt, « Robinson Crusoe as a Myth », in Essays in Criticism, April, vol.I, n°2, 1951.
I. Watt, The Rise of the Novel, Studies in Defoe, Richardson and Fielding, London, Chatto and Windus, 1957.
I. Watt, Myths of Modern Individualism. Faust, Don Quixote, Don Juan, Robinson Crusoe, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
[1]Une étude détaillée de ces interprétations est proposée par Jean-Paul Engélibert.
[2]Voir Benetti et Cartelier, et le chapitre sur Smith de l’ouvrage de Berthoud.
[3]Le commentaire de l’hypothèse de non satiété dans l’article du New Palgrave consacré au modèle d’équilibre général est révélateur : « The nonsatiation hypothesis seems entirely in accordance with human nature ». (Geneakoplos).
[4]Voir le chapitre sur Marx de l’ouvrage de Berthoud.