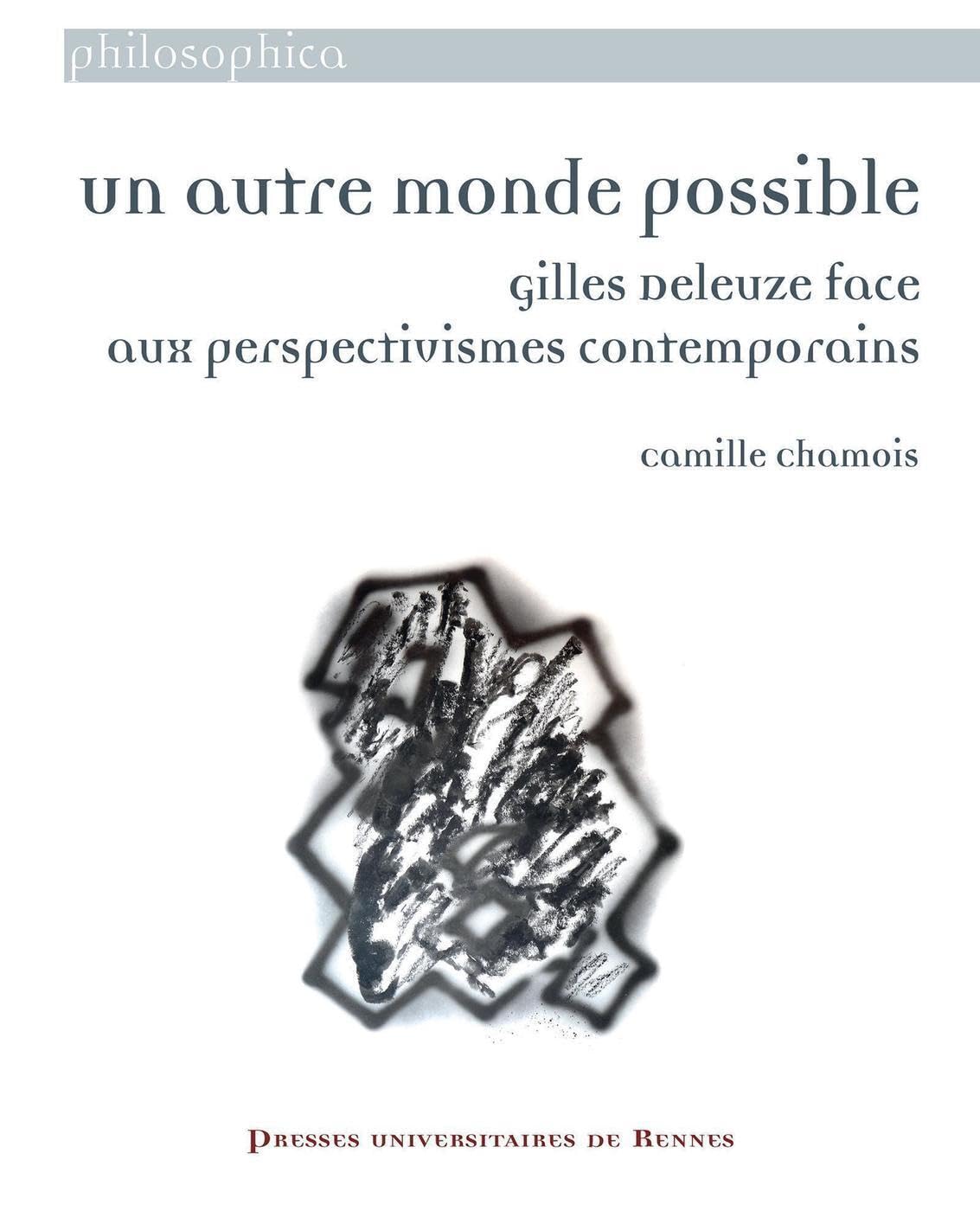Recension de l’ouvrage de Camille Chamois
Un autre monde possible : Gilles Deleuze face aux perspectivismes contemporains
Presses universitaires de Rennes, 2022.
Nombre de pages : 284
EAN : 9782753586536
Ce livre est un livre important parce qu’il ose aborder une question difficile et à ce titre bien souvent délaissée : Deleuze était-il perspectiviste ? Et si oui, existe-t-il une pensée perspectiviste sous-jacente à la vision deleuzienne du rapport à autrui exposée dans certains de ses ouvrages ? On le sait, Deleuze fut de ceux qui ont permis à la notion de perspectivisme d’exister plus concrètement sur un plan théorique, en reliant, en différenciant, en discutant, les perspectivismes de Nietzsche, Leibniz, Whitehead et même celui d’Henry James. Toutefois, ce ne sont pas ces analyses lumineuses et bien connues de Deleuze sur le perspectivisme des autres qui intéressent le plus Camille Chamois. C’est bien plutôt le fond obscur d’un perspectivisme proprement deleuzien qu’il s’attache à faire remonter à la surface. Et pour ce faire, l’auteur articule toute son analyse autour d’un point finalement assez peu discuté dans les recherches sur la philosophie deleuzienne : « la structure Autrui ». Derrière cette formulation, Deleuze entend décrire comment autrui est avant tout le surgissement en soi de « l’expression d’un autre monde possible [1]». C’est à partir de ce concept essentiel, selon C. Chamois, à la compréhension d’un perspectivisme deleuzien que ce dernier entend discuter, à travers une analyse particulièrement précise (notamment sur le plan de l’histoire des idées), sa réappropriation contemporaine dans les sciences sociales, et plus particulièrement dans le champ anthropologique dont Eduardo Viveiros de Castro est en quelque sorte la figure tutélaire. Mais c’est également l’occasion pour lui de se pencher, à partir de cette prise de perspective sur le point de vue de l’Autre mise à jour par Deleuze, sur ce qu’on peut appeler la socialisation de la perception et par là sur ce que Deleuze appelait « une image de la pensée », c’est-à-dire « ce qui guide et oriente concrètement la pensée elle-même en lui donnant une forme et des habitudes » (p. 31).
Perspectivisme et image de la pensée
« À quelle condition le perspectivisme peut-il être entendu comme une « image de la pensée » ? » (p. 40). Telle est la question posée par C. Chamois dès l’introduction. Mais qu’entend-il par-là ? En somme, il s’agit de montrer que le perspectivisme est un biais qui permet d’acquérir des habitudes ou des formes de pensées qui tiennent à la capacité pour l’individu d’adopter la perspective d’autrui. Le problème est pour lui de « mobiliser les sciences qui étudient les interactions entre les individus (de la psychologie du développement à la linguistique pragmatique) pour souligner quels sont les dispositifs qui facilitent ou empêchent la focalisation ou la simulation du point de vue d’autrui » (p. 44). C’est un programme d’une grande ambition pratique qui se dévoile ici : comment guider et orienter la pensée grâce au perspectivisme ? Si l’on pourrait presque dire que pour Deleuze une perspective ne vaut quelque chose que par les pensées qu’elle crée, il faut alors s’interroger sur les pratiques, sur les méthodes, susceptibles de lui faire jouer un rôle à la hauteur de ses capacités pédagogiques. Et c’est donc l’occasion d’une interrogation plus profonde sur les modalités concrètes d’apprentissage qui structurent une pensée qui ne saurait être extraite des dispositifs sociaux qui l’instaurent et la transmettent d’une perspective à l’autre. C’est sans doute cela que C. Chamois entend comprendre et creuser pour son compte à partir du concept deleuzien de la structure Autrui.
Autrui comme expression d’un autre monde possible
La notion de structure Autrui ne renvoie que secondairement aux autres individus : elle désigne d’abord un dispositif psychologique qui transforme mon expérience en me permettant d’accéder à (ou de postuler l’existence de) l’expérience d’un point de vue différent du mien. C’est pourquoi cette notion renvoie d’abord à une problématique transcendantale : elle désigne ce qui rend possible une expérience intersubjective. (p. 51)
On touche ici à cette capacité, mise en avant par le perspectivisme, de simulation du monde de l’autre, de perception de ce que nous ne percevions pas jusque-là, par le biais de cette rencontre entre perspectives divergentes. On sent bien du reste, à la lecture de cet ouvrage, que ce qui intéresse le plus C. Chamois ce sont les modalités de ce voyage entre les perspectives qui ne cesse de rendre les points de vue vivants, en cours de modification, sujets à l’apprentissage, à la différenciation de ce qu’ils étaient jusque-là. Il s’agit pour lui de se pencher sur ce monde des perceptions qui s’entrecroisent, qui s’entre-aperçoivent, qui permettent d’attraper, de capturer un peu de la perception de l’autre au sein de sa propre perception afin d’en bouger les lignes. C’est peut-être à partir de là que peut se comprendre l’importance donnée par notre auteur à cette « structure Autrui » dégagée par Deleuze comme fondement de son perspectivisme, mais aussi comme possibilité d’une élaboration « d’un modèle perspectiviste général » (p. 48). Car si comme l’écrit Deleuze, « Autrui, c’est d’abord cette existence d’un monde possible [2]», la structure Autrui n’est pas seulement ce qui permet le voyage d’un point de vue à l’autre mais ce qui produit le changement du voyageur lui-même ; elle « est cet effort de synthèse entre des perspectives différentes » (p. 114) qui joue un rôle capital dans le processus d’individuation lui-même. C’est en ce sens que, selon C. Chamois, chez Deleuze :
La question du rapport à Autrui est subordonnée à la question du rapport à soi – ou plutôt, à ses « virtualités », c’est-à-dire à ce qu’on peut devenir, aux perspectives qu’on peut adopter, et vis-à-vis desquelles autrui peut jouer un rôle d’embrayeur ou au contraire de blocage . (p. 115)
Reste toutefois à définir les modalités psychologiques concrètes de ce rapport perceptif à autrui, et c’est ce que le reste de l’ouvrage entend clarifier.
De la question des perceptions dans le corps
Le monde de l’autre implique la possibilité de percevoir le monde différemment ; il est une vision alternative (p. 82), non pas négation ou contradiction mais introduction d’une divergence qui, par le jeu des rapport interdividuels, vient bousculer ou au moins modifier la dynamique de nos affects et permettre une transformation potentielle du monde perçu. Autrui devient par projection et anticipation ce qui « structure l’ensemble du champ perceptif » (p. 99). Il s’agit bien là chez Deleuze de ce que C. Chamois identifie comme « un perspectivisme disjonctivisme et dynamique » en opposition à « un perspectivisme conjonctiviste et statique » (p. 106). Pour ne pas en rester à un stade seulement théorique, vient alors l’étude des interactions sociales comme fondement d’une herméneutique des signes perceptifs présents sur le corps d’autrui (Chapitres II et III). Différentes figures d’Autrui sont alors mobilisées : ami, femme, homme, parents, etc. comme autant de personnages conceptuels, comme autant de types d’interactions potentielles, historiques et contingentes, de cadres cognitifs différentiels, de processus de subjectivisation divers liés aux relations sociales et à leurs constantes évolutions. Toutefois, selon C. Chamois il est nécessaire de reprendre à nouveau frais les réflexions deleuziennes qu’il juge parfois insuffisantes, sur un plan psychosocial notamment, pour produire une analyse empiriquement viable des signes expressifs d’Autrui.
C’est donc aussi dans cette optique de prolongement du projet de symptomatologie de Deleuze et Guattari qu’il se lance sur leurs pas dans une réflexion sur ces signes du visage comme « motif traditionnel d’expression du monde d’Autrui » (p.179). L’exemple privilégié chez Deleuze est celui de la perspective d’un visage effrayé qui instantanément vient faire irruption dans mon monde comme expression d’un autre monde possible, c’est à dire comme l’expérience même de la disjonction des perspectives, et donc d’une perception dans mon corps de ce que je ne percevais pas jusque-là. Ceci bien entendu n’est qu’un exemple parmi d’autres de la multitude des signes expressifs visibles (tics, sourires, mimiques, tatouages, maquillages, coiffures, etc.) que les perceptions et les affects sélectionnent suivant certaines codifications, certains contextes éducatifs et autres agencements sociaux, afin d’y donner du sens. C’est du reste toute cette réflexion relative aux rapports intersubjectifs entre les regards que C. Chamois estime inaboutie chez Deleuze mais néanmoins porteuse de développements féconds pour l’avenir de cette symptomatologie perspectiviste.
Expérience, apprentissage et individuation
Cette socialisation de la perception reprise par C. Chamois en s’appuyant sur la psychologie de l’esprit et les sciences sociales, donne lieu à une confrontation fructueuse avec le perspectivisme deleuzien, tout comme le recours aux recherches en anthropologie qui permettent de donner à l’expérience, source de l’individuation des perspectives, une amplitude plus grande quant à la multiplicité de ses possibles. Car ne nous y trompons pas, le concept d’Autrui chez Deleuze est une véritable théorie de l’individuation où chacun, dans l’expérience de l’Autre, se trouve saisi et en même temps débordé par la puissance perceptive et affective de cet inter-perspectivisme au cœur des interactions sociales. De cette disjonction des perspectives se rencontrant, provient toute la richesse potentielle d’un être humain perpétuellement en train de se faire. Si ce perspectivisme deleuzien est un perspectivisme dynamique, c’est parce qu’il renvoie à « un réel apprentissage perceptif » (p. 105), qui non seulement fait éclater le réel de chacun, mais ne cesse de le garder en mouvement. C’est donc aussi, comme le souligne C. Chamois en conclusion, à une théorie des relations entre ces mondes possibles et ses réalités en cours qu’invite cet ouvrage, et par là bien entendu la philosophie deleuzienne. À travers cet apprentissage de la perspective de l’autre c’est bien un appel aux relations entre perspectives et à leurs mutations potentielles qui nous est proposé ici. On comprendra alors finalement que le but de ce travail sur la « structure d’Autrui » est quasiment de l’ordre d’un exercice spirituel. Car il y est décrit en filigrane une attitude face au monde, une attention à notre expérience quotidienne, « un mode d’être » (p. 152) face à la connaissance ; il y est dessiné l’importance pour le futur de contribuer à ce qu’on peut appeler un perspectivisme pratique qui prendrait « au sérieux la dimension expérimentale et relationnelle de la perception ». (p. 253)
Un renouvèlement du débat perspectiviste autour de Deleuze
Il nous faut aussi témoigner de la précision quasi chirurgicale de la réflexion de C. Chamois. Car nous n’avons pas encore rendu justice à ses analyses historiques retraçant l’influence de Tournier et de Sartre notamment sur l’essor théorique de la pensée deleuzienne elle-même. Cette importance des autres sur le développement des singularités de Deleuze est une sorte de mise en abyme de cette théorie perspectiviste qui donne à Autrui une importance capitale pour penser ce que l’on ne pensait pas jusque-là. Quoi qu’il en soit, ce sont, pour l’histoire de la philosophie et les recherches deleuziennes, d’appréciables et stimulantes analyses que nous livre ici C. Chamois, et incontestablement cette étude fouillée et détaillée de la « structure Autrui » est précieuse pour renouveler le débat perspectiviste autour de Deleuze. On peut toutefois regretter que Deleuze ne soit pas suffisamment mis face aux perspectivismes contemporains (tels que ceux de Nietzsche ou Whitehead par exemple) puisque cela nous est annoncé dans le sous-titre. Ajoutons à cela que même la métaphysique perspectiviste amazonienne n’est finalement sollicitée que partiellement (Introduction – Chapitre III). Néanmoins, la logique interne des trois chapitres tient seule sans qu’il y ait réellement besoin de ces perspectivismes contemporains, et ce, bien que leur présence en introduction et en conclusion soit de fait enrichissante pour le propos général. Gageons toutefois que les pistes ouvertes dans cet ouvrage par C. Chamois sauront donner lieu à une pratique perspectiviste florissante pour l’avenir, c’est-à-dire à un ensemble de techniques concrètes d’apprentissage[3], d’exercices spirituels ou à une éthique des relations à Autrui envisagé comme facteur de mutation des conditions même de l’expérience.
[1] G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969, p. 357.
[2] G. Deleuze et F. Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ?, Paris, Éditions de Minuit, 1991, p. 22.
[3] Voir en ce sens C. Chamois, « Se rendre sensible. Une théorie participative de l’apprentissage », dans C. Chamois et D. Debaise (dir.), Perspectivismes métaphysiques, Paris, Vrin, 2023.
Arnauld Rochereau
Arnauld Rochereau est docteur en philosophie de l’Université de Nantes. Il a soutenu une thèse intitulée Le sens pratique du perspectivisme dans laquelle il fait notamment dialoguer la philosophie de Nietzsche et les sciences contemporaines. Il est aujourd’hui chercheur indépendant. Ses recherches portent sur le perspectivisme et l’interprétation au cœur du vivant.