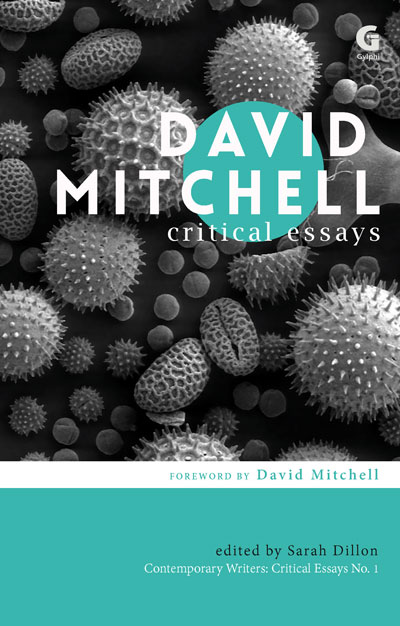Introduction
Le succès populaire de David Mitchell et l’intérêt des critiques à son égard sont en grande partie motivés par l’originalité formelle de son œuvre : chacun des six romans publiés à ce jour explore en effet des lieux et des époques distincts mais insérés dans un réseau dense et unique de correspondances. Il en résulte une temporalité très particulière, abondamment commentée par les travaux universitaires récents qui la comparent souvent à des structures géométriques complexes. Paul Harris (3-8 et 148-153) évoque ainsi le labyrinthe et les fractales[1] ; David Mitchell lui-même emploie l’analogie des poupées russes dans Cloud Atlas[2]. Dix ans plus tard, Mitchell choisit de se départir de la géométrie pour lui privilégier un parallèle audacieux entre le squelette et l’horloge, explicité dans le titre The Bone Clocks (2014). Il renouvelle ainsi une conception abstraite et mathématisée du temps en l’incarnant : le corps, à l’image de celui du personnage principal dont le roman retrace plus de soixante ans de vie, apparaît à la fois comme le dépositaire de l’histoire qu’il préserve et comme un emblème du délitement lié à la maladie et vieillissement. Transmission et mortalité, l’œuvre de Mitchell est en effet hantée par cette double thématique : dans Cloud Atlas par exemple le personnage du clone Sonmi se sacrifice pour léguer son testament aux générations futures. Elle est aussi présente dès son premier opus, Ghostwritten (1999), construit sur un relais narratif entre neuf histoires et neuf personnages principaux, tous confrontés à la mort ou à la disparition. La temporalité fractale ou labyrinthique s’ancre donc dans un réseau de références plus organiques où l’image du corps et la notion de relais sont intimement liées tantôt sous la figure de la transmission, tantôt sous celle de la contamination. Le relais textuel entre les différents récits de Ghostwritten notamment trouve un équivalent intradiégétique dans l’itinéraire de virus ou de parasites plus ou moins humanisés : de nombreuses péripéties sont ainsi directement liées à leur progression géographique et chronologique de corps en corps. A cela se greffe une interrogation métaphysique sur la nature humaine que Mitchell met en scène via les réflexions intimes de ses personnages, au travers desquelles il propose des méta-commentaires: « How do I know that there aren’t noncorpi living in me, controlling my actions ? Like a virus within a bacteria ? » (Ghostwritten, 191) On pourrait arguer ici que le travail de la temporalité chez Mitchell s’apparente à une hantise, laquelle trouverait son symptôme dans la création d’une galerie de non-humains, invisibles, indétectables, s’introduisant dans les corps des humains à leur insu. A l’instar des virus.
Convoquer une telle figure est bien sûr loin d’être fortuit chez un auteur à ce point obsédé par la porosité des frontières et la récursivité en général. Mais jusqu’où cette métaphore est-elle opératoire au sein du texte et pour le lecteur ? Que dit-elle du non-humain et, par ricochet, de la figure de l’humain ? Enfin, comment se lit-elle et à quel régime de lecture participe-t-elle ?
I. La mise en scène du virus
La thématique du virus est centrale dans le premier roman de Mitchell, Ghostwritten, où le personnage du fantôme ou non-corpum est récurrent dans chacun des neuf récits. Il s’agit d’une forme de conscience désincarnée qui loge dans le corps d’hôtes humains, « transmigrant » de l’un à l’autre par le biais du toucher. Le non-corpum est presque indétectable : les personnages centraux des premiers récits suggèrent sa présence mais la crédibilité de leur récit est entachée par la suspicion de troubles mentaux, comme dans l’extrait suivant où le narrateur schizophrène est tombé sous l’emprise d’un gourou.
All of us in Sanctuary knew how, thirty years ago, while travelling in Tibet, a being of pure consciousness named Arupadhatu transmigrated into His Serendipity, and revealed the secrets of freeing the mind from its physical shackles. This had been the beginning of His Serendipity’s path up the holy mountain. Even if the body of His Serendipity were harmed, he could leave his old body and transmigrate into another, as easily as I change hotels and islands. He could transmigrate into his own assassin. (Ghostwritten, 30)
Au fil du texte, les références aux fantômes et aux phénomènes surnaturels deviennent de plus en plus explicites. Puis dans le cinquième récit situé en Mongolie, le non-corpum prend en charge la narration et raconte son histoire comme le ferait un humain : ce changement de perspective contribue à asseoir la plausibilité du personnage de parasite ou virus. Quinze ans plus tard Mitchell recourt de nouveau aux figures virales dans The Bone Clocks, à ceci près qu’il a conçu deux catégories distinctes de parasites migrants. Les Horologistes sont les plus proches des non-corpum : il s’agit d’entités conscientes, des incorporeals (61) qui migrent dans les corps d’enfants sur le point de mourir puis vivent une existence humaine apparemment normale, meurent et se réincarnent à nouveau. En très petit nombre (une dizaine), ils comptent parmi leurs rangs des returnees, réincarnés alternativement en hommes ou femmes n’importe où dans le monde, et des sojourners qui restent dans leur territoire d’origine.
I envied her. For a Returnee like myself, each resurrection is a lottery of longitudes, latitudes and demography. We die, wake up as children forty-nine days later, often on another land-mass. Pablo Antay tried to imagine an entire metalife in one place as a Sojourner, migrating out of one old or dying body into a young and healthy one, but never severing one’s ties to a clan and its territory. (The Bone Clocks, 413)
Les Horologistes combattent les Anchorites, une secte d’humains qui ont découvert le moyen de rester immortels en vampirisant des personnes dont ils boivent l’énergie psychique. Les Anchorites, tout comme les Horologistes, détiennent ainsi le pouvoir de s’immiscer dans la conscience des humains et d’en prendre le contrôle.
Les Horologistes correspondent en grande partie à la définition actuelle du virus : il s’agit d’agents infectieux dénués de métabolisme propre et résidant dans les cellules d’hôtes vivants qu’ils utilisent pour se répliquer. Comme les virus, ces incorporeals infestent un corps avec lequel ils cohabitent sur le long terme. Comme certains virus, ils se transmettent par le toucher et ne franchissent pas la barrière des espèces (Ghostwritten, 163). On retrouve enfin le fonctionnement du virus dormant chez le personnage d’Esther, une sojourner gravement blessée, qui trouve refuge dans le corps d’un humain où elle va demeurer à l’état latent pendant quarante ans avant d’être réveillée à l’occasion d’une crise majeure (The Bone Clocks, 393). Toutefois les incorporeals se distinguent des virus sur plusieurs points. Ils ne se reproduisent pas, ne se répliquent pas ni ne se divisent ; aucune épidémie ne se déclare et ils ne sont pas contagieux. Enfin il n’est pas fait mention de mutations.
A un premier niveau de lecture, Mitchell emprunte donc au virus son mode de dissémination, qu’il mue en « transmigration », pour en faire le moteur des péripéties qui émaillent ses romans. A un second niveau de lecture, Mitchell met en scène toute une série de délibérations et de méta-commentaires qui thématisent la figure du virus et l’insèrent dans un jeu d’indices et de décryptage.
II. Hésitations sémantiques, jeu diagnostique
La multiplication des appellations qui servent à désigner les incorporeals, ce foisonnement sémantique du texte, suggère une certaine instabilité de la caractérisation. Les termes les plus généraux et les plus fréquents sont noncorpum The Bone Clocks, 338The Bone Clocks, 33
A cette instabilité des signifiants Mitchell, qui est aussi lexicomane que manipulateur[4], ajoute un deuxième jeu sémantique sur host / ghost. Dans Ghostwritten il mobilise tour à tour presque tous les emplois de la définition de ghost dans le Merriam Webster. Il développe notamment toutes les possibilités de l’âme, siège de la vie ou de l’intelligence mais aussi la figure d’une âme désincarnée (« especially : the soul of a dead person believed to be an inhabitant of the unseen world or to appear to the living in bodily likeness »). Le texte porte également la trace d’emplois plus rares, comme un esprit ou démon, l’ombre d’une trace, une fausse image sur un écran ou dans un négatif photographique causée par un reflet, et enfin un nègre littéraire, le ghostwriter. Bien sûr Mitchell joue ici avec la contrainte : comment écrire un roman à partir d’une entrée du dictionnaire… Mais pas seulement, car cela lui permet d’exploiter toutes les formes de confrontation et de symbiose entre le parasite (ghost) et son hôte (host), donnant au paradigme du virus une connotation spirituelle et le liant à la thématique de la survie de l’âme. Choisir le terme de ghost lui permet de se greffer sur la longue histoire des débats sur les rapports entre le corps et l’âme, de Platon à Leibniz en passant par Descartes pour la tradition occidentale. Il fait enfin aussi écho à l’impressionnante variété des formes de fantômes dans la culture japonaise[5]. L’éventail polysémique des emplois de ghost lui permet d’allier prescience et rétrospective, c’est-à-dire d’articuler des dimensions temporelles rétrogrades et futuristes, jusqu’à préfigurer les manipulations de la NSA et le cyber-crime, comme le souligne Sean Hooks dans Substance (40-41). Les histoires de fantôme sont un extraordinaire terrain d’expérimentation à ses yeux, a « taxonomical thicket of sub-genres », que Mitchell continue à étudier avec attention, fasciné par leur « ectoplasmic diversity », ce dont il s’explique dans l’interview au Guardian à l’occasion de la sortie de Slade House.
Certains liront ces variations sémantiques comme un signe de faiblesse du récit en raison de la dispersion du propos, et il est vrai que le lecteur peut se sentir dérouté. D’autres y verront la réactivation de l’investigation policière – après tout, quoi de plus aguichant que de suggérer une enquête sur un monstre invisible ? – et médicale à la fois[6]. Le texte nous suggère d’observer les manifestations des incorporeals, d’émettre diverses hypothèses sur leur nature et leur fonction, de les attribuer à des catégories connues, d’évaluer les effets qu’ils peuvent produire : en un mot de poser un diagnostic. L’hypothèse est cohérente avec la fascination qu’exercent les médecins sur Mitchell. Marinus, au fil de ses incarnations successives, exerce une variété de professions médicales, tout comme Meronym dans Cloud Atlas ainsi que divers personnages secondaires. La scène suivante, où Marinus révèle à Holly l’existence des Horologistes dans The Bone Clocks (421) est d’ailleurs littéralement encadrée par des références médicales.
‘Please.’ I place a green key by her saucer. ‘Take this.’
She stares at it, then at me. ‘What is it? And why would I?’
A couple of zombie-eyed junior doctors troop by, talking medical prognoses. ‘This key opens the door to the answers and proof you deserve and need.’
En suggérant une énigme médicale progressivement dévoilée et résolue, Mitchell nous ramène vers l’histoire des virus, qui n’ont été que récemment découverts[7] et sont encore largement méconnus. Les éléments inquiétants disséminés dans le texte (les zombies, le pronostic) font écho à la face sombre du savoir médical, associé aux pathologies et à la mortalité.
III. Miroirs de nos angoisses
Les virus sont en effet d’abord connus du public pour leur potentiel pathogène : ils apparaissent comme des ennemis invisibles car microscopiques mais terriblement puissants car capables de décimer des populations entières et de réduire les civilisations à néant. A ce titre ils sont particulièrement anxiogènes et donnent lieu aux interprétations les plus folles. Dans la discussion qui suit, tirée de Ghostwritten (383), le virus figure la part d’ombre des sociétés, ses cauchemars intimes.
Precisely. You undervalue them. Viruses in cashew nuts, visual organs in trees, subversive bus drivers waving secret messages to one another as they pass, impending collisions with celestial bodies. Citizens like Howard are the dreams and shadows that a city forgets when it awakes.
Les romans de Mitchell mettent d’ailleurs en exergue ce qu’on pourrait appeler des angoisses médicales collectives, à partir de pathologies à la fois répandues, médiatisées et touchant au cœur de la vie : le cancer d’Holly, la confusion mentale de Qasar, l’infertilité de Neal Brose. La maladie prend sens par delà le cas personnel du patient pour s’inscrire sur un plan collectif, comme pierre de touche de la société. Ses romans font ainsi écho à l’analyse de la maladie comme métaphore du système économique par Susan Sontag[8], où le virus (sous la forme du sida) correspondrait à la quatrième phase du capitalisme, après la peste, la tuberculose et le cancer. Or le fait de créer des personnages-virus, de mettre en scène des agents infectieux qui se mêlent aux humains sans qu’on puisse les en distinguer, correspond bien à une hantise de la contamination en ce début de 21e siècle dont on retrouve trace dans divers autres médias. Bernard Perron (128) par exemple en souligne l’importance au sein du jeu vidéo et du genre de l’horreur :
The survival horror genre shares the obsession of the contemporary horror film with the invasion of the body by infectious agents and with the mutation and destruction of bodies. Symptomatic of great social fears and of our schizoid relationship with our body, we witness on both screens frightful mutations.
La liste des ennemis invisibles sur lesquels se focalisent les grandes peurs sociales est longue : on peut penser à la pollution de l’air et de l’eau, à la radioactivité issue de Tchernobyl et Fukushima, aux perturbateurs endocriniens qui se nichent dans les objets du quotidien. Tous ces dangers, bien réels, ont en commun de se diffuser largement et de manière indétectable, de nicher au cœur de l’organisme, d’être potentiellement létaux et d’agir sur le long terme ; en outre, la prophylaxie est quasiment impossible et il n’existe pas de protocole curatif. Zika ou Ebola en sont les équivalents biologiques, l’empiètement de pratiques marchandes sur le domaine privé (AirBnb ou Uber) en est l’équivalent économique.
Mitchell résume ce sentiment collectif de crainte et d’impuissance dans une formule lapidaire : « our lives are pre-ghostwritten by forces around us. » (Ghostwritten, 296) Car ce n’est pas seulement l’action pathogène du virus qui effraie, c’est surtout le pouvoir de contrôle qu’il exerce à notre insu sur notre destinée. La liste des ennemis invisibles en ce début du XXIème siècle inclut aussi les dispositifs technologiques qui nous assujettissent : on peut citer l’espionnage généralisé des échanges conduit par la NSA, le recours massif à la vidéosurveillance ou encore le profilage informatique par Google, Amazon et alias, lequel conduit à l’exploitation de nos données personnelles, là encore à notre insu. La force métaphorique du virus tient en grande partie à sa capacité d’agréger ces peurs sociales, d’autant que nous vivons désormais dans des sociétés qui imbriquent corps et machines. Eric Sadin souligne à ce propos « l’émergence d’une condition duale entrelaçant esprits humains et machiniques, traçant des cartographies recomposées entre organismes biologiques et puissances computationnelles » (29). Peur de la contamination, hantise du contrôle invisible et de la prédation qu’il masque : l’analyse du dispositif par Agamben (46) nous permet d’aller plus loin en posant clairement que l’enjeu est bien celui de la désubjectivation – c’est-à-dire de la déshumanisation.
Les sociétés contemporaines se présentent ainsi comme des corps inertes traversés par de gigantesques processus de désubjectivation auxquels ne répond aucune subjectivation réelle. De là l’éclipse de la politique qui supposait des sujets et des identités réels (le mouvement ouvrier, la bourgeoisie, etc.) et le triomphe de l’économie, c’est-à-dire d’une pure activité de gouvernement qui ne poursuit rien d’autre que sa propre reproduction.
D’une certaine manière, le virus correspond à cette idée d’une captation de la vie (psychique, culturelle, sociale) par des forces inertes et anonymes à la seule fin de la reproduction de ces mêmes forces inertes (la circulation du capital). L’analyse d’Agamben est d’autant plus précieuse qu’elle déborde la description des effets délétères du virus / ennemi invisible pour ouvrir sur la question plus large de la subjectivité et de son rapport à la collectivité.
IV. La question de la métempsychose
On peut lire en effet la référence au virus comme un symptôme des peurs sociales de notre époque mais aussi comme un retour du refoulé, en l’occurrence de la question de l’âme. C’est ce que Mitchell nous suggère au travers du thème de la métempsychose, récurrent chez lui et auquel font écho les figures virales. La première référence est bien sûr dans Ghostwritten, bâti sur les réincarnations successives du non-corpum. La seconde, la plus connue, correspond à l’une des citations les plus célèbres de Cloud Atlas (308) :
Souls cross ages like clouds cross skies, an’ tho’ a cloud’s shape nor hue nor size don’t stay the same, it’s still a cloud an’ so is a soul. Who can say where the cloud’s blowed from or who the soul’ll be ‘morrow?
On peut noter la reprise du thème de la métempsychose dans le film éponyme, réalisé par les Wachowski en collaboration avec Mitchell, au travers d’un procédé ingénieux : un même groupe d’acteurs incarne tous les personnages, en changeant d’âge, de sexe ou de race, sous des maquillages suffisamment grossiers pour qu’on les reconnaisse.
Si on suit ce parallèle, la propagation du virus ferait ainsi écho à la migration des âmes, et il ne s’agirait plus tant de contamination ou d’infestation que de perpétuation de l’esprit par la réincarnation. Outre la similitude des modes opératoires, virus et métempsychose ont ceci de commun qu’ils remettent en cause les frontières de l’individu et posent la question de la définition de la vie. Contrairement aux organismes plus évolués ou même aux bactéries, les virus n’ont pas de métabolisme propre ni ne se reproduisent. Et pourtant ils ne sont pas inertes. Carl Zimmer souligne combien la découverte des virus a perturbé les distinctions biologiques les plus usuelles :
The idea that a host’s genes could have come from viruses is almost philosophical in its weirdness. We’d like to think of our genomes as our ultimate identity. The fact that bacteria have acquired much of their DNA from viruses raises baffling questions. Do they have a distinct identity of their own? Or are they just hybrid Frankensteins, their clear lines of identity blurred away? (38%, chapitre « Our Inner Parasites »)
Peter Childs et James Green dans leur article sur Ghostwritten (27) suggèrent de la même façon que le premier effet des non-corpum et de la référence à la métempsychose consiste à dissocier la subjectivité du sujet lui-même.
Although an example of ancient theories of metempsychosis, the noncorpum also seems a potent symbol for the advent of a historically unprecedented mode of planetary subjectivity constituted by constant mediation. With its string of hosts, the noncorpum also provides a metafictional analogy for the larger design of the novel, and places the reader at once within and yet supplementary to the thoughts of the different narrators.
Enfin la référence à la métempsychose permet à Mitchell de venir perturber d’autres impensés sociaux, à savoir les distinctions entre les races, entre les genres et les hiérarchies entre peuples minorisés et dominants. Le personnage de Marinus se réincarne en effet successivement en homme et en femme, en blanc, en asiatique, en africain. Et il n’est certainement pas pour rien que le personnage d’Esther, présenté comme la forme de vie la plus ancienne et la plus sage remontant à plusieurs millénaires, vienne d’Australie et se réincarne en fillette métisse. En donnant une place centrale à la métempsychose, Mitchell s’éloigne des récits judéo-chrétiens et ouvre la voie à une interprétation non occidentale de la vie et de l’histoire. A cet égard il est intéressant de mettre ses romans en parallèle avec les textes d’anthropologie du dix-neuvième siècle, et notamment la description de la transmigration par le Révérend Wood en 1870 (97-98) :
And to make confusion worse confounded, the aborigines believe very firmly in transmigration, some fancying that the spirits of the departed take up their abode in animals, but by far the greater number believing that they are transformed into white men. This latter belief was put very succinctly by a native who stated in the odd jargon employed by them, that ‘when black-fella tumble down, he jump up all same white-fella.’
This idea of transmigration into the forms of white men is very remarkable as it is shared by the negro of Africa, who could not have had any communication with the black native of Australia. And, still more strangely, like the Africans, they have the same word for a white man and for a spirit. The reader may remember that when Mrs Thompson was captured by the natives, one of them declared that she was his daughter Gi’ôm, who had become a white woman, and the rest of the tribe coincided in the belief. Yet, though she became for the second time a member of the tribe, they seemed to feel a sort of mistrust, and often, when the children were jeering at her on account of her light complexion and ignorance of Australian accomplishments, some elderly person would check them, and tell them to leave her in peace, as, poor thing, she was nothing but a ghost.
Le paradigme du virus et la référence à la métempsychose viennent ainsi perturber les certitudes du lecteur occidental et articuler le propos du roman à une intertextualité planétaire et à une interrogation spirituelle. Les virus sont les déclencheurs d’une circulation intense des signes et des affects par-delà les identités de race, de genre ou d’époque.
V. Le régime de lecture
A ce stade, on peut en revenir à la mise en scène du non-corpum dans Ghostwritten, comme un objet au statut incertain, indicateur d’un trouble dans la lecture. C’est du moins ce que postule Hélène Machinal dans Études anglaises 2011 (470) :
Les romans contemporains qui traitent des perspectives futures de l’humanité héritent du paradigme indiciaire mais la seule figure d’herméneute est un lecteur, dernière et seule entité à même de reconstituer la réalité d’un monde devenu doublement fictif : il a en effet disparu dans une diégèse post-cataclysmique qui est elle-même une réalité fictive (le meilleur exemple de ce phénomène de fictionnalisation au carré se trouve dans The Book of Dave où le monde de l’après-cataclysme est fondé sur la perception du monde d’un personnage dont la santé mentale est discutable. Voir aussi Ghostwritten et son ultime récit qui peut conduire le lecteur à penser que les récits précédents ne sont que des fictions, produits des délires d’un terroriste désaxé).
La contamination par le paradigme viral ne se traduit pas seulement par l’infestation des corps et un déracinement de la subjectivité mais aussi par un trouble de la lecture et de l’interprétation. Le virus hante la pensée contemporaine et en signe la perturbation, comme le rappelle avec brio Thierry Bardini dans « Hypervirus : a Clinical Report » où il analyse des textes de Derrida et Dawkins, Burroughs et Baudrillard. Derrida notamment décrit son œuvre comme virale, dans une interview donnée en anglais :
And if you follow these two threads, that of a parasite which disrupts destination from the communicative point of view — disrupting writing, inscription, and the coding and decoding of inscription — and which on the other hand is neither alive nor dead, you have the matrix of all that I have done since I began writing. (Derrida, 12)
Par delà le problème de la crédibilité du locuteur en général, le paradigme viral modifierait le rapport au discours, en instaurant plusieurs strates de sens et approches discursives. Thématiser la présence du virus au sein du texte, en disséminer les manifestations symptomatiques au fil des neuf récits de Ghostwritten permet à Mitchell en effet de proposer plusieurs régimes de lecture. Le lecteur va ainsi d’une part suivre la séquence des événements et d’autre part repérer les indices de présence du fantôme, éléments qui font réseau entre eux et peuvent paraître inaperçus à la première lecture. Le texte invite ainsi le lecteur averti ou astucieux à reprendre sa lecture, revenant sur le texte et le liant aux autres romans de Mitchell. L’expérience est ainsi réitérée, en écho à la dissémination par réplication des virus, lesquels utilisent le métabolisme des cellules infectées pour produire des éléments nouveaux (génome et protéines) qui formeront les nouveaux virus.
Un exemple assez clair de cette stratégie d’écriture et de lecture concerne le gardien de zoo, une intelligence artificielle produite à la fin du XXème siècle, capable de contrôler les satellites d’observation. Le gardien de zoo est l’un des personnages principaux du neuvième récit « Night Train » (373-420), mais il est suggéré dans le cinquième récit dès la page 141, lors d’une discussion entre une paysanne chinoise et le non-corpum qui l’habite (désigné par « My Tree »).
The eye was high above. It disguised itself as a shooting star, but it didn’t fool me, for what shooting star travels in a straight line and never burns itself out? It was not a blind lens, not: it was a man’s eye, looking down at me from the cobwebbed dimness, the way they do. Who were they, and what did they want of me?
I can hear the smile in My Tree’s voice. ‘Extraordinary! How do you tune yourself into these things?’
‘What do you mean?’
‘It hasn’t even been launched yet!’
Au fil narratif propre à chaque récit enchâssé, Mitchell adjoint un réseau de références que le lecteur est appelé à reconstituer comme un puzzle, sans toutefois disposer de l’image originelle. Face à un texte hanté par la réplication de signes infimes et pourtant cruciaux, le régime de lecture peut flirter avec la paranoïa, ou du moins une certaine hantise du fantôme.
Conclusion
Pour revenir à la question de la temporalité particulière à l’univers de Mitchell, opposer les modèles formels – qu’ils soient basés sur l’enchâssement, la constellation, les fractales ou le labyrinthe – et le modèle biologique d’inclusion et réplication, non seulement n’est guère fructueux mais s’éloignerait sans doute de l’intention de l’auteur. Mitchell utilise régulièrement un mélange de références aux sciences du vivant, aux mythologies et aux mathématiques comme dans la citation suivante :
I read about an Egyptian Goddess who gave birth to a pregnant daughter, whose embryo in turn was already pregnant and so on to infinity. That’s just beautiful. It seems to be a beautiful model for time as well. Every possible moment is contained in this moment, regressing on to infinity. (BBC interview, en ligne)
Son travail sur le non-humain, au travers des figures du non-corpum et des Horologistes, vise au contraire à tisser des continuités, créer des interfaces, des échos et des zones de superposition avec l’humain. C’est à une réflexion sur la frontière comme lieu de labilité et d’échanges qu’il nous invite, et non comme marqueur d’identités immuables et exclusives ; il nous suggère d’y voir une dynamique temporelle collective plutôt qu’un trait dans l’espace. En cela il fait écho à la suggestion heuristique de Carl Zimmer : « Rather than trying to figure out how viruses are not like other living things, it may be more useful to think about how viruses and other organisms form a continuum. » (77%, chapitre « The Alien in the Water Cooler »)
Mais suggérer cela, que la forme la plus précieuse de temporalité est sa forme incarnée, faite de passerelles, de transmission et de relais – ou inversement que le corps est un fragment du temps, conduit à une indétermination heuristique entre le présent, le passé et le futur, l’humain et le non humain, l’organisme vivant et le virus. C’est ce qui en fait un sujet fascinant, propice à la création, mais aussi déroutant, dérangeant. Mitchell travaille ainsi ce que Marie-Eve Tremblay-Cléroux et Jean-François Chassay appelent la « présence insistante et incertaine » (11-12), ce qui ne va pas sans perturber les lecteurs et la lecture. Et c’est au final là que la figure du virus se révèle la plus intéressante, dans la perturbation des cadres établis, comme agent connecteur et transgresseur[9].
Ouvrages cités
Agamben G., Qu’est-ce qu’un dispositif ?, trad. Martin Rueff, Paris, Payot et Rivages, 2007.
Bardini T., « Hypervirus : A Clinical Report » in Arthur & Marilouise Kroker (dir.), 1000 Days of Theory, CTheory.net, 2006. En ligne : [http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=504] (consulté le 1er juillet 2016).
Childs P. et Green J., « The Novel in Nine Parts » in Sarah Dillon, David Mitchell: Critical Essays, Canterbury, Gylphi Limited, 2011, p. 27-29.
Derrida J., « The Spatial Arts: An Interview with Jacques Derrida » in Peter Brunette et David Wills (dir.), Deconstruction and the Visual Arts: Art, Media Architecture, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
Davisson, Z., « How do you say ghost in Japanese », 18 juillet 2011. En ligne : [https://hyakumonogatari.com/2011/07/18/how-do-you-say-ghost-in-japanese/] (consulté le 20 avril 2017).
Davisson, Z., Yurei : the Japanese Ghost, Seattle, Chin Music Press, 2015.
Galloway A. et Thacker E., The Exploit: A Theory of Networks, Minneapolis, University of Minnesota Press, édition Kindle, 2007.
Harris P., « David Mitchell in the Labyrinth of Time », Substance (n° 136, vol 44), 2015, p. 3-7.
Hooks S., « Palter and Prescience – on David Mitchell and Ghostwritten », Substance (n°136, vol 44), 2015, p. 39-54.
Larsonneur C., « En l’espèce ? Variations sur l’humain chez Mitchell et Winterson », in Otrante (n°38), Mutations 1 : corps post-humains, Paris, Kimé, 2015, p. 131-144.
Larsonneur C., « Weaving Myth and History Together : illustration as fabrication in David Mitchell’s Black Swan Green and The Thousand Autumns of Jacob de Zoet » in Image (&) Narrative (17.1), 2016, p. 24-33.
En ligne : [http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/view/1120] (consulté le 1er juillet 2016)
Machinal H., « Origine, identité (en) quête de l’humain dans la fiction post-cataclysmique contemporaine » in Études anglaises 2011/4 (Vol. 64), Paris, Klinsieck, p. 465-476.
Machinal H., « Post-humanité et figures de l’intime : machine à penser et oralité dans Ghostwritten de David Mitchell » in Otrante n° 31-32, S. Archibald (ed.), Paris, Kimé, 2012.
Machinal H., « Devenirs de l’humain et fiction contemporaine : imaginaires de la fin, corps bio-technologiques et subjectivités numériques » in Études britanniques contemporaines 50 | 2016 En ligne : http://ebc.revues.org/3175 (consulté le 22 avril 2017).
Mitchell D., Ghostwritten, Londres, Hodder & Stoughton, 1999.
Mitchell D., Cloud Atlas, Londres, Hodder & Stoughton, 2004.
Mitchell D., The Bone Clocks, Londres, Hodder & Stoughton, 2014.
Mitchell D., « The BBC Nottingham interview with Joe Sinclair », 2004. En ligne : [http://www.bbc.co.uk/nottingham/culture/2004/02/david_mitchell_interview.shtml] (consulté le 1er juillet 2016)
Mitchell D., interview avec David Begley in « The Art of Fiction n°204 », The Paris Review, 2010. En ligne : [http://www.theparisreview.org/interviews/6034/the-art-of-fiction-no-204-david-mitchell] (consulté le 1er juillet 2016)
Mitchell D., « Ghost stories tap into something ancient and primal » in The Guardian, July 12, 2016. En ligne : [https://www.theguardian.com/books/2016/jul/12/david-mitchell-ancient-and-primal-slade-house-twitter] (consulté le 15 juillet 2016)
Perron, B., « The Survival Horror : the Extended Body Genre » in B. Perron (dir.), Horror Video Games : Essays on the Fusion of Fear and Play, Jefferson, McFarland, 2009.
Sadin E., L’Humanité augmentée, Paris, Ed l’Echappée, 2013.
Sontag S., « Illness as Metaphor » in Illness as Metaphor and AIDS and its Metaphors, Londres, Picador, 1990 [1978].
Tremblay-Cléroux M.-E. et Chassay J.-F. (dir.), Les Frontières de l’humain et le posthumain, Montréal, Presses de l’Université du Québec, coll. Figura, 2014.
Wood Rev. J.G., The Natural History of Man: Australia, New Zealand, Polynesia, America, Asia and Ancient Europe, London, Routledge, 1870.
Zimmer C., A Planet of Viruses, 2e édition, Chicago, University of Chicago Press, édition Kindle, 2012.
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XVII
[1] Voir notamment page 4 : « Mitchell’s uberbook maps out a unicursal labyrinth, a linear path whose twists and turns generate a non-linear, topologically embedded time ».
[2] Mitchell décrit son opus comme une série de « infinite matryoshka dolls of painted moments » (Cloud Atlas, 393).
[3] Méphistophélès apparaît dans la troisième histoire, au moment où le personnage principal Neal vacille entre introspection, hallucination et hypothèse surnaturelle (77-78) : « Right at that moment, if Mephistopheles had genied his way from the greasy ketchup bottle and said, ‘Neal, if I let you be that kid, would you pledge your soul to the Lord of Hell for all eternity?’ I’d have answered, ‘Like a fucking shot I will.’ » L’allusion à la pièce de Goethe est renforcée par une théâtralisation du monologue intérieur, qui prend la forme de répliques de scène.
[4] Mitchell peut être comparé à un trickster, soit à la fois le magicien et le filou. Son rapport à la vérité historique est très particulier, basé sur les réécritures et les fraudes, ou ce qu’on appelle en anglais fabrication. Voir à ce sujet l’article que je lui ai consacré dans Image & Narrative.
[5] Il y a plus de dix-sept traductions possibles de ghost en japonais, détaillée par Zack Davisson dans son billet du 18 juillet 2011 « How do you say ghost in Japanese ». Voir aussi son ouvrage Yurei : the Japanese Ghost.
[6] Hélène Machinal (7-8) montre avec brio l’importance de « l’hybridité générique entre policier et SF » dans les fictions contemporaines, littéraires ou audiovisuelles.
[7] Ce n’est qu’en 1879 qu’Adolph Mayer a identifié pour la première fois un virus, responsable d’une maladie du tabac.
[8] Dans Illness as Metaphor, un texte de 1978 qui analysait le phénomène du cancer et auquel elle a rajouté un développement sur le sida en 1990. Ce type de pensée est proche que de ce que propose Mitchell dans ses fictions, notamment dans la description qu’il fait des phénomènes d’exploitation économique.
[9] Pour Galloway et Thacker : « Biological viruses are connectors that transgress the classification systems and nomenclatures that we define as the natural world or the life sciences ». ( 45%, sous-section « The Exploit »)