Thomas Vercruysse est actuellement chercheur postdoctorant à l’Université du Luxembourg. Membre du groupe Valéry de l’ITEM/CNRS et correspondant étranger de la revue "Aisthesis", ses recherches portent sur les liens entre esthétique et épistémologie. Il s’apprête à publier un essai chez Droz, "La cartographie poétique - Tracés, diagrammes, formes, Valéry, Artaud, Mallarmé, Michaux, Segalen, Bataille". Principales publications :
- "Parole de la mère et symbolisme du père dans la poésie de Vénus Khoury-Ghata" in "Paroles, langues et silences en héritage", Caroline Andriot-Saillant (éd.), Clermont-Ferrand, PUBP, 2009 - "La peau et le pli : Bernard Noël, pour une poétique de la réversibilité" in Lendemains, 2009, Tübingen, Gunter Naar, 2009.
- "La bêtise selon Valéry et l’idiotie de Valéry". Colloque "bêtise et idiotie" tenu à Nanterre en octobre 2008, organisé par Nicole-Jacques Lefèvre et Marie Dollé (actes à paraître).
- "Intensité et modulation : Valéry à la lumière de Deleuze" Colloque "L’intensité : formes, forces et régimes de valeurs", tenu à Poitiers en juin 2009, organisé par Colette Camelin et Liliane Louvel (actes à paraître dans "La Licorne"). Editions :
- Tome XII des Cahiers de Valéry, à paraître chez Gallimard en 2011. "Georges Bataille philosophe", Franco Rella, Susanna Mati, Vrin. A paraître en mars 2010.
- « Paul Valéry- Identité et analogie », Valérie Deshoulières et Thomas Vercruysse (éd.), revue Tangence (à paraître).
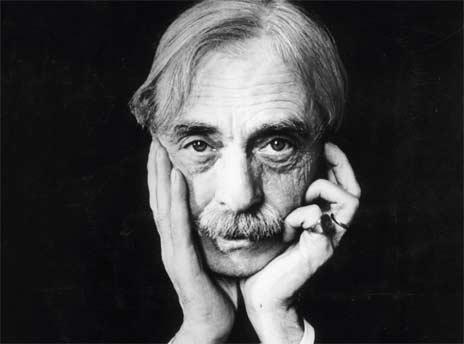
« L’acte pur des métamorphoses » – Aspects de la forme chez Valéry
Le problème de la forme chez Valéry s’apparente à un carrefour, c’est une façon de situer la question de sa poétique, de la faire advenir en un site fécond, heuristique. La forme constitue un observatoire privilégié en tant qu’elle détermine des problématiques de vaste portée et qu’elle autorise de larges transferts de concepts. Nous examinerons ici comment, en passant d’une esthétique, c’est-à-dire d’une théorie de la sensation, à une poétique, c’est-à-dire une théorie de la forme, Valéry finit par livrer une réflexion sur le vivant qui le place sous l’horizon du transformisme[1]. Cette question donne lieu à un théâtre d’influences ou de résonnances, et voit se dérouler une véritable « dramaturgie conceptuelle »[2].
Le nœud de cette dramaturgie est contenu dans le titre de cette étude : « l’acte pur des métamorphoses », que Valéry applique à Athiktè, la danseuse de L’Âme et la danse. Nœud en forme de paradoxe, car la problématique de l’acte, telle que Valéry l’hérite d’Aristote, suppose que celui-ci soit contenu dans la puissance, comme l’arbre est contenu dans la graine. La théorie de l’acte chez Aristote, inséparable du concept de telos, de finalité, indique que l’acte, visant une fin, est déjà contenu dans la puissance. L’energeia, l’acte, est en relation de continuité avec la puissance, la dunamis, et se réalise sous la forme de l’œuvre, l’ergon. L’acte lui-même est alors voué à la prévisibilité.
Mais Valéry prend le contre-pied de cette conception en introduisant dans l’acte l’imprévu de la métamorphose. « L’acte pur des métamorphoses », accolé par Valéry à la danse, n’est pas l’exécution d’une partition mais l’accomplissement d’une performance, et il n’est qu’à prendre connaissance des travaux fondateurs de Josette Féral sur les arts de la performance[3] pour sentir le rapprochement possible avec Valéry, rapprochement livré explicitement par les théoriciens de la danse contemporaine[4].
Pour comprendre les enjeux de cette formule paradoxale d’« acte pur des métamorphoses » et tenter d’en délivrer la vigueur, nous proposons ici une généalogie qui n’est pas celle d’une histoire ni d’une filiation avérée mais celle d’une hypothèse, celle du potentiel transformateur associé à la notion de forme.
Des deux Platon aux deux Valéry
Pierre Brunel, dans Le Mythe de la métamorphose[5] souligne que la cosmogonie du Timée n’est qu’un mythe, avec la fonction endossée par le mythe chez Platon qui est d’assurer le relais de la dialectique, non dans le but de découvrir le vrai, mais d’exposer une image de la vérité qui serait provisoirement hors d’atteinte par d’autres moyens. Le mythe serait donc la continuation de la dialectique avec d’autres moyens, mais serait voué à l’obsolescence. Le muthos devant, in fine, être hypostasié au logos, ou plutôt au dialeghestai, à la dialectique platonicienne. L’ironie est que, sur ce point, la pensée mythique de Platon est d’une plus grande fécondité que sa pensée dialectique, et appelée à une postérité qu’il conviendra ici d’esquisser.
Le Timée représente la khôra, l’univers en gestation, décrit comme « nourrice du devenir ». À la khôra s’oppose le cosmos, le bon ordre, l’univers envisagé dans sa stabilité, garantissant la stabilité de l’être, tel qu’il est représenté dans le Phèdre et la République. Khôra et cosmos s’opposent alors comme le devenir s’oppose à l’être. Chez Platon, Pierre Brunel relève le conflit entre la conception de l’âme exposée dans le Phèdre et la République, d’après laquelle une âme animale ne peut subsister dans un corps humain, et le Timée qui autorise une telle possibilité. Apulée, auteur de récit de Métamorphoses, revendiquant son néo-platonisme, se réfèrerait alors au Platon du Timée, non au Platon du Phèdre ou de la République. Ainsi, la conception platonicienne de la métempsychose, de la transmigration des âmes contenue dans le Timée offrirait une caution philosophique aux récits de métamorphoses, même s’il s’agit d’une philosophie du muthos.
Cette opposition de la khôra et du cosmos polarise aussi la pensée valéryenne. Kristeen Anderson a ainsi montré dans une belle étude[6] qu’il était possible de distinguer dans l’imaginaire valéryen un pôle masculin, caractérisé par le souci de maîtrise ainsi que par la volonté de discriminer les formes et de se façonner un Système, un pôle placé sous la tutelle du scopique donc, et un pôle féminin où l’ouïe et la voix prédominent, un pôle intégrant la profondeur et la remise en contact avec l’informe. Cette dichotomie recouvre en bien des points celle de l’apollinien et du dionysiaque de Nietzsche de la Naissance de la tragédie : d’un côté, Apollon, « la mesure dans la délimitation »[7] auquel est également rattaché, dans la lignée de Schopenhauer, le principe d’individuation et de l’autre, le dionysiaque comme dessaisissement de la continuité individuante. Nietzsche nous enjoint ainsi à nous représenter « l’extase délicieuse que la rupture du principium individuationis [du principe d’individuation] fait monter du fond le plus intime de l’homme, ou même de la nature » afin de se donner « une vue de l’essence du dionysiaque, que l’analogie de l’ivresse rendra plus proche encore […] Sous le charme de Dionysos, non seulement le lien d’homme à homme vient à se renouer, mais la nature aliénée – hostile ou asservie – célèbre de nouveau sa réconciliation avec son fils perdu, l’homme »[8]. Le dionysiaque est ivresse car il est fusion avec l’Un, qui remet l’homme en contact avec la nature et avec son origine bestiale. Le fondement de la pensée des métamorphoses, telle qu’elle sera exposée par Ovide et Apulée notamment, où l’homme sort des limites de sa forme, de son ego, pour tendre vers l’animal ou vers la plante, trouve ici une autre justification philosophique.
Cette dynamique nous a semblé rencontrer des échos étonnants avec une approche plus strictement scientifique de l’individuation, telle qu’elle fut entreprise par Gilbert Simondon : « ce que l’individuation fait apparaître n’est pas seulement l’individu mais le couple individu-milieu. (Le milieu peut d’ailleurs ne pas être simple, homogène, uniforme, mais être originellement traversé par une tension entre deux ordres extrêmes de grandeur que médiatise l’individu quand il vient à être) »[9]. Ce parallèle entre la pensée nietzschéenne de l’ego et la philosophie du vivant de Simondon nous reconduit naturellement à Valéry et à son assimilation des principes apollinien et dionysiaque appliqués à ce qu’il nommait son « Système ». Simondon écrit ainsi : « L’individuation doit alors être considérée comme résolution partielle et relative qui se manifeste dans un système recelant des potentiels et renfermant une certaine incompatibilité par rapport à lui-même, incompatibilité faite de forces de tension aussi bien que d’impossibilité d’une interaction entre termes extrêmes des dimensions »[10]. Le terme de « potentiels » ou encore l’expression « forces de tension » font ressortir les accents proprement valéryens (et nietzschéens) du texte de Simondon. Plus troublant apparaît encore la mise en œuvre du « devenir de l’être » :
Le mot d’ontogenèse prend tout son sens si, au lieu de lui accorder le sens, restreint et dérivé, de genèse de l’individu […] on lui fait désigner le caractère de devenir de l’être, ce par quoi l’être devient en tant qu’il est, comme être. […] Mais il est possible aussi de supposer que le devenir est une dimension de l’être, correspond à une capacité que l’être a de se déphaser par rapport à lui-même, de se résoudre en se déphasant ; l’être préindividuel est l’être en lequel il n’existe pas de phase.[11]
L’individuation, « on ne peut la comprendre qu’à partir de cette sursaturation initiale de l’être sans devenir et homogène qui ensuite se structure et devient, faisant apparaître individu et milieu, selon le devenir qui est une résolution de ces tensions premières et une conservation de ces tensions sous forme de structure »[12]. Cette structure dialectique entre apollinien et dionysiaque, entre discrimination des formes et poussée vibratoire d’une onde qui incite à renouer avec l’unité primordiale du milieu s’est progressivement imposée à Valéry, contrariant le pôle Narcisse, et donc scopique de son écriture. Car le fond noir du miroir ne se contente pas d’être constitutif d’un plan, il est travaillé par une poussée qui brise la logique réduplicante du Même :
Je ne suis que ton Dieu – dit cette voix, que je ne reconnus pas. Car je connais ma voix intérieure, et celle-ci était intérieure, mais non du tout la mienne. Mais que veut dire…Mienne ?
Je ne suis que ton Dieu, dit cette voix, et il n’y a presque rien entre nous. Je te parle à ton oreille intime. […] Qui veux-tu qui puisse s’être logé au centre de toutes choses, TOI, si ce n’est Celui que je suis ? (C, XXVIII, 3)[13]
Valéry a fait l’expérience de cette voix intime lors de l’écriture de La Jeune Parque, voix qui, face au registre scopique triomphant qui avait le plus souvent animé son imaginaire, fait entendre à Valéry « la musique intérieure qui est en moi ». À cette expérience d’écriture fit écho la lecture d’un article d’Adolphe Brisson sur la comédienne Rachel, qui dans Valéria, drame d’Auguste Maquet et de Jules Lacroix, interprétait le rôle de l’impératrice Messaline avec une voix grave, celui de Lycisca avec une voix plus élevée. Valéry, ayant lu cette article dans une phase de doute lors de l’écriture de La Jeune Parque, écrivit de manière significative : « Je reconnus ma voie ». (Œ, I, 1493)[14].
L’idiosyncrasie valéryenne se définira comme « self-variance », indiquant par là que le moi est métamorphique ; et composer la Jeune Parque le sensibilisera à la variation des régimes de valeur entre le Moi et ce qu’il appelle la « Mystérieure Moi » ; l’exemple de Rachel l’encourage à s’appuyer sur la voix pour signaler les changements de registres identitaires avec expressivité. Utiliser la voix comme outil de caractérisation n’est sans doute pas original, mais revêt d’autres implications quand on met en parallèle ce choix avec les émotions ressenties par Valéry lors de ses premières lectures de Mallarmé. Dans « Je disais quelquefois à Stéphane Mallarmé… » (Ibid., 649), Valéry dit s’être pour ainsi dire détourné de la lecture de Hugo et de Baudelaire lorsque, à dix-neuf ans, il put lire « Les Fleurs », « Le Cygne » et des fragments d’Hérodiade :
Rien de plus antique, ni d’ailleurs de plus naturel que cette croyance dans la force propre de la parole, que l’on pensait agir bien moins par sa valeur d’échange que par je ne sais quelles résonances qu’elle devait exciter dans la substance des êtres. […] l’accent et l’allure de la voix l’emportent sur ce qu’elle éveille d’intelligible : ils s’adressent à notre vie plus qu’à notre esprit. (Ibid.)
La « vie » est prise ici dans un sens probablement nietzschéen, et résolument inchoatif : « Je veux dire que ces paroles nous intiment de devenir, bien plus qu’elles ne nous incitent à comprendre » (Ibid., 650). La dimension d’intellection, dont on a vu qu’elle se plaçait sous le patronage du scopique, est ici évincée par le processus d’individuation que déclenche la voix. Ecrire le monologue de la conscience consciente impliquera pour Valéry d’étudier comment l’énonciation de sa propre observation permet, dans ses modes de profération, de différer d’avec soi. La poétique de la conscience consciente s’affirme ainsi comme une hétéropoïétique. Elle pense sa continuité à partir d’une différence constitutive.
Cette différence, Kristeen H. R. Anderson propose de la situer dans le pôle féminin de Valéry, celui qui recèle la voix et s’oppose à son souci de maîtrise : « Dans l’écriture de Valéry une curieuse tension se décèle entre le ton de certitude de la domination intellectuelle que l’on pourrait nommer […] le registre de Gladiator, et l’accent du pathétique révélateur d’un état de dissolution de la sensibilité »[15]. Cet attrait pour le non-différencié, à l’opposé du pôle Apollon-Gladiator qui s’attache à la discrimination des formes, se manifeste en effet dans cette autre dimension de l’être associée à une présence ou à un élément féminin : la voix des monologues de Rachel, entendue par « un étranger qui se promène le soir », est celle « d’une femme qui parle. […] Ce sont… des pensées toutes nues, parfaitement naturelles – comme…la durée chantée par l’eau – ou la vie…chantée par le rossignol. […] Et cela (car cette parole est l’acte du cerveau libre…) est pensée intrinsèque, émission non dirigée, élimination…- Et énoncé de tout »[16] (C, XIX, 128). Commentant ce passage, Kristeen H. R. Anderson souligne la fusion avec le milieu permise par la voix, continuité du non-différencié qui se distingue de la continuité individuante apollinienne : « Ici, par opposition au principe de différenciation qui anime l’imaginaire gladiatorial, s’exprime une participation de la conscience dans son produit, continuité non seulement entre source et émission garantie par la sonorité de la voix, mais également entre l’esprit et la réalité phénoménologique assurée par l’imagination sonore. Nous nous trouvons cette fois dans une tout autre disposition psychique, favorable à la fluidité, à la fusion, au proche »[17].
Le féminin serait alors chez Valéry ce qui échappe à l’économie scopique et rationaliste de Gladiator et se rattache à la voix. Le féminin du moi qui, écrit Ned Bastet, est « le plus sourdement agissant sur une sensibilité profondément “remuée” »[18] le sensibilise, de fait, à la création et à sa profondeur : « La vraie “création poétique” se passe dans le complexe de l’être qui a la voix pour résolution […] C’est la voix qui développe le poète, le modifie, lui et sa véritable “profondeur”» (C, XXVI, 80). Profondeur peuplée de figures féminines qui finissent par déchirer le voile rationaliste du Système, dressé par Gladiator et Teste pour faire réentendre l’appel réprimé de la voix, ainsi que le montre Ned Bastet :
Lorsque, après cette longue ascèse et ce refus de l’Ego qui ont suivi la crise spirituelle de la vingtième année, l’abandon de la poésie et l’anathème jeté sur l’amour, l’austère réclusion dominée par des figures toutes masculines dont Monsieur Teste fut le « grand prêtre », la tentation poétique mystérieusement se réveille en Valéry, ce sont des figures toutes féminines qui surgissent de la nuit : Agathe d’abord, « Sainte du Sommeil » émergeant à peine des liens mystérieux où elle se débat, puis l’éveil, inquiet d’abord, triomphant pour finir, de la Jeune Parque. Le Féminin se libère et parle, naît la Voix.[19]
L’hétéropoïétique apparaît comme le fondement du poétique qui est surgissement de l’Autre, de l’Autre féminin du moi qui est la Voix. La connaissance ne peut se contenter du rationnel déterminé et forclos dont Narcisse domine le territoire de surface. Kristeen H. R. Anderson souligne cette percée « du solipsisme absolutiste du Narcisse »[20] où « reflet, écho, clôture »[21] sont perturbés par la poussée nocturne, sonore, profonde, qui affirme l’exigence pour celui qui veut connaître de s’ouvrir à cet inconnu, imprévisible, non maîtrisable : « Les ténèbres, la nuit, la dimension de l’inconnu sont pour lui rappeler que la voie intérieure, spirituelle, exige également une confrontation avec le corps comme substance désirante, profondeur, réalité somatique sous-jacente à la lumière du rationnel »[22].
La lumière du rationnel doit donc se doter d’une appréhension volumique que requiert et permet le féminin. C’est l’enjeu de l’évolution de Narcisse à la Jeune Parque : « Ainsi, entre le Narcisse et la Parque se produit une transformation radicale de l’espace-temps du corporel ; là où lui se perdait en pure superficie, elle se sait réceptacle, se reconnaît comme volume et profondeur »[23]. La logique du Même qui assurait la forclusion de Narcisse est bien dépassée au profit d’une ouverture vers l’Autre, un autre ayant la figure d’un être féminin comme si Valéry découvrait que pour s’appréhender dans sa totalité il lui fallait intégrer le masculin et le féminin de la conscience ; après Narcisse et l’étape de la Parque, la résolution s’appelle sans doute « Faust et Lust [qui] sont moi – et rien que moi » (C, XXIX, 804-5). La voix ferait passer Valéry du dualisme corps-esprit, hérité de Descartes, à un monisme ontologique.
Il a fallu passer par une étape de rupture décrite dans des textes comme « La Pythie » et La Jeune Parque, véritable traversée du négatif, car si « le noir n’est pas si noir» (Œ, I, 109), « la retraversée de la matière physiologique, du noir et de l’inconnu de la substance du corps »[24] a été néanmoins nécessaire. L’agonie de la Pythie nous rend témoins « du processus même de la division ou rupture du corps en espace producteur de la voix, d’une voix qui incarne et donne naissance au sujet pleinement intégré »[25]. On peut rappeler ici les accents violents de cette rupture qui reconfigure le corps en capacité d’accueil de la voix :
Je sens dans l’arbre de ma vie
La mort monter de mes talons ! […]
Ah ! brise les portes vivantes !
Fais craquer les vains scellements, […] (Œ, I, 135)
Mais enfin le ciel se déclare !
[…] une voix nouvelle et blanche
Echappe de ce corps impur (Ibid., 136)
Les « vains scellements » à briser évoquent les barrières, écluses empêchant la circulation des flux du corps pulsionnel, soumis à l’organisme, dont Artaud offre un autre exemple d’émancipation. En-deçà de ces stratifications, il s’agit peut-être bien ici de retrouver ce que Julia Kristeva a exploré comme étant la dimension pré-symbolique du langage poétique, ce qu’elle appelle le « sémiotique », état pré-linguistique de la sensibilité, « antérieur à la nomination, à l’Un, au père, et, par conséquent, connoté maternel à tel point que pas même le rang de syllabe ne lui convient »[26]. Cet état dit « sémiotique » se rapproche de l’état premier du langage évoqué par Valéry dans un passage des Cahiers :
Au-delà, en-deçà des noms sont les pronoms, qui sont plus – vrais déjà, et plus près de la Source. Et ces mots qui viennent aux amants et aux mères, et qui sont de l’instant, du tout près de la sensation de vie – quand la chair trop près de la chair balbutie… Avant le nom n’est que le souffle, la rumeur…Dans tous ces temps qui sont sans connaissance, Ecoute le son de la Voix, Vierge ou Veuve de mots. (C, XXI, 870)
La voix doit, pour résonner, affronter ce féminin de l’être, source souvent véhémente, avant de la moduler (« […] toute lyre / Contient la modulation ») (Œ, I, 133) en « Saint LANGAGE ) (Ibid., 136). L’état sémiotique, pré-symbolique du langage, se présente ainsi comme une remise en contact avec l’informe, la voix offrant une matière à travailler dans son altérité, la profondeur proposant une source d’énergie nouvelle au circuit fermé de Narcisse, condamné à l’entropie. Cet état sémiotique, Julia Kristeva l’identifie à la khôra platonicienne « matrice […] dans laquelle les éléments sont sans identité et sans raison »[27]. C’est parce qu’elle baigne ses éléments d’indétermination que la khôra est qualifiée par Platon de « nourrice du devenir »[28]. Mais Platon fera subir une opération de réduction au devenir que représente le rythme, afin de l’ontologiser[29] et de le réduire au metron, au mètre, gardien du cosmos, du bon ordre, alors même que la khôra, telle que l’expose Julia Kristeva, « est le lieu d’un chaos qui est et qui devient, préalable à la constitution des premiers corps mesurables »[30].
À rebours des formes mesurables et mesurées de l’apollinien, de la maîtrise de Gladiator, le rythme et le melos livrent une impulsion proprement motrice : « Seule l’intelligence du melos donne le mouvement véritable. » (C, XXV, 621). Ned Bastet le fait remarquer très justement : « Par-delà l’imaginaire valéryen du mesurable et de la géométrie du plaisir, c’est un autre imaginaire plus profond qui s’exprime ici […] et qui se définit […] comme onde, propagation, résonance »[31]. La spécificité du rythme[32], qui crée perpétuellement sa modulation imprévisible, sa respiration indépendante du mouvement du métronome, si elle nous reconduit à l’opposition entre ruthmos et metron, est aussi à réinscrire dans le cadre d’une « morphologie générale des formes vivantes »[33], d’une conception énergétique générale de la dynamique vivante du système nerveux, une mécanique de la sensation et du plaisir liée à une théorie des « directions »[34], des « contrastes »[35]. La poétique se présente bien comme hétéropoïétique dans son fondement et dans son fonctionnement, car elle est générée par des contrastes. L’événement poétique ressortit en cela du domaine des « inégalités, des écarts, des asymétries » (C, XXIV, 699) ; il se produit « quand les circonstances intus et extra excitent un état tel que nul moyen d’expression ni de satisfaction ne peut lui donner une forme finie ni une résolution exacte. » (C, XXIII, 528). L’événement, dans sa nécessité, traduit un reste, non assimilable par notre sensibilité générale qui « n’est pas organisée pour compenser ou éliminer tous les cas possibles d’action des choses sur nous et leur donner des réponses qui annulent ces actions. » (Ibid.). L’urgence de l’événement poétique se manifeste donc comme une déficience du système nerveux qui reçoit les stimuli, ce que Valéry appelle le système Demande-Réponse, lorsque l’énergie psychique libérée ne trouve pas de pensée ou d’acte dans lesquels faire porter sa charge, conformer sa force. Le besoin poétique qui anime la voix, naissant du souci de donner une forme à une inégalité[36], est fondamentalement hétéropoïétique, « équilibre mobile[37]. Toupie. » (C, XXIX, 150).
Hétéropoïétique, car issu de l’hétérogène[38], dans son désir aussi de manifester un refus : la khôra, lieu du sujet poétique en procès, « est une multiplicité de re-jets qui assurent le renouvellement à l’infini de son fonctionnement »[39]. Après avoir voulu construire un univers normé, un cosmos caractérisé par le souci de maîtrise de son pôle masculin, le sujet créateur s’évertue à le perturber pour en établir la cartographie nouvelle, placé sous le signe de la khôra. Ned Bastet analyse finement ce mouvement de balancier du sujet valéryen :
C’est la passion secrète de l’intellect qui a besoin, d’abord, de réduire cette présence foisonnante et multiforme à un ensemble, à un bloc homogène et opposé, à cet « univers » qui n’est en soi que fiction mais qu’il rameute de force dans l’unité d’un Etant pour pouvoir s’y opposer à son tour en tant qu’acte unique et continu d’une Egoïté qui ne s’affirme, par-delà sa propre fragmentation et ses risques d’évanescence, que par l’énergie de son refus et le totalitarisme de son Fiat recréateur.[40]
L’acte mental doit « installer l’être que je crée dans le vide conquis sur l’être d’abord donné, s’ouvrir un libre espace dans le “ce qui n’existe pas” »[41] ; telle se manifeste pour Valéry l’activité de l’esprit dans le monde, foncièrement interventionniste, portée par un nihilisme fécond. S’ouvrir un libre espace implique de s’écarter de l’espace du metron, qu’on peut rapprocher de ce que Deleuze et Guattari appellent « l’espace strié » et qu’ils opposent à « l’espace lisse ». Pour donner un modèle musical de cette opposition, ils prennent l’exemple de Pierre Boulez :
Au plus simple, Boulez dit que dans un espace-temps lisse on occupe sans compter, et que dans un espace-temps strié l’on compte pour occuper. Il rend ainsi sensible ou perceptible la différence entre des multiplicités non métriques et des multiplicités métriques, entre des espaces directionnels et des espaces dimensionnels.[42]
L’on retrouve ici l’hétéropoïétique comme théorie des directions et des contrastes, proche en cela de l’espace lisse, où la ligne est « un vecteur, une direction et non pas une dimension ou une détermination métrique. […] L’espace lisse est occupé par des événements ou heccéités, beaucoup plus que par des choses formées et perçues. C’est un espace d’affects, plus que de propriétés. C’est une perception haptique, plutôt qu’optique »[43]. L’espace haptique, placé sous la tutelle de l’ouïe et du toucher est un espace d’affects, s’opposant ainsi à l’espace optique qui attribue des qualités repérables, discriminantes. C’est un tel espace, appartenant « à une hétérogénéité de base »[44], s’écartant du souci de maîtrise omniscient du scopique, qui est de nature à accueillir les rythmes de l’événement, même si la composante « strié » exerce un rôle[45]. Il s’agit de comprendre comment procède le poétique pour échapper aux limites de son striage. Pour ce faire, nous devrons avoir recours à la comparaison célèbre que Valéry développe entre la poésie et la danse.
Le danser comme modèle de la production des formes
La comparaison du poème à la danse fait l’objet d’un célèbre développement de Poésie et pensée abstraite :
La marche, comme la prose, vise un objet précis. Elle est un acte dirigé vers quelque chose que notre but est de joindre. Ce sont des circonstances actuelles, comme le besoin d’un objet, l’impulsion de mon désir, l’état de mon corps, de ma vue, du terrain, etc., qui ordonnent à la marche son allure, lui prescrivent sa direction, sa vitesse, et lui donnent un terme fini. […] Il n’y a pas de déplacements par la marche qui ne soient des adaptations spéciales, mais qui à chaque fois sont abolies et comme absorbées par l’accomplissement de l’acte, par le but atteint.
La danse, c’est tout autre chose. Elle est sans doute un système d’actes ; mais qui ont leur fin en eux-mêmes. Elle ne va nulle part. Que si elle poursuit quelque objet, ce n’est qu’un objet idéal, un état, un ravissement, un fantôme de fleur, un extrême de vie, un sourire – qui se forme finalement sur le visage de celui qui le demandait à l’espace vide.
Il s’agit donc, non point d’effectuer une opération finie, et dont la fin est située quelque part dans le milieu qui nous entoure ; mais bien de créer, et d’entretenir en l’exaltant, un certain état, par un mouvement périodique qui peut s’exécuter sur place ; mouvement qui se désintéresse presque entièrement de la vue, mais qui s’excite et se règle par les rythmes auditifs. (Œ, I, 1330)
Il est à noter ici cet affaissement du scopique au profit de l’auditif dans l’état de poésie que l’on a déjà relevé précédemment à propos de l’irruption de la voix dans La Jeune Parque, prenant le dessus sur le pôle scopique de Gladiator et sa volonté de possession. La danse comme le poème articulent un certain rapport à l’espace-temps, qui se traduit par un détachement du milieu, du moins du milieu pratique qui est une invitation à la fin, une prescription intimant à mener une opération finie. C’est cet espace-temps spécifique créé par la danse que nous allons maintenant tâcher d’étudier en rapprochant la conception valéryenne de celle d’Erwin Straus, psychiatre dont Henri Maldiney a diffusé les concepts en France. Erwin Straus compare les mouvements de la marche avec ceux de la marche en musique ou de la danse :
Loin d’être quelconques, les mouvements que la musique induit sont d’une espèce tout à fait singulière. Des formes de mouvement telles que la marche [en musique] ou la danse ne sont simplement possibles qu’en référence à la musique. En d’autres termes, celle-ci forme d’abord la structure d’espace dans laquelle le mouvement dansant peut se produire. L’espace optique est l’espace du mouvement finalisé, qui est dirigé et mesuré ; l’espace acoustique est l’espace de la danse. Danse et mouvement finalisé ne sont pas à comprendre comme des combinaisons différentes d’éléments moteurs identiques ; ils se distinguent comme deux formes fondamentales du mouvement en général, qui se rapportent à deux modes différents du spatial.[46]
On relève ici ce qui nourrit l’opposition entre les mouvements finalisés de l’espace optico-pratique, dont la finalité absorbe le « faire » propre, et les mouvements dansants. Cette distinction rejoint exactement celle, déjà évoquée, que Valéry établit entre la marche et la danse. En effet, la marche en musique tend déjà vers la danse pour Straus et annule le rapport directionnel à l’espace :
L’acte d’aller ne nous sert plus à nous faire progresser de A vers B, à nous faire surmonter une distance spatiale ; lorsque nous marchons en musique, nous nous éprouvons nous-mêmes, nous vivons notre corps dans son action d’entrer à grandes foulées dans l’espace. Nous vivons non pas l’action mais le faire vital.[47]
Cette affirmation indique non seulement que le mouvement en musique abandonne son telos, sa finalité, mais aussi et ce, de manière plus radicale, qu’il abandonne le rapport directionnel à l’espace, c’est-à-dire l’orientation. Le faire vital, ce que j’appelle la « cartographie poétique », suppose d’abandonner l’orientation au profit de la libre graphie d’un tracé, en se plaçant dans un rapport acoustique et non plus optique envers l’espace. C’est ici que la « cartographie poétique »[48] s’écarte du modèle de l’arpentage, propre à la cartographie galiléo-cartésienne, fondée sur la géométrie analytique d’obédience scopique. Il s’agit ici non pas de mesurer une surface mais d’éprouver un volume :
La danse ne se rapporte pas à une direction ; nous ne dansons pas pour parvenir d’un point de l’espace à un autre. N’y a-t-il pas, notamment chez les primitifs, de nombreuses danses qui ne présentent absolument aucun déplacement local ? […] En allant, nous nous mouvons à travers l’espace, d’un lieu à un autre ; en dansant, nous nous mouvons dans l’espace. En allant, nous couvrons une certaine distance, nous arpentons (durchmessen) l’espace. La danse, en revanche, est un mouvement non dirigé et non délimité.[49]
La différence entre le mode optique de l’arpentage et le mode acoustique de la danse et de la « cartographie poétique » peut se traduire par la dichotomie entre deux prépositions anglaises : l’arpentage galiléo-cartésien fonctionne sur le mode d’across, la danse et la « cartographie poétique » sur le mode de through. Cette distinction des modes optique et acoustique de la présence entraîne un rapport différent au corps dansant du point de vue du danseur mais aussi du point de vue du spectateur. La musique est ainsi présentée par Straus comme le « moment pathique », la nature fondamentale du vécu propre à l’expérience artistique qui abolit la distinction entre danseur et spectateur, les faisant advenir dans un même espace :
C’est une chance que l’expérience quotidienne rende chacun à même d’observer en personne quelle signification les qualités spatiales, et tout particulièrement le moment pathique, détiennent dans la formation des vécus. Nous pouvons en avoir la preuve chaque fois que nous nous rendons au cinéma. Si un film est présenté sans musique au spectateur, la distance à laquelle les images apparaissent est modifiée ; elles sont inhabituellement éloignées, sans vie, et ont une allure de marionnettes. Ce qui manque, c’est le contact avec les scènes qui, sobres, sèches, monotones, se déroulent devant nos yeux. Nous contemplons l’action mais n’y assistons pas. Le contact se noue sitôt que la musique débute. […] Il suffit que l’espace s’emplisse de sons pour que déjà une liaison existe entre le spectateur et l’image.[50]
Ce rapprochement correspond précisément à l’abolition que promet Valéry entre le lecteur et le créateur du poème. La dimension musicale de la diction crée ce moment pathique qui place le lecteur dans le même espace vécu, le fait participer à la même émotion que le créateur. Si, d’un lecteur à l’autre, le vécu du poème est évidemment différent, il n’y a plus de barrière en droit séparant lecteur et créateur du poème. La diction fait exister entre eux une communauté qui noue une liaison entre le poème et chacun d’eux, de même que la musique crée cette liaison entre spectateur et image qui fait naître une liaison intime, charnelle.
Elle les fait advenir en son site, qui n’est pas celui de l’espace institué. Elle les fait advenir dans ce que Straus appelle le « devenir-un » et qu’il va nous falloir préciser. Ce « devenir-un » est du registre de l’ex-stase, de la sortie de la délimitation, spatiale mais aussi temporelle, sortie qu’il faut d’abord expliciter pour comprendre comment s’opère l’extase du « devenir-un ». Il réintroduit d’une certaine manière le thème de l’informe, mais sous les espèces du quelconque, pour montrer comment procède l’absence de délimitation. Si le danseur peut se trouver limité, la danse n’est pas assignée à cette limite :
La piste de danse peut avoir une configuration quelconque. Elle restreint le danseur, mais pas à proprement parler la danse. C’est précisément le caractère quelconque de cette configuration, l’indifférence de sa grandeur et de sa forme qui nous permettent de reconnaître que le mouvement dansant trouve ses bornes, mais non sa limite nécessaire, aux extrémités de la surface sur laquelle il évolue – alors que l’acte d’aller est limité en lui-même par son point de départ et son terme.[51]
Cette absence de limitation du geste dansant recouvre, pour une bonne part, le geste poétique : si le poète, dans la poésie versifiée, est limité par les contraintes métriques, le geste poétique parvient, malgré la contrainte, à ne pas limiter son jaillissement, au contraire. La rigidité de la forme fait entrer le geste dans la plasticité, la forme quelconque fait entrer dans l’informe. Il s’agit-là du moment extatique de la création, qui ne désigne pas précisément l’enthousiasme romantique et concerne plutôt ce que Valéry appelle, dans « Au sujet d’Adonis », le deuxième vers, celui qui doit rimer avec son « aîné surnaturel » :
J’ai seulement voulu faire concevoir que les nombres obligatoires, les rimes, les formes fixes, tout cet arbitraire, une fois pour toutes adopté, et opposé à nous-mêmes, ont une sorte de beauté propre et philosophique. Des chaînes qui se roidissent à chaque mouvement de notre génie, nous rappellent, sur le moment, à tout le mépris que mérite, sans aucun doute, ce familier chaos, que le vulgaire appelle pensée et dont ils ignorent que les conditions naturelles ne sont pas moins fortuites, ni moins futiles, que les conditions d’une charade. C’est un art de profond sceptique que la poésie savante. Elle suppose une liberté extraordinaire à l’égard de l’ensemble de nos idées et de nos sensations. Les dieux, gracieusement, nous donnent pour rien tel premier vers ; mais c’est à nous de façonner le second, qui doit consonner avec l’autre, et ne pas être indigne de son aîné surnaturel. Ce n’est pas trop de toutes les ressources de l’expérience et de l’esprit pour le rendre comparable au vers qui fut un don. (Œ, I, 481-482)
Il peut paraître curieux et déplacé de parler d’extase là où Valéry lui-même parle d’art « sceptique ». La dimension sceptique, bien réelle, se manifeste dans l’opération d’écarter, impitoyablement, de ce que charrie le flux de l’esprit, tout ce qui n’entre pas dans les nombres de la métrique. Mais le génie, pris dans les « chaînes qui se roidissent », est bel et bien présent, et ce génie n’exclut pas le travail, le « faire ». Le « faire » consiste à entrer dans l’informe pour passer entre les chaînes de la métrique, retrouver une plasticité qui existait d’emblée dans le vers surnaturel, donné par les dieux. L’extase est cette entrée dans le ruthmos et sa plasticité constitutive, pour pouvoir franchir les barrières du metron, du nombre orientant l’espace et la mesure du temps. Ces limitations existent, mais ce ne sont pas d’elles que procède le geste de la « cartographie poétique », qui consiste à œuvrer à l’émancipation de ces limites, émancipation en tant que celles-ci ne feraient plus office de barrières extérieures. Il s’agit de sortir de la détermination a priori du nombre et de la mesure de la poésie versifiée pour les constituer en barrières naturelles, entrer dans une forme d’empathie avec elles, qui échappe au calcul déductif, anticipatoire. Cette empathie échappe à la réflexion ainsi qu’à l’intelligence pratique. Si le sceptique peut barrer l’accès à ce qui ne doit pas entrer dans le vers, seul un certain génie peut remplir ce dernier. C’est ici que nous pouvons retrouver le thème de l’extase comme « devenir-un », tel que le développe Straus à propos de la danse :
Au fondement de la danse se trouve un « vivre » qui s’éloigne de façon polaire de la connaissance théorique, de l’intelligence pratique, de l’action planifiant et calculant en fonction de certains buts et de la domination technique des choses […]. Lorsque nous disons que la tension existant entre le sujet et l’objet, entre le moi et le monde se trouve pleinement suspendue dans le vécu de la danse, nous ne concevons nullement cette opération comme étant liée à une réflexion […][52]. La suspension de la tension sujet-objet, qui s’opère à travers la danse entière jusqu’à l’extase, n’est pas le vécu d’une dissolution du sujet, mais celui d’un « devenir-un ». C’est pourquoi le danseur a besoin d’un partenaire, d’un individu ou d’un groupe ; c’est pourquoi il a besoin avant tout de la musique, qui seule donne à l’espace entier un mouvement propre auquel le danseur peut prendre part. Ce dernier est introduit et emporté dans le mouvement ; il devient membre d’un mouvement d’ensemble qui saisit harmoniquement l’espace, l’autre et lui-même.[53]
Ce mouvement d’ensemble se laisse décrire dans la légende d’Orphée, à laquelle Erwin Straus fait justement allusion :
Dans la légende d’Orphée, les hommes et les animaux, les arbres, les forêts et même les roches, les montagnes et les eaux suivent le son de sa lyre. La légende a ainsi trouvé à exprimer de façon simple et grandiose la force inductrice de la musique à laquelle la nature entière, animée et inanimée, est soumise.[54]
C’est ainsi que ce manifeste ce primat de l’induction sur la déduction que nous considérons comme caractéristique de la « cartographie poétique ». Si elle nous semble s’illustrer de manière décisive dans des écritures modernes de la première moitié du XXe siècle, celles-ci réactivent finalement la force originelle du mythe. Mythe qui a justement fait l’objet d’une réécriture par Valéry lui-même, peignant superbement le mouvement d’extase dans lequel le paysage est saisi, animé par le chant d’Orphée :
Si le dieu chante, il rompt le site tout-puissant ;
Le soleil voit l’horreur du mouvement des pierres ;
Une plainte inouïe appelle éblouissants
Les hauts murs d’or harmonieux d’un sanctuaire.
Il chante, assis au bord du ciel splendide, Orphée !
Le roc marche, et trébuche ; et chaque pierre fée
Se sent un poids nouveau qui vers l’azur délire ! (Œ, I, 76-7)
Ainsi, l’analyse d’Erwin Straus sur l’espace, qu’il développe à la suite de son évocation du mythe, pourrait tout aussi bien tenir lieu de commentaire du poème de Valéry : « Dans une telle perspective, il est tout à fait sensé de parler de mouvement de l’espace. Car cet espace vécu est toujours un espace empli et articulé ; il est nature ou monde »[55]. Ce sentiment de communauté, de « devenir-un », créé par la force inductrice du rythme, tel que la danse ou le mythe d’Orphée sont capables de le mettre en évidence, est de l’ordre d’une participation sensorielle. Si Straus insiste une fois de plus dans ce passage sur la participation suscitée par le rythme musical, c’est qu’elle lui permet d’approfondir la comparaison du régime optique et du régime acoustique :
La différence est encore plus nette lorsqu’un rythme s’offre sur un mode successivement optique et acoustique. Tandis que la vision d’une troupe défilant sur l’écran sans accompagnement musical ne suscite en nous aucun co-mouvement, nous sommes d’emblée saisis par la musique de marche et soulevés dans notre être moteur.[56]
Cette participation est fondamentale et permet de penser le lien, de restaurer la continuité entre les créations spontanées de la sensibilité et la création artistique, entre l’aisthesis et la poiesis. Renaud Barbaras, phénoménologue, apporte un commentaire lumineux et profond sur cette articulation, avant de faire état du soulèvement de l’être moteur propre au régime acoustique de la danse :
Comme l’a montré Straus, la danse manifeste une unité originaire du sentir et du se-mouvoir, unité antérieure à tout apprentissage et constitutive de l’un et de l’autre. Elle est une mise en forme spontanée de l’ordre auditif inhérente à l’audition même ; elle révèle une activité de création inscrite dans la réceptivité sensible elle-même. L’art chorégraphique, quant à lui, n’est autre, comme le remarque Straus, qu’un modelage spécifique d’une unité générale qui préexiste aux impressions sensorielles et aux mouvements, et qui se confond avec l’approche elle-même. La danse se situe ainsi à l’articulation des créations spontanées de la sensibilité et de la création artistique et elle en révèle par là même la continuité. La danse précède l’art chorégraphique : elle apparaît dans toutes les civilisations, elle accompagne spontanément chez chacun l’audition d’un rythme au point qu’on peut se demander si notre aptitude à écouter sans danser n’est pas l’effet d’un long travail d’inhibition.[57]
Bien appréhender cette articulation suppose d’établir précisément une distinction entre la sensation et la perception, entre sentir et percevoir. D’après cette dichotomie, que nous allons explorer davantage plus loin, le sentir ne serait pas disponible d’emblée, offert au sujet. Il serait à reconquérir, à reprendre à l’espace optico-pratique, strié. L’espace de la « cartographie poétique » serait, si l’on suit Erwin Straus, à reprendre, à arracher à l’espace optico-pratique, espace de type historique. L’espace de notre corps propre, l’espace de notre géographie, nous serait en fait masqué par les stries tracées par l’« histoire de notre action sur le monde »[58] :
Dans l’espace optique, nous réalisons nos buts, nous y vivons l’histoire de notre vie. Dans l’espace acoustique, nous ne vivons que le présent, nous oublions le passé et l’avenir, nous n’y réalisons rien de concret et nous n’exprimons que l’union qui existe entre nous et le monde ambiant[59].
Dans la danse, le processus historique ne progresse pas : le danseur s’arrache au flux du devenir historique. Son vivre est un être-présent qui ne renvoie à aucune conclusion dans l’avenir et qui, pour cette raison n’est pas limité dans l’espace et dans le temps. Son mouvement est une mobilité non dirigée qui vibre à l’unisson du mouvement propre de l’espace, par lequel elle est induite pathiquement. L’espace empli par le son et homogénéisé par un seul et même mouvement a en lui-même un caractère présentiel ; c’est d’ailleurs en cela que l’homogénéité du mode acoustique spatial se distingue de celle de l’espace métrique vide. […] Nous voyons donc comment un mode original de l’espace s’édifie sur la nature du son, sur sa présence propre, son déploiement temporel, sur les moments de l’homogénéisation, de l’induction, du présentiel.[60]
Cette homogénéité de l’espace lisse, acoustique, marque le primat de l’induction sur la déduction dans la danse et la « cartographie poétique ». Cette homogénéité se distingue de l’homégénéité euclidienne qui caractérise l’espace strié du metron au profit d’une dimension « présentielle » dont les caractéristiques doivent être précisées à la lumière de la distinction entre perception et sensation. Le « présentiel » de l’espace lisse se cartographie à la faveur du nœud commun de la musique et de la danse, nœud que Straus nomme ivresse dans le chapitre « Différence entre le sentir et le percevoir » de Du sens des sens. Il y expose une analogie décisive : le monde du sentir est au monde du percevoir ce que le paysage est à la géographie. Au sein de ce couple d’oppositions, la géographie resterait finalement trop liée au modèle de l’arpentage, modèle où se déposent avec aisance les stries de l’espace historique, optico-pratique. La « cartographie poétique » s’épanouirait dans la saisie particulière, dans le sentir propre au paysage, d’après les concepts d’Erwin Straus :
Dans le paysage, nous cessons d’être des êtres historiques […]. Nous n’avons pas de mémoire pour le paysage, nous n’en avons pas non plus pour nous dans le paysage. Nous rêvons en plein jour et les yeux ouverts. Nous sommes dérobés au monde objectif mais aussi à nous-mêmes. C’est le sentir. La conscience vigile de soi a une orientation diamétralement opposée et définit la perception […].
Le contraste que j’essaie de mettre en évidence en opposant la géographie au paysage, je l’ai déjà décrit ailleurs [dans « Les formes du spatial »], à propos de la différence entre l’espace acoustique et l’espace optique, entre l’espace de la danse et celui du mouvement dirigé.[61]
Dans cette analogie, livrée en deux temps, le sentir serait au percevoir ce que le paysage est à la géographie, et le paysage serait à la géographie ce que l’espace acoustique de la danse est à l’espace optique (et finalement historique, de par son processus de sédimentation). Le dénominateur commun, le soubassement générique que la danse et la musique auraient en partage serait bien l’espace du sentir, dont la relation avec le monde serait de l’ordre d’une « communication pathique », opposée à la « représentation gnosique du percevoir[62] ».
Voyons à présent comment se traduit cette importance du sentir chez Valéry. Chez l’auteur de La Jeune Parque, « l’ordre des choses esthétiques » est à tendance infinie car, comme il le fait remarquer dans « L’infini esthétique », « dans cet ordre, la satisfaction fait renaître le besoin, la réponse régénère la demande, la présence engendre l’absence, et la possession le désir. » (Œ, II, 1343). Ce vécu propre au désir dans l’esthétique est comparé explicitement par Valéry à l’amour et à la sexualité. Le plaisir ne satisfait pas le désir mais le régénère :
[Le Philosophe,] devant le mystère du plaisir dont je parle [est] séduit mais intrigué, par la combinaison de volupté, de fécondité, et d’une énergie assez comparable à celle qui se dégage de l’amour, qu’il y découvrait, ne pouvant séparer, dans ce nouvel objet de son regard, la nécessité de l’arbitraire, la contemplation de l’action, ni la matière de l’esprit […] (Œ, I, 1300)
Ne pas séparer « la contemplation de l’action » définit pour l’esthétique un certain mode de présence du sensible où la sensation entretiendrait un vécu solidaire avec l’action. Renaud Barbaras a déterminé avec acuité que si le désir, dans l’esthétique valéryenne, n’est pas désir d’un plaisir mais du désir lui-même, « la présence de l’objet esthétique ne fait pas alternative avec son absence »[63]. Il ne se livre que sous la forme d’un certain retrait, ne paraissant que dans la retenue d’une sorte de distance intérieure :
L’objet esthétique peut être défini par la relation spécifique qu’il induit entre le sentir et l’agir. Est esthétique l’objet dont la présence suscite un mouvement visant à la reconduire. Il faut être ici précis. L’objet suscite ce mouvement dans la mesure où, en sa présence même, il est vécu comme manquant. […] C’est un mouvement efficient, visant précisément à combler le manque de l’objet, c’est-à-dire à produire un autre objet. […] Ainsi, en toute rigueur, la perception d’une œuvre – tout au moins la perception de l’œuvre en tant qu’objet esthétique, c’est-à-dire comme absente à elle-même – consiste en un agir, en une création qui se veut une recréation.[64]
Nous serons ici plus précis que Renaud Barbaras, en affirmant que c’est non la perception, mais la sensation d’une œuvre qui se confond avec sa production, avec sa recréation. Si Valéry neutralise l’opposition, ou la distinction, entre le point de vue de la création et celui de la sensibilité, donc entre la danseuse et le spectateur comme entre l’auteur et le lecteur, c’est dans le sentir que s’éprouve l’absence de l’œuvre à elle-même, ainsi que ce désir de la rendre présente comme telle qui revient à créer. L’étude de Renaud Barbaras s’intitule d’ailleurs « Sentir et faire », et son propos, un peu plus loin, s’appuie comme le nôtre sur la notion de sentir, notamment quand il s’agit de distinguer Valéry de Merleau-Ponty.
À l’instar de Merleau-Ponty, Valéry reconnaît une continuité essentielle de l’expérience sensible et de l’art, mais contrairement à Merleau-Ponty, qui l’établissait au niveau de l’expression, Valéry pose cette continuité « au niveau même du sentir »[65] :
La sensation, en tant qu’elle donne lieu à un mouvement spontané, apparaît comme une œuvre inchoative et l’œuvre proprement dite comme une amplification du mouvement qui s’esquisse dans la sensation.[66]
Chez Merleau-Ponty, aussi bien la perception que l’action qui la suppose, donc tout usage humain du corps est déjà « expression primordiale », l’expression primordiale étant « l’opération première qui constitue les signes en signes, fait habiter en eux l’exprimé par la seule éloquence de leur arrangement et de leur configuration, implante un sens dans ce qui n’en avait pas […] »[67]. Le corollaire est qu’il y a continuité, et prolongement, entre l’activité artistique et la vie perceptive : « c’est l’opération expressive du corps, commencée par la moindre perception, qui s’amplifie en peinture et en art »[68]. La vie perceptive et l’activité créatrice de l’art sont donc profondément entrelacées dans la phénoménologie merleau-pontyenne, entrelacement décrit en ces termes par Renaud Barbaras :
L’expression primordiale dont le corps est le vecteur annonce l’expression proprement créatrice ; en retour, celle-ci vient éclairer le sens véritable de la corporéité et délivrer le sens natif du monde corrélatif de cette corporéité.[69]
Si cette perspective paraît difficilement contestable dans son principe et dans ses intentions, c’est sur le plan des moyens qu’elle présente une difficulté majeure. Merleau-Ponty ne saisit pas l’unité de la perception et de l’art, soit l’unité esthétique, sur le plan de l’esthétique elle-même :
L’unité de la perception et de l’art n’est jamais comprise comme unité esthétique, c’est-à-dire comme fondée dans un sentir. Or ceci est d’autant plus embarrassant que ce qui justifie le rapprochement des deux champs et l’usage du terme esthétique, dès Baumgarten, est la référence à l’aisthesis qui, dans les deux cas, est au cœur de l’expérience : c’est bien parce que l’œuvre d’art fait appel par excellence au sentir et suppose comme une amplification et une complication du sentir que la discipline qui en traite est nommée esthétique.[70]
L’analyse merleau-pontienne se trouve limitée par le choix de son fondement : en ayant recours au concept d’expression, sa phénoménologie établit une continuité entre deux champs, l’esthésique et l’esthétique, à partir d’une notion qui n’appartient en propre à aucun d’eux. Son analyse se condamne, par là même, à l’abstraction. La force de l’esthétique valéryenne tient, quant à elle, au fait qu’elle dépasse l’analyse merleau-pontienne (du moins celle du Merleau-Ponty d’avant Le visible et l’invisible) en insistant sur l’idée d’une préfiguration de l’expérience esthétique au sein de l’expérience sensible elle-même. La sensibilité, chez Valéry, est sollicitée par l’épreuve d’une absence qui active sa dimension productive, poïétique. C’est ainsi que le tracé de la « cartographie poétique » est amené à s’effectuer, comme il l’expose dans le Discours sur l’esthétique :
La sensibilité, qui est son principe et sa fin, a horreur du vide. Elle réagit spontanément contre la raréfaction des excitations. Toutes les fois qu’une durée sans occupation ni préoccupation s’impose à l’homme, il se fait en lui un changement d’état marqué par une sorte d’émission, qui tend à rétablir l’équilibre entre la puissance et l’acte de la sensibilité. Le tracement d’un décor sur une surface trop nue, la naissance d’un chant dans un silence trop ressenti, ce ne sont que des réponses, des compléments, qui compensent l’absence d’excitations – comme si cette absence, que nous exprimons par une simple négation, agissait positivement sur nous. On peut surprendre ici le germe même de la production de l’œuvre d’art. (Œ, I, 1409)
Nous retrouvons ici des éléments de la composante hétéropoïétique que nous développions plus haut : c’est à partir d’un déséquilibre, d’une hétérogénéité, que la forme va être générée. L’absence, le manque, entraîne le désir et son intensification, excès de force qui va s’exercer dans l’energeia, dans l’énergie en acte du tracé cartographique. Sa composante diagrammatique, qui tient à l’excès de la force sur le signe, doit être ramenée à la force du sentir lui-même, et non à l’expression, comme c’est le cas dans la phénoménologie merleau-pontienne de la perception. Cette intensité du sentir annexée au manque, au désir du désir, stimule la pression jaculatoire donnant son impulsion au tracé de la « cartographie poétique ». Le fonctionnement de « désir du désir » chez Valéry, et non de recherche de satisfaction par le plaisir, mis en lumière par Renaud Barbaras, fait ici entendre des accents clairement lacaniens.
L’espace lisse comme « présence pleine », ainsi que nous l’avons exploré dans la danse et la musique doit donc s’entendre plutôt comme tension vers, effort vers la présence, mais au niveau du sentir, non de la « conscience vigile » du cogito. En effet, comme Renaud Barbaras y insiste :
La sensibilité doit être située par-delà l’alternative de la réceptivité et de l’activité parce que, loin de se rapporter à son contenu positif, elle est au contraire relation à ce qui manque à tout contenu, rapport à l’absence plutôt qu’à la présence[71].
Ce rapport à l’absence détermine une morphogenèse ou une morphodynamique, la production d’une forme tirant son origine non d’une communauté expressive, comme c’est le cas chez Merleau-Ponty, mais d’une communauté pathique comme les analyses de Straus et de Valéry nous y invitent. Nous ne pouvons donc, ici, que suivre l’exposé brillant et substantiel de Renaud Barbaras :
On ne parvient à dépasser le point de vue abstrait d’une philosophie de l’expression, c’est-à-dire à fonder cette continuité au lieu de se donner l’art dans la perception sous forme d’expression inchoative, qu’à la condition de faire apparaître l’œuvre de mise en forme au niveau sensible comme l’œuvre du sensible lui-même, bref à fonder dans le mode de donation du contenu son dépassement dynamique dans une forme. Au lieu de s’en tenir au constat d’une communauté expressive, il s’agit donc de mettre au jour dans l’épreuve originaire du contenu, bref dans la sensibilité, la raison d’une production spontanée de la forme et de son amplification sous forme d’activité artistique.[72]
Dans cette production spontanée de la forme par le sentir lui-même ; l’opposition entre sentir et agir, entre agent et patient semble annulée. Cette annulation s’explique par la mise entre parenthèses du cogito, garantissant l’unité de l’être et du sujet et ouvrant la voie à un sujet disponible aux métamorphoses. Nous proposons, à l’appui de cette idée, un commentaire de Georges Didi-Huberman sur la conception valéryenne de la danse :
Danser : devenir l’autre. […] Si le danseur produit une « forme du temps », comme l’écrit Valéry, cette forme ne sera cependant que « moments, éclairs, fragments, […] similitudes, conversions, inversions, diversions inépuisables » (Œ, II, 155, 172, 176) qui altèrent et la forme (au sens de l’aspect) et le temps (au sens de la succession). Ce que Valéry nomme, magnifiquement, « l’acte pur des métamorphoses » (Ibid., 165). Comment, dans un tel acte, le danseur pourrait-il préserver l’unité de sa personne ? « Cet Un veut jouer à Tout. » (Ibid., 171)[73]
Conclusion : une poétique transformiste
Si danser c’est devenir l’autre, cette conception rappelle la plasticité du sujet créateur référée par Aristote ou Pseudo-Aristote, dans le Problème XXX, à la plasticité de l’homme mélancolique, soumis aux variations car il est l’homme du kairos, des circonstances. Cet Un qui veut jouer à Tout, se déclinant à la faveur des circonstances permet de penser le lien entre cette création humaine et la théorie des prototypes dans la morphogenèse goethéenne, d’après laquelle les différentes variétés d’une plante se déclineraient à partir d’un modèle unique : de l’Un on passe à Tout. Dans le discours qu’il consacre à Goethe, Valéry propose significativement un parallèle entre la maîtrise de la forme linguistique de nature poétique et la forme naturelle modelée par la plante : « [ …] dans le poète ou dans la plante, c’est le même principe naturel : tous les êtres ont une aptitude à s’accommoder, et cette aptitude variable mesure leur aptitude à vivre, c’est-à-dire à demeurer ce qu’ils sont, en possédant plus d’une manière d’être ce qu’ils sont. » (Œ, I, 538).
Valéry rapproche ici le conatus, concept de Spinoza, grande influence de Goethe, par lequel le poète et la plante persévèrent dans leur être (« demeurer ce qu’ils sont ») avec le potentiel transformateur (« possédant plus d’une manière d’être ce qu’ils sont »). Le lieu de leur articulation est le kairos, la circonstance, qui détermine les variations de l’être dont le devenir est une dimension, comme l’ont montré les philosophies de Nietzsche mais aussi de Simondon, précédemment cités. Goethe serait parvenu à lire la ligne exercée par la modulation des forces formatives s’adaptant aux circonstances :
Goethe passionnément s’attache à l’idée de métamorphose qu’il entrevoit dans la plante et dans le squelette des vertébrés. Il recherche les forces sous les formes, il décèle les modulations morphologiques […] Il décrit avec la plus grande exactitude les effets de l’adaptation, et quelques-uns des tropismes qui régissent la croissance des plantes, l’équilibre de puissances qui s’établit et se rétablit, heure par heure, entre une loi intime de développement et le lieu et les circonstances accidentelles. Il est un des fondateurs du transformisme. (Œ, II, 543)
Dans la morphogenèse naturelle comme dans la poétique, le modèle commun serait peut-être alors le « danser », tel que Valéry et Straus en livrent les caractéristiques.
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XIII
[1] Sur ce point, voir l’étude très stimulante d’Edwige Phitoussi, « La danse : acte pur des métamorphoses ? », in « Ce qui fait danse : de la plasticité à la performance », La Part de l’Œil, Bruxelles, 2009.
[2] Nous empruntons cette expression à Michel Pierssens.
[3] Voir sa somme : Josette Féral, Théorie et pratique du théâtre, Paris, Entretemps, 2011.
[4] Voir par exemple Laurence Louppe, Poétique de la danse contemporaine, Bruxelles, Contredanse, 1997.
[5] Pierre Brunel, Le Mythe de la métamorphose, Paris, José Corti, 2004.
[6] Kirsteen H. R. Anderson, « Valéry et la voix mystique – la rencontre avec le féminin », inPaul Gifford et Brian Stimpson (éds.), Paul Valéry – Musique, Mystique, Mathématique, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1993.
[7] Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, traduction de Michel Haar, Philippe Lacoue-Labarthe, Jean- Luc Nancy, Paris, Gallimard, Folio-essais, 1977, pp. 29-30.
[8] Ibid., pp. 30-31.
[9] Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Grenoble, Millon, 1995, p. 25.
[10] Ibid.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Paul Valéry, Cahiers, édition dite « fac-similé » du CNRS en 29 volumes, Paris, 1957-1961. Le numéro du volume est indiqué en chiffres romains, suivi du numéro de page en chiffres arabes. Les citations de Valéry seront intégrées au corps du texte.
[14] Paul Valéry, Œuvres, éd. Jean Hytier, 2 volumes, Paris, Gallimard, Pléiade, 1957 et 1961, abrégés ainsi : Œ, suivi du numéro du volume en chiffres romains et du numéro de pages en chiffres arabes.
[15] Kristeen H. R. Anderson, op.cit., p. 277.
[16] Cité par Kristeen H. R.Anderson, ibid., p. 278.
[17] Kristeen H. R.Anderson, ibid., p. 278.
[18] Ned Bastet, Valéry à l’extrême, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 118.
[19]Ibid., pp. 118-119.
[20] Kristeen H. R.Anderson, op. cit., p. 287.
[21] Ibid.
[22] Ibid., p. 285.
[23] Ibid., p. 287.
[24] Kristeen H. R.Anderson, op.cit., p. 288.
[25] Ibid.
[26] Julia Kristeva, Polylogue, Paris, Seuil, 1977, p. 159.
[27]Ibid., p. 57.
[28] Platon, Timée, in Timée/ Critias, GF- Flammarion, traduction inédite, introduction et notes de Luc Brisson avec la collaboration de Michel Patillon pour la traduction, 1992, 52, p.152.
[29] Sur ce point, voir Jacques Derrida, Positions, Paris, Minuit, p.100 et « La double séance » in La dissémination, Paris, Seuil, 1972.
[30] Julia Kristeva, op. cit.
[31] Ned Bastet, op. cit., p. 128.
[32] La formule de Ned Bastet sur le rythme, « préincarnation de la parole qui va naître » (op. cit., p. 114) entre ici en écho avec les analyses de Julia Kristeva et de Kristeen H. R. Anderson sur la voix comme état présymbolique.
[33] Ibid., p. 126.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Cette inégalité, dans la khôra, est aussi temporelle. Jacques Derrida écrit ainsi que « La khôra est anachronique, elle « est » l’anachronie dans l’être, mieux, l’anachronie de l’être. Elle anachronise d’être. », in Khôra, Paris, Galilée, 1993, p. 25.
[37] La khôra elle-même ne parvient à trouver l’équilibre : « la nourrice du devenir, qui offrait à la vue une apparence infiniment diversifiée, ne se trouvait en équilibre sous aucun rapport étant donné qu’elle était remplie de propriétés qui n’étaient ni semblables ni équilibrées, et que soumise de partout à un balancement irrégulier, elle se trouvait elle-même secouée par les éléments, que secouait à son tour la nourrice du devenir, en leur transmettant le mouvement qui l’animait. », in Platon, op. cit., 52-53, pp. 153-4.
[38] C’est sous le signe de l’hétérogène que débute Polylogue, l’ouvrage de Kristeva, hétérogène qui traduit un refus de se laisser enfermer dans le mesurable : « La science du langage poursuit sa vision platonicienne d’un objet mesurable, sans dépense. La politique de la linguistique se mesure à l’enfermement structural ou systématique du langage dans la mathesis. Pourtant, les lapsus, les jeux de mots, le « style », témoignent de quelques dérangements de la structure qui, bien sûr, se refait, mais en portant la trace d’une hétérogénéité. », in Julia Kristeva, op. cit., p. 13.
[39] Julia Kristeva, op. cit., p. 58.
[40] Ned Bastet, op. cit., p. 52.
[41] Ibid., p. 53.
[42] Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 596.
[43] Ibid., p. 597.
[44] Ibid., p. 609.
[45] Dans Misérable, Miracle, Michaux verse à son crédit certaines mises au jour qu’elle permet : « Dans le champ noir apparaissent d’abord des plages luisantes dans lesquelles se dessinent des stries, infiniment rapprochées, identiques à celles qui m’annoncent tous les jours la venue du sommeil. Le champ s’animant progressivement, les stries deviennent lignes de courbures de surfaces immatérielles, qu’elles sont seules à révéler. », in Œuvres, II, éd. Raymond Bellour et Ysé Tran, Paris, Gallimard, 2001, p. 764.
[46] Erwin Straus, « Les formes du spatial », in Figures de la subjectivité, éd. Jean-François Courtine, Paris, CNRS éditions, 1992, p. 31.
[47] Ibid., p. 32.
[48] Nous nous permettons de renvoyer ici à notre ouvrage, La cartographie poétique – Tracés, diagrammes, formes (Valéry, Artaud, Mallarmé, Michaux, Segalen, Bataille), à paraître chez Droz.
[49] Ibid., p. 34.
[50] Ibid., p. 30.
[51] Ibid., p. 34.
[52] Ibid., p. 36.
[53] Ibid., p. 42.
[54] Ibid.
[55] Ibid.
[56] Ibid., pp. 30-31.
[57] Renaud Barbaras, « Sentir et faire. La phénoménologie et l’unité esthétique », in Phénoménologie et esthétique, Renaud Barbaras, Raymond Court, Françoise Dastur, La Versanne, Encres marines, 1998, p. 38.
[58] L’expression est de Frédéric Pouillaude, in Le désoeuvrement chorégraphique – essai sur la notion d’œuvre en danse, Paris, Vrin, 2010, p. 66.
[59] Erwin Straus, « Le mouvement vécu », Conférence du 12 décembre 1935, Extrait des Recherches philosophiques du Groupe d’études philosophiques et scientifiques pour l’examen des nouvelles tendances, 1935-6, Boivin, 1937, p. 135. Cité par Frédéric Pouillaude, op. cit., p. 67.
[60] Erwin Straus, « Les formes du spatial », op. cit., p. 45.
[61] Erwin Straus, Du sens des sens, Partie IV, chapitre 7 « Différence entre le sentir et le percevoir », trad. fr. par J.-P.Legrand et G.Tines, Grenoble, Millon, pp. 382-383.
[62] Frédéric Pouillaude, op. cit., p. 68.
[63] Renaud Barbaras, op.cit., p. 28.
[64] Ibid., pp. 28-29.
[65] Ibid., p. 32.
[66] Ibid.
[67] Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, NRF, 1960, p. 84. Cité par Renaud Barbaras, op. cit., p. 22.
[68] Ibid., p. 87.
[69] Renaud Barbaras, op. cit., p. 22.
[70] Ibid., p. 23.
[71] Renaud Barbaras, op. cit., p. 36.
[72] Ibid., p. 37.
[73] Georges Didi-Huberman, Le danseur des solitudes, Paris, Minuit, 2006, pp. 24-25.
