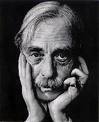Le mot signale aussi un but à l’horizon de la recherche, la forme close d’une sphère ou d’un anneau d’idées [4]. Le Système valéryen est alors la représentation de l’ancienne intuition d’un système fermé de la connaissance où chaque élément est « saturé » [5]. » [6] . La comparaison avec l’Ars magna de Lulle, encouragé par Nicole Celeyrette-Pietri, n’est pas sans pertinence, mais nous voudrions nous demander ici s’il est possible de rapprocher la machine autopoïétique, convoitée par Valéry, de modèles qui lui seraient plus contemporains. Umberto Eco, qui évoque justement Lulle dans son étude sur La recherche de la langue parfaite, mentionne le cas, charnière, de Condorcet, qui dans un manuscrit de 1793-1794 cité par l’épistémologue Gilles-Gaston Granger, « rêve d’une langue universelle qui est en réalité une ébauche de logique mathématique, une « langue des calculs » qui identifierait et distinguerait les processus intellectuels, en exprimant des objets réels dont on énonce les rapports, rapports entre objets et opérations réalisées par l’intellect dans la découverte et l’énonciation des rapports. » [7]. Mais le manuscrit s’interrompt avant d’identifier les idées premières et indique que « l’héritage des langues parfaites est en train de se transférer définitivement sur le calcul logico-mathématique, où personne ne songera plus à tracer une liste des contenus idéaux, mais seulement à prescrire des règles syntaxiques. » [8]. Le calcul logico-mathématique et sa visée formaliste nous amène beaucoup plus près du contexte épistémique dans lequel évolue Valéry, marqué par Hilbert dont les travaux fondateurs en mathématiques imprègnent le climat de l’époque et favorisent « l’assurance avec laquelle Valéry se lance dans l’élaboration d’une mathématique de l’esprit. » [9]. Nous étudierons donc ici les convergences entre le premier formalisme de Valéry et celui d’Hilbert, avant d’évaluer si les machines de Turing, qui dérivent du formalisme hilbertien, ne fourniraient pas une comparaison adéquate et chronologiquement plus proche de la machine autopoïétique telle que Valéry peut en nourrir le dessein.
De l’Analysis situs au formalisme axiomatique d’Hilbert
Selon Hourya Sinaceur, spécialiste de la philosophie des mathématiques, l’ancêtre du formalisme, dans bien des aspects, est Leibniz : « il est remarquable que Leibniz ait simultanément mis en valeur l’analyse qualitative des situations géométriques (par son essai d’Analysis situs) et l’analyse symbolique des formes d’expression (dans son insistance répétée sur la nécessité de langues formelles ou « caractéristiques »). » [10]. Comme nous allons le voir, l’analysis situs, ou topologie, est justement sollicitée par Valéry pour mener à bien son projet de topographie mentale : « L’être pensant est un ensemble de systèmes dépendants en acte, indépendants en puissance. Et il y a comme des degrés d’engrenage. […] Le tout dépend de la partie . » [11]. La question est donc de trouver le meilleur moyen de représenter ces « degrés d’engrenage » et c’est ici que le recours à l’analysis situs s’avère opératoire : « La valeur de la topologie pour l’analyse de l’esprit réside dans le fait qu’elle permet d’étudier, en faisant abstraction de toute notion de quantité et de mesure, les rapports de contact et de continuité entre les points et les espaces qui les contiennent. » [12] L’analysis situs est rattachée à la fois à la géométrie non-euclidienne et à la théorie des ensembles qui dégage le primat de l’unité de l’ensemble et, à l’intérieur de celui-ci, celui de la relation, conception qui, comme Judith Robinson le met en évidence, « était parfaitement adaptée à l’idée que Valéry se faisait de l’esprit comme un assemblage d’éléments qu’il faut étudier non pas en eux-mêmes mais dans leurs relations toujours mobiles et fluctuantes avec la structure de l’ « ensemble » mental et de ses innombrables « sous-ensembles ». » [13]. Cantor, dont Valéry lut et discuta longuement avec son ami Féline l’ouvrage Sur les fondements de la théorie des ensembles transfinis [14], développe, dans les années 1870 et 1880, une théorie des ensembles qui fait de l’infini actuel [15] un objet explicite de raisonnements mathématiques. Or, ainsi que le rappelle Pierre Cassou-Noguès, « l’infini actuel suscite une controverse sur les fondements des mathématiques » [16] et c’est dans cette question des fondements des mathématiques que s’inscrivent les travaux de Hilbert, dont l’ouvrage, Les Fondements de la géométrie, « passent pour représenter l’acte de naissance officiel du formalisme axiomatique. » [17]. On pourrait, selon Pierre Cassou-Noguès, présenter l’œuvre d’Hilbert comme une série de problèmes résolus dans différents domaines, le titre de chaque étape étant celui d’un problème. Ce qui pose la question de l’unité de son œuvre. Même si l’activité de Hilbert s’est, contrairement à celle de Léonard de Vinci, limitée à une discipline, elle est présentée par Pierre Cassou-Noguès de la même manière que Valéry présente l’artiste et savant italien dans L’introduction à la méthode de Léonard de Vinci : « Le cheminement de Hilbert n’est pas linéaire. Et l’unité vient plutôt de la méthode. » [18]. Dans sa méthode, la rigueur tient une place essentielle et comparable à celle que tiennent les « gênes exquises » dans la méthode poétique de Valéry. De même que, pour Valéry, la rigueur des « gênes exquises » n’est pas l’ennemie de l’inspiration, la rigueur pour Hilbert n’est pas l’opposée de la simplicité : « la recherche de la rigueur conduit toujours à découvrir des raisonnements plus simples [et] ouvre aussi la voie à des méthodes plus fécondes que les anciennes. » [19]. Lorsque Hilbert explicite les traits que ses travaux mettront à l’honneur, il fait figurer, avec la rigueur, la simplicité et la généralité, qui sont issues d’un même effort d’approfondissement, celui qu’ouvre la méthode abstraite :
« La méthode abstraite, qui émerge en algèbre, décrit les champs mathématiques, non par la nature de leurs objets, mais par leur structure. […] En laissant indéterminée la nature des objets, la méthode abstraite libère les démonstrations des considérations contingentes liées à un champ d’objets particuliers et laisse apparaître le raisonnement dans ses articulations essentielles. » [20] Cette méthode satisfait à la préoccupation valéryenne de faire primer la relation sur la notion. De même que, chez Descartes, savoir, c’est savoir comment on a pu savoir, l’efficacité méthodique que recherche Hilbert cultive la transparence du raisonnement à lui-même : l’indétermination dans laquelle est laissé l’objet facilite la fluidité du raisonnement tel que l’esprit peut se le représenter. Ce qu’il perd en précision sur l’objet, il le gagne en précision sur l’ensemble, dans une économie de type visuel, mettant en évidence la dimension fondamentalement spéculaire de la méthode. La démarche de Hilbert est ainsi comparable à la poétique valéryenne, telle que l’analyse Michel Jarrety :
S’il [Valéry] reproche en effet au langage ordinaire de privilégier la désignation séparée des mots aux dépens de leurs relations, le travail du poème consistera précisément à modifier – parfois jusqu’à la destruction – le sens reçu, qu’il s’agit vraiment d’écarter, en choisissant les termes les plus propres à susciter, par leur association, la substitution qui s’opère par exemple dans le vers de Marceline Desbordes-Valmore, ou qui se rêve par l’ignorance de la réalité dénotée par un mot. [21]
La poétique valéryenne, comme la méthode de Hilbert, font donc subir à la notion une opération de subduction, diminuant son sens pour favoriser sa capacité de mise en relation, de mise en syntaxe et même, dans le cas de Valéry, de substitution. L’appauvrissement du sens singulier des notions que pratique Hilbert ne conduit cependant pas, du moins dans un premier temps, à une perte généralisée et programmée du sens de l’ensemble, substituant, à une sémantique, une mécanique pure : « La méthode abstraite, de l’algèbre puis de l’axiomatique et du formalisme, n’est pas un mécanisme aveugle mais le moyen d’un approfondissement. En ce sens, dira Hilbert, c’est « l’esprit sous-jacent et non pas la contrainte des formules qui produit le résultat attendu. » [22] » [23]. L’approfondissement que réalise la méthode abstraite la mettrait peut-être en contact avec le « sous-sol méthodique » du monde décrit par Bruno Clément dans Le récit de la méthode : « le monde est méthodique, et […] le sous-tendent un certain nombre de principes, de lois, de structures qu’il s’agit seulement de mettre au jour, dans l’abstraction hypothétique d’un sujet quelconque. » [24]. La perte du sens particulier des notions et leur mise en syntaxe les prédisposeraient à entrer en contact avec cette immanence du monde, cet « esprit sous-jacent », qui fonderait alors une forme de « mystique méthodique ». C’est au début de l’année 1898 que Hilbert, qui abandonne ses recherches en algèbre, annonce un cours sur la géométrie euclidienne, qui sera publié sous le titre Fondements de la géométrie, mettant en place la méthode axiomatique des mathématiques modernes. Pierre Cassou-Noguès la présente en ces termes : « Le but d’une axiomatisation, comme celle que Hilbert conduit sur la géométrie euclidienne, est d’isoler des propositions premières, des axiomes, dont les théorèmes suivent par déduction logique. » [25]. À l’instar de la méthode cartésienne, l’on constate ici que c’est l’a priorisme, la méthode déductive qui conduit les raisonnements. C’est précisément cette méthode qui conduit à une réduction du contenu sémantique des objets : « La déduction logique fait abstraction du sens des termes ou du contenu des notions. Or l’axiomatisation ramenant les démonstrations à des déductions logiques partant d’axiomes fixés, nous pouvons dire qu’elle permet de faire abstraction du contenu des notions ou de la nature des objets de la théorie. » [26]. Ce passage à l’abstraction conduit cependant moins à une annulation du sens qu’à sa reconfiguration :
En même temps, puisque tout ce qui sert pour le travail mathématique à l’intérieur d’une théorie axiomatisée est concentré dans l’énoncé des axiomes, nous pouvons dire que les axiomes constituent une définition déguisée des notions. Le mathématicien fait abstraction du contenu usuel des notions, de la nature supposée des objets pour ne considérer que les axiomes, qui suffisent à son travail et suffisent à déterminer les notions de sa théorie. [27]
Ainsi, on serait tenté d’avancer que la déduction logique pratique une réduction fonctionnelle des objets : prélevant de la notion ce qui suffit à son raisonnement, elle remplace l’identité par la fonctionnalité. Ce parti-pris, méthodologique et ontologique, est aussi celui que Valéry dira vouloir appliquer à son Système en 1913, année où il entame véritablement la rédaction de La Jeune Parque :
« Ma « foi » a été dans un système, système de pensée, fondé sur l’équivalence de toutes choses ou de toutes catégories de choses. Et cette équivalence s’oppose à l’identité. J’examine les propriétés des choses diverses au point de vue de leur substitution, dans une structure qui est la connaissance. » [28].
On pourrait probablement voir en Frege le précurseur de ce type de méthode si l’on en croit Ernst Cassirer : « Le rapport qui s’énonce dans l’équation est le seul élément admis ; tandis que les éléments qui interviennent dans ce type de rapport sont encore indéterminés quant à leur signification et ne deviennent peu à peu déterminables que grâce à l’équation. » [29]. Reprenant le projet de Leibniz, Frege construit une langue symbolique, formée de signes précis, interdisant toute équivoque. La recherche de la langue parfaite n’est pas de nature à satisfaire Valéry, car elle signifierait pour lui rien moins que la fin de la pensée. Comme l’analyse Michel Jarrety, citant Valéry : « « si le langage était parfait, l’homme cesserait de penser » [30], parce que la pensée s’appuie sur une parole intérieure où l’individualité de chacun se marque dans le jeu que les pièces du langage, insuffisamment ajustées entre elles et à leurs sens, maintiennent en dépit de tout. » [31]. Mais Michel Jarrety met en évidence la structure des pièces du langage, où l’individualité est subsumée par le « jeu » de l’ensemble, ce qui nous amène au deuxième projet de Frege, conduisant à l’axiomatisation. Il faut donc croire que ces deux projets, celui de la langue parfaite et celui de formalisme, entretiennent une solidarité secrète, pour se croiser à plusieurs reprises dans l’histoire de la pensée pure. Frege analyse ainsi la proposition non plus en termes de sujet et de prédicat, mais de fonctions logiques. Il initie ce changement de paradigme consistant à remplacer la prédication par l’équation. Jacqueline Russ retrace le parcours et les conséquences de cette substitution :
Alors que la logique classique est fondée sur la structure « S est P », Frege s’intéresse à ce que Russell [32] appellera la fonction propositionnelle, c’est-à-dire la formule contenant une ou plusieurs variables. Les travaux de Frege aboutissent ainsi à la première présentation de la logique sous une forme axiomatisée et purifiée (du sensible et de l’empirique), forme permettant de déduire les principes arithmétiques et, d’une manière plus générale, mathématiques [33].
L’entreprise de Frege peut apparaître comme le sommet du rôle attribué à la déduction dans les mathématiques. C’est cette dimension programmatique qui motive la fonctionnalisation des entités : « Notre intention est de constituer le contenu d’un jugement qui se puisse concevoir comme une équation telle que de chaque côté de cette équation est un nombre. Nous allons ainsi…passer du concept déjà acquis d’égalité à ce qui doit être considéré comme égal. » [34]. La tendance méthodologique qui s’exprime ici sous-tend, d’après Ernst Cassirer, « toute la conceptualisation mathématique » : « « la figure » va devoir la totalité de son existence aux relations qu’elle remplit. » [35]. Cette fonctionnalisation a pour corollaire la dimension finie du Système, selon Valéry : « Toute ma « philosophie » est dominée par l’observation du caractère fini – par raison fonctionnelle – de toute « connaissance. ». Ce caractère est réel – tandis que tout non fini est fiduciaire. » [36]. La fiducia désigne la foi naïve dans le commerce des choses, « monnaie mentale ayant cours sans encaisse ni garantie » pour reprendre l’expression de Paul Gifford, qui la met en parallèle avec la bêtise du croire que fustige Valéry : « « croire », dans ce même langage, c’est accepter de donner cours à une telle monnaie sans exiger une conversion possible en or. » [37]. La problématique de la fiducia a partie liée avec celle du signe, au sein d’une métaphore monétaire à laquelle Michel Jarrety a été sensible : « si l’usage ordinaire du langage est de confondre le signe et sa valeur comme le mot et la chose, tout esprit fort doit marquer sa distance avec la monnaie qui a cours » [38]. Il cite alors l’emploi métaphorique de la monnaie chez Valéry : « Le puissant esprit pareil à la puissance politique, bat sa propre monnaie, et ne tolère dans son secret empire que des pièces qui portent son signe. » [39]. Or Valéry voit précisément dans les mathématiques l’empire qui frappe sa propre monnaie, à la mesure de son esprit, le signe étant en relation de quiddité avec sa dénotation ; c’est là que réside sa dimension abstraite, dimension nécessaire à la constitution de son formalisme. On voit donc se dégager chez Valéry une triade : abstraction–fini–formel dont la solidarité est organique. Ce concept d’organisme s’impose ici pour justifier le reproche que Valéry adresse aux physiologistes. Aux physiologistes, il reproche alors de s’occuper beaucoup trop « des éléments individuels dont se composent le corps et le système nerveux, et d’accorder relativement peu d’attention aux rapports réciproques entre ces éléments et à leur rôle dans ce qu’il appelle le « fonctionnement d’ensemble de l’esprit humain » [40] » [41].
Lier formalisme et méthode abstraite implique bien une pensée du signe, chez Valéry comme chez Hilbert. Expliciter les règles de la déduction, qui restaient implicites dans Les fondements de la géométrie, va conduire Hilbert à radicaliser le caractère abstrait du signe : si la formalisation « énonce les axiomes, les prémisses, et les règles de la déduction […] les démonstrations peuvent, en toute rigueur, faire abstraction du sens des termes ou du contenu des notions. Elles sont purement formelles. » [42]. L’abstraction du signe conduit à restreindre son statut, qui devient celui d’un outil de manipulation. La méthode abstraite semble alors se réduire à une mécanique [43] pure, s’il s’agit de « formaliser les théories mathématiques et de les remplacer par des enchaînements de formules, vides de sens, mais conformes à des règles convenues. » [44]. Ainsi Hilbert, passant de l’arithmétique à contenu à l’algèbre formelle et au calcul logique définit-il le fonctionnement de ce mécanisme : « Le résultat est que nous obtenons finalement, à la place de la science mathématique à contenu, science dont l’instrument de communication est la langue usuelle, un stock de formules constituées de signes mathématiques et logiques enchaînés à la suite les uns des autres selon des règles définies. » [45]. Cette manipulation programmée du signe, accomplie au sein d’un ensemble fini tel que Hilbert le conçoit, nous paraît donc assez proche de la combinatoire visée par Valéry. La position de Hilbert, radicalisant la méthode abstraite dans l’élaboration de son axiomatique peut se retrouver dans sa philosophie du signe. Si Hilbert et Brouwer [46], qui proposera une autre doctrine du fondement des mathématiques, reconnaissent tous deux une dualité entre une pensée intérieure – dans l’esprit du mathématicien – et une expression extérieure – sur le papier -, Brouwer ne considère pas l’expression mais seulement la pensée intérieure alors que Hilbert « maintient que la pensée se reflète dans son expression, dans l’enchaînement des formules, de sorte que la métamathématique, qui prend pour objet l’enchaînement des formules, réalise une analyse et, finalement, une fondation de la pensée mathématique. » [47]. La portée de la métamathématique, ou théorie des démonstrations dépend du « reflet », de la relation spéculaire, de l’isomorphisme postulé entre la pensée et son expression. Dans sa conférence au congrès des mathématiciens de 1900, « Sur les problèmes futurs des mathématiques », Hilbert prête une fécondité aux signes, « un effet suggestif, qui, conscient ou non, guide le mathématicien » [48]. L’accent que met Hilbert sur le pouvoir heuristique des signes a un intérêt double : c’est d’abord la suggestion provoquée par les signes algébriques qu’il souligne particulièrement, non celle des figures géométriques dont l’importance est établie, voire convenue. Ensuite, cet « effet suggestif » est relevé par Hilbert au sein d’un processus graphique, évoquant une dynamique d’écriture alimentée par les signes algébriques : « Le mathématicien écrit une formule. Celle-ci demande à être transformée comme une phrase inachevée demande à être complétée. La formule, écrite sur un papier, manifeste des voies que le mathématicien tente de poursuivre. » [49]. Hilbert, sans revendiquer sa place dans ce paradigme, formule une poétique mathématique. Celle-ci doit être rapprochée de la genèse de l’écriture valéryenne telle que Robert Pickering l’a traitée dans son étude sur l’espace de la page et la naissance de l’écriture chez Valéry : « la répercussion d’une conception « motivée » du langage sur l’écriture, entendue dans un sens actif plus large d’initiation et de reflet, mimique des démarches intellectuelles » [50] resterait selon lui à examiner en profondeur chez l’auteur alors que l’œuvre appelle « l’analyse des rapports premiers entre le langage et le réel qui informent la genèse de l’écriture. » [51]. L’étude des régimes scripturaires que conduit Robert Pickering envisage la réalité matérielle du support, de la « feuille » qu’évoque Hilbert, dans son interface avec l’écriture émergente où « la résonance de motivation cratylique comporte un aspect d’ébauche active, de mise en jeu qui brasse les assises du graphisme expressif. » [52]. Il cite ainsi Valéry : « Le son d’un mot fait penser la chose comme le geste du doigt fait voir l’objet » [53]. À côté du cratylisme sonore, qui est distinct de ce que nous voulons observer, c’est cette gestuelle de l’écriture qui nous apparaît frappante et que relaie la phrase suivante : « Les mots forment un système de gestes très nombreux, très divers. ». Le système de pensées aurait chez Valéry pour reflet un système gestuel, chorégraphique même, compte-tenu de sa diversité, mais la relation d’un système à l’autre ne serait pas de la simple réflexion, mais de l’interface dynamique. Les reflets seraient comme des jets de lumière qui se répondraient et se relanceraient ad libitum. Cette portée interactive de la poétique valéryenne restreint la possibilité de la comparer à une combinatoire, dont la mise en œuvre s’effectuerait passivement, et unilatéralement, au risque d’en figer l’intérêt dans une programmatique qui manquerait précisément les richesses de la relance entretenue de la pensée à son support matériel et graphique. Malgré les limites d’une comparaison entre la visée du Système valéryen et le fonctionnement d’une combinatoire, nous allons tout de même proposer un parallèle entre celui-ci et les machines de Turing, pour substituer à l’Ars magna de Lulle un modèle peut-être plus adéquat pour saisir le projet de Valéry mais aussi pour faire entrer sa pensée en résonance avec un champ épistémique plus proche de lui.
Les machines de Turing et le rêve du fini chez Valéry
L’élaboration des machines de Turing fut fortement tributaire du formalisme de Hilbert et s’enracine dans cette pensée du fini. Comme l’écrit Pierre Cassou-Noguès, les machines de Turing répondent à un problème précis : « Qu’est-ce que suivre des règles, des règles qui déterminent nos actions sans ambiguïté et aboutissent réellement à un résultat, réellement, c’est-à-dire en un nombre fini d’étapes ? […] Il s’agit donc de définir la pensée humaine en tant qu’elle est réglée, ou la pensée réglée et finie (puisque le raisonnement humain, s’il doit pouvoir aboutir, semble devoir rester dans le fini : ne mettre en œuvre qu’un nombre fini d’étapes). » [54] Cette idée, ou cet impératif du fini, est au cœur du projet valéryen animant son premier formalisme qui, comme chez Turing, doit pouvoir s’énoncer en un nombre fini d’opérations : « Ma spécialité – Ramener tout à l’étude d’un système fermé sur lui-même et fini. » [55]. Ainsi que l’analyse Nicole Celeyrette-Pietri, « cette « forme du fini, non apparente en général » a donné l’espoir de se rendre maître de l’univers mental par le dénombrement complet de ses opérations. Quelques algorithmes devraient dominer tout le mental comme on parvient à ordonner les décimales de Pi. » [56]. La conception du système replié sur lui-même, et fini, désigne en premier lieu, et désignera probablement jusqu’au bout, comme « sol de nos pensées […] cet ensemble métrique corporel d’actes. » [57]. L’investigation menée par Valéry sur le pouvoir de « l’esprit incarné » va le mener à créer un langage « ne comportant plus que des signes univoques, des termes entièrement convertibles en non-langage – en actes imitables et/ou en sensations – dont les lois de composition, la syntaxe reposent sur le fonctionnement constant de l’Homo. » [58]. Le « Que peut un homme ? » de M. Teste doit se résoudre en « Système fermé, représentatif absolu » [59], faisant écho à la tentative de définition de la pensée humaine de Turing, projets dont le fondement commun est le principe du fini qui, chez Valéry est « posé dès le début » [60]. Le « Que peut un homme ? » lié au « Comment cela marche-t-il ? » donnent lieu à une collusion : « la projection sur les axes de coordonnées de l’agir/sentir et l’animal-machine, modèle de fonctionnement objectif [qui] tentent de collaborer. » [61]. Sonder le potentiel de l’homme pensant revient à le calculer et alors, écrit Valéry, « l’idée-modèle de machine s’impose, et elle n’a pour limite que notre pouvoir de machines » [62]. Etudier l’homme implique de « démonter et remonter des mécanismes dont les pièces et les types sont en nombre fini. » [63]. Le fonctionnement de la machine de Turing, qu’il convient d’exposer dans le détail, correspondrait au dessein valéryen. Nous suivrons ici les explications de Pierre Cassou-Noguès, dans un développement que nous ne reproduirons pas dans son intégralité mais qu’il est difficile de tronquer ou de commenter avant qu’il ne définisse clairement le fonctionnement de la machine de Turing : « Qu’est-ce qu’une machine de Turing ? D’abord, la machine est posée devant un ruban de papier, qui est divisé en cases. Celles-ci ou bien sont vides ou bien portent des symboles (un seul symbole par case) appartenant à une liste finie. La machine peut se déplacer sur le ruban. Elle peut « lire » le symbole sur la case devant laquelle elle se trouve. C’est-à-dire, elle dispose d’une sorte de caméra, de scanner […] braqué sur la case, et ses actions dépendent du symbole qui figure sur cette case (ou du fait qu’il ne s’y trouve pas de symbole. […] Elle est construite avec un programme qui détermine ses actions en fonction du symbole imprimé sur la case devant laquelle la machine est stationnée et de l’état devant lequel se trouve la machine à cet instant. […] Une machine de Turing est un dispositif susceptible d’un nombre fini d’états internes, et dont les actions (se déplacer sur le ruban, imprimer un symbole, changer d’état) sont déterminées par une liste d’instructions […] On suppose également que les symboles que la machine peut imprimer (et reconnaître sur le ruban) appartiennent à un alphabet fini. » [64] Même si la définition des machines de Turing ne dit rien de la nature du dispositif décrit, et seulement qu’il est susceptible d’un nombre fini d’états internes, ceux-ci peuvent être aussi bien matériels que mentaux : « On peut, en effet, considérer que l’esprit humain, si on lui attribue des états internes en nombre fini et qu’il suit un programme, une liste d’instructions, est une machine de Turing. Il en vérifie la définition. » [65]. L’infinité de l’esprit, tel que Valéry se le représente, pourrait se limiter au programme d’une machine de Turing : « Il y a une infinité d’états de connaissance possible, mais ils se résolvent en un nombre restreint de changements et de variations. » [66] Aussi bien pour ce qui concerne le calcul (« tout calcul que nous pouvons réaliser en suivant des règles définies est également susceptible d’être implémenté sur une machine. C’est la thèse de Turing ») [67] que pour les démonstrations formelles, on suppose qu’une machine de Turing est capable de mener à bien ces opérations. Pour chacun des systèmes formels imaginés par les mathématiciens, il est possible de concevoir une machine de Turing « qui écrit, les uns à la suite des autres, toutes les formules prouvables, tous les théorèmes du système. » [68]. L’analogie dégagée entre machine de Turing et système formel, tel que les mathématiciens le conçoivent ou, d’une certaine façon, telle que Valéry rêve de l’élaborer, peut aller jusqu’à l’identification comme le suggère Pierre Cassou-Noguès, ce qui revient à « poser qu’un système formel n’est qu’une liste d’instructions pour une machine de Turing, ou une certaine machine qui déduit les formules que l’on considère comme des théorèmes. » [69]. Pour justifier cette identification, Pierre Cassou-Noguès cite opportunément Gödel, dont la définition du système formel pourrait indifféremment s’appliquer à une machine de Turing : « Un système formel peut simplement être défini comme une procédure mécanique pour produire des formules que l’on peut appeler formules prouvables. [Cela] est requis par le concept de système formel dont l’essence est que le raisonnement y est complètement remplacé par des opérations mécaniques sur les formules. » [70] La mécanique de l’esprit dont Valéry rêve de pouvoir décomposer tous les rouages aurait pour horizon, une fois la définition du Système parfaitement achevée, une fois que tous les éléments du programme auraient été précisés, de fonctionner à la manière d’une machine de Turing. Ses machines ont le mérite de donner « la véritable définition du formalisme » [71]. On voit alors se dégager une triade formel-fini-fonction : formel (la machine de Turing définit le formalisme) – fini (la machine de Turing est susceptible d’un nombre fini d’états internes) – abstraction (la machine de Turing se réduit aux opérations mécaniques sur des formules abstraites), comparable à celle que nous relevions précédemment chez Valéry [72]. Kurt Gödel, logicien dont les résultats tirent les conséquences du programme formaliste de Hilbert, « est convaincu que le cerveau humain est une machine de Turing. » [73]. On peut faire assoner cette définition avec celle du Système valéryen du premier formalisme énoncé par Nicole Celeyrette-Pietri : « Le Système dont la construction fut méthode, aurait épuisé et exactement nommé « les rapports possibles de quelqu’un et de ce qui est » [74] : ni Traité ni Somme, mais fonctionnement réglé [75] d’un cerveau ou d’un Moi réduit à l’intellect, et pensant toutes choses en termes de modèles corporels exprimés par des définitions qui veulent être des équations fonctionnelles. » [76]. Le « modèle corporel » appelle, pour parvenir à raisonner en termes de réglages, un dressage préalable : le Système valéryen, c’est ainsi « un bel organisme, un Gladiator exercé jusqu’à la perfection de son instinct et de sa musculature, et substitué par son animal-machine. » [77]. On serait tenté d’avancer que le « modèle corporel » joue ici le rôle de figure par rapport au « fonctionnement réglé » du cerveau, figure dont Michel Jarrety a montré qu’elle lie Valéry à Descartes : Valéry reconnaît à Descartes un droit à la figure car celle-ci « relève d’une exigence jumelle dans la géométrie et la philosophie : le souci du sensible, qui lui fait admirer chez Descartes l’inventeur de la géométrie analytique qui maintient la puissance perceptive du Sujet que le Cogito pour sa part établit. » [78]. Le pouvoir de Descartes, et ses limites, est inféodé à sa capacité à figurer : « Descartes. Inventeur d’images et de la précision de l’image – maître de l’usage des représentations figurées – et défectueux dès qu’elles sont en défaut » [79]. Ainsi, la fonction d’une figure comme celle du « modèle corporel » n’est pas « ornementale : elle est opératoire, et sert à illustrer, si l’on consent à prendre le verbe au plus près de son étymologie ; ici encore, l’abstraction ne doit demeurer qu’un passage, et la figure vient briser la circularité toujours menaçante de la réflexion : elle conjoint le sensible et l’intelligible. » [80]. La nécessité, l’urgence de recourir à la figure est le signe d’une menace, celui de la circularité décrite par Michel Jarrety, aussi inhérente à la réflexion qu’elle est consubstantielle à tout système formel. Gödel exempte de ce péril l’esprit humain car, selon l’antimatérialisme qui est le sien, il ne se confond pas avec le cerveau : « Ainsi, si l’esprit humain surpasse toute machine de Turing, son fonctionnement est irréductible au mécanisme du cerveau et révèle une autre réalité, une sorte d’âme, elle-même irréductible au monde sensible. » [81] ? Si le « réel de la pensée » est l’unique domaine d’une connaissance « qui ne se paie pas de mots vides », car ces mots sont des formules et qu’elle s’exprime en termes de fonctionnement du corps, donc que sa quantité est « référée » [82], le risque qu’encourt une représentation formaliste est de deux ordres. D’une part, la mécanique manque, comme nous l’avons vu, la dynamique interne que permet le croisement de deux régimes d’écriture et de pensée, entre la dianoia, pensée cérébrale et le graphein, dont nous avons évalué précédemment l’interaction féconde. D’autre part, la mécanique, purement interne tout comme l’analytique [83], risque de s’épuiser comme les machines thermiques en apportent la preuve. La dynamique de la dianoia au graphein échappe par définition à cette mécanique interne de la combinatoire en cycle fermé sinon elle épuiserait vite ses possibilités de relance. On serait tenté de constater ici une limitation de la logique imaginative valéryenne, avant qu’elle ne devienne la théorie des harmoniques [84] : « Dire qu’il y a une logique imaginative, c’est-à-dire que certaines choses étant données ou produites en esprit, d’autres s’ensuivent nécessairement, c’est-à-dire qu’il y a une généralité c’est-à-dire une fixation imaginative. » [85].
De la mathématique pure à la thermodynamique : vers un modèle valéryen de combinatoire
C’est la volonté d’échapper à ce risque de figement, de fixation, qui motive chez Valéry le changement de paradigme, son orientation vers la thermodynamique dont les « images », comme celle que nous proposions avec la machine de Turing, ont, entre autres, le mérite d’être modernes, et de ne pas tirer à elles des cortèges de significations associées, d’implicites, qui en font des outils aussi peu manipulables que le langage commun [86] : « Sur ces notions de « travail », d’ « énergie », etc., que j’emploie sans définitions métriques – je dis que ce sont des images – que j’ai préféré emprunter à la physique moderne (il y a 45 ans) au lieu de me servir des traditionnelles de la philosophie qui sont dérivées de mythologies très anciennes. « Pensée, idée, esprit, âme, intelligence » tout ceci s’entend assez bien quand on ne les met pas sur la table. Mais ce n’est pas fait sur mesure… » [87]. L’emploi du terme « mythologies » entre en contradiction avec la prétention scientifique du Système, quand le refus de recourir à des « définitions métriques » indique le renoncement au paradigme mathématique. Comme le signale Nicole Celeyrette-Pietri, « la recherche des Cahiers ne se fonda qu’un temps bref sur la mathématique pure. Dès 1900 l’infléchissement de la pensée par les concepts physiques se marque dans l’intérêt porté à la thermodynamique. » [88]. Cela s’explique également par la prédilection spontanée qu’une nature comme celle de Valéry, portée à la poésie, pouvait avoir pour une notion comme celle d’énergie [89] mais aussi par l’analyse fine et détaillée que permettaient les mathématiques appliquées : « L’avantage de la théorie de l’énergie est de faire penser à toutes les conditions, circonstances d’un phénomène et de corriger a priori une partie des inconvénients de l’abstraction » [90]. Les mathématiques appliquées offrent l’avantage de prendre en compte un milieu, dont la mathématique pure considère l’action comme nulle. Le fonctionnement du Système valéryen s’éloigne alors du modèle de la machine de Turing, dont Pierre Cassou-Noguès a montré qu’on pouvait la comparer à une horloge [91], congédiant à la fois les paradigme mathématique et mécanique, la mathématique étant trop abstraite, les « analogies mécaniques […] [n’offrant] que des structures très générales » [92]. Le formel pur avoue, tout du moins aux yeux de Valéry, son insuffisance. Nicole Celeyrette-Pietri révèle significativement que, si Valéry connaît Hilbert et le cite, « il n’a pu y trouver les éléments de logique nécessaires à son projet » [93], sans doute, serait-on tenté d’ajouter, parce que celui-ci déborde le cadre de la logique, qui ne pense pas et ne pose pas ses signes en termes d’incarnation. Le milieu ne peut se réduire à une variable de plus de l’équation algébrique. Le fonctionnement du Système s’assimile, dès lors, plus volontiers à un protocole physico-chimique, bien plus apte à saisir « « le modèle vivant – le Seul ! qui est en somme Moi » [94] d’après lequel a voulu se redessiner la philosophie valéryenne, ne peut se réduire à un faire qui serait celui, tout abstrait, du seul formel de la pensée. » [95]. S’intéresser à la thermodynamique n’implique pas, pour Valéry, de renoncer à la fermeture du Système, mais de renoncer à sa formalisation. La dimension finie du Système, dans le vocabulaire de la thermodynamique, s’exprime, comme Judith Robinson le met en évidence, dans les termes de « cycles fermés » : « Il y a un aspect particulier de la thermodynamique qui semble à Valéry convenir parfaitement à l’analyse des processus mentaux : c’est l’idée de « cycles fermés ». On parle, par exemple, du cycle fermé accompli par un système thermodynamique qui passe successivement de la « phase » solide aux phases liquide et gazeuse, pour revenir enfin à la phase solide. Mais, ainsi que Valéry le fait observer, ce même mouvement d’écart et de retour caractérise tout aussi bien l’activité de notre corps, et celle de notre cerveau : « Il faut remarquer dans les êtres vivants, écrit-il, [que] la condition de retour, de cycle fermé est la règle et que toute la notion de fonctionnement l’implique. » [96]. À la triade formel–fini–abstraction se substituerait alors la triade cycle–fini-fonction, le « fini » devant s’entendre comme le milieu, lieu de l’expérience dans son acception double d’expérimentation, et de fait d’éprouver quelque chose, considéré comme un enrichissement de la connaissance. C’est en ce sens que la méthode poétique, conçue simultanément comme réflexion et production des formes, sera appréhendée en tant qu’expérimentation spirituelle : l’esprit, passant par les stades de la pensée (dianoia), de la parole (pneuma) et de l’écriture (graphein) – de même que l’énergie passe par les phases solide, liquide, gazeuse [97] – éprouvant à chaque étape sa quantité référée sur le modèle corporel afin de ne pas exclure son milieu des conditions de l’observation.
En guise de conclusion : la machine thermodynamique de Narcisse
L’une des simplifications adoptées par Valéry pour prendre la thermodynamique comme image de son Système est de « considérer un système isolé, c’est-à-dire sans échange d’énergie avec l’extérieur. » [98]. La « théorie des interventions », qui aurait pu rendre compte de tels apports ne s’est pas encore dotée des instruments permettant de la faire intervenir, elle est donc, d’un point de vue pragmatique « inexistante » [99] et n’autorise pas de transposition. Le mythe de Narcisse, dans son traitement valéryen, lui permettra ainsi d’expérimenter poétiquement le fonctionnement d’un système isolé en circuit fermé.
Thomas VERCRUYSSE : « Le paradigme de la combinatoire chez Valéry, Hilbert et Turing »
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE vol. 6 – (Hiver 2010)
[1] Daniel Oster, Monsieur Valéry, Seuil, 1981. Quand le lieu d’édition n’est pas précisé, il s’agit de Paris.
[2] Nous tenons à remercier Pierre Cassou-Noguès, sur les travaux duquel cette contribution s’appuie largement, d’avoir bien voulu relire une première version de cet article et d’avoir suggéré des modifications.
[3] Paul Valéry, Œuvres, I, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, p. 801. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, Valéry et le moi, Klincsieck, 1979, p. 93.
[4] Voir Paul Valéry, Cahiers publiés en fac-similé par le CNRS en 29 volumes, 1957-1961. in Cahiers IV, p. 646.
[5] Paul Valéry, Cahiers, IX, p. 88. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op.cit.
[6] Nicole Celeyrette-Pietri, ibid.
[7] Gilles-Gaston Granger, « Langue universelle et formalisation des sciences. Un fragment inédit de Condorcet », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, VII, 3, p. 197-219. Cité par Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite dans la culture, Points-Seuil, 1994, p. 321.
[8] Umberto Eco, op. cit., p. 321.
[9] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 9.
[10] Hourya Sinaceur, « Différents aspects du formalisme », in F. Nef et D. Vernant (dirs.), Le formalisme en question, Vrin, 1998, p. 129.
[11] Paul Valéry, Cahiers III, p. 750.
[12] Judith Robinson, L’analyse de l’esprit dans les Cahiers de Valéry, Corti, 1962, p. 70.
[13] Ibid., p. 69-70.
[14] Ibid., p.69n.
[15] « Si on veut caractériser brièvement la nouvelle conception de l’infini à laquelle Cantor a ouvert la voie, on dira ceci : dans l’Analyse nous n’avons à faire qu’à l’infiniment petit et à l’infiniment grand comme concept limite, comme entité en devenir, en train de naître ou de se produire, i.e. en d’autres termes à de l’infini potentiel. Mais le véritable infini en personne n’est pas là. L’infini véritable, nous le rencontrons au contraire lorsque par exemple nous considérons la collection des nombres 1,2,3,4,… elle-même comme une unité achevée, ou bien encore lorsque nous traitons les points d’un segment de droite comme une collection qui se présente à nous à l’état de totalité achevée. On appelle infini actuel cette sorte d’infini. », David Hilbert, « Sur l’infini », traduction de « Ueber das Unendliche », 1925, traduit, annoté et présenté par Jean Largeault, in Logique mathématique – textes, Armand Colin, 1972, p. 225.
[16] Pierre Cassou-Noguès, Hilbert, Les Belles-Lettres, 2004, p. 23.
[17] Hourya Sinaceur, op. cit., p. 134.
[18] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 36.
[19] David Hilbert, Sur les problèmes futurs des mathématiques, trad. fr. L. Laugel, Sceaux, J. Gabay, 1990, p. 6 (1ère édition allemande 1900). Cité par Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 37.
[20] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 37-38.
[21] Michel Jarrety, Michel Jarrety, Valéry devant la littérature- Mesure de la limite, PUF, 1991, p. 122.
[22] Lettre de Hilbert à Minkowski, citée par Pierre Cassou-Noguès.
[23] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 38.
[24] Bruno Clément, Le récit de la méthode, Seuil, 2005, p.10-11.
[25] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 43.
[26] Ibid.
[27] Ibid.
[28] Paul Valéry, Cahiers, V, p. 117.
[29] Ernst Cassirer, « Référence et fonction », in Substance et fonction, Minuit, 1977, [1910], p. 61.
[30] Paul Valéry, Cahiers, V, p. 394. Cité par Michel Jarrety.
[31] Michel Jarrety, op. cit., p. 30.
[32] Frege est l’influence majeure de Russell, dont Valéry était un fervent lecteur comme l’atteste sa lettre à Pierre Honnorat in Lettres à quelques uns, Gallimard, 1952, p. 198.
[33] Jacqueline Russ, La marche des idées contemporaines – Un panorama de la modernité, Armand-Colin, p. 32
[34] Gottlob Frege, Les fondements de l’arithmétique, tr. fr., 1969 [1ère éd. allemande, 1884]. Cité par Ersnt Cassirer, op. cit., p. 61.
[35] Ibid., p. 61-62
[36] Paul Valéry, Cahiers, XXVII, p. 680.
[37] Paul Gifford, Valéry et le dia logue des choses divines, Corti, 1989, p. 22-23.
[38] Michel Jarrety, op. cit., p. 85.
[39] Paul Valéry, Œuvres, II, op. cit., p. 640 sq. Cité par Michel Jarrety, op. cit., p. 86.
[40] Paul Valéry, Cahiers, II, p. 770.
[41] Judith Robinson, op. cit., p. 60. Valéry était un lecteur de Claude Bernard, et de son Introduction à la médecine expérimentale. La démarche de Claude Bernard visait, contrairement à celle de la médecine d’observation hippocratique qui considérait les maladies comme des entités, comme des essences, à agir sur l’organisme en précisant les relations de ses constituants. Canguilhem lui reprochera, à l’instar de Valéry, de ne pas suffisamment prendre en considération le tout de l’organisme. Voir Georges Canguilhem, Le Normal et le Pathologique, chapitre III, « Claude Bernard et la pathologie expérimentale », PUF, 1966, coll. « Quadrige », 1988.
[42] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 50.
[43] « Nous disons qu’elle [la science mathématique] constitue un mécanisme qui, lorsqu’on l’applique à des nombres entiers, doit toujours donner des équations numériques correctes. Mais il faut pousser l’étude de la structure de ce mécanisme assez loin, si l’on veut être capable de reconnaître qu’il en est bien ainsi. ». David Hilbert, « Sur l’infini », op. cit., p. 229. Pousser suffisamment loin l’étude de ce mécanisme conduit effectivement Hilbert, comme on va le voir, à passer de l’arithmétique à contenu à l’algèbre formelle et au calcul logique.
[44] Ibid., p. 51.
[45] Ibid., p. 233.
[46] Luitzen Brouwer développera à partir de 1907 une doctrine originale du fondement des mathématiques : l’intuitionnisme. Comme le précise Jean Largeault, « le formalisme hilbertien et l’intuitionnisme diffèrent sur ce qu’il faut entendre par mathématiques intuitives (des dessins sur le papier pour l’un, des constructions mentales pour l’autre). ». Présentation de « Sur l’infini » de David Hilbert, op. cit., p. 216.
[47] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 142
[48] Ibid.
[49] Ibid.
[50] Robert Pickering, Paul Valéry – La page, l’écriture, Clermont-Ferrand, PUBP, 1996, p. 321.
[51] Ibid.
[52] Ibid.
[53] Paul Valéry, Cahiers, V, p. 864. Cité par Robert Pickering, op. cit., p. 322.
[54] Pierre Cassou-Noguès, Les démons de Gödel – Logique et folie, Seuil, 2007, p. 117.
[55] Paul Valéry, Cahiers, XIX, p. 645.
[56] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 13.
[57] Paul Valéry, Cahiers, XIX, p. 672. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 103. Cette citation des Cahiers date de 1936. Elle est donc postérieure au premier formalisme de Valéry, placé sous le signe de la mathématique pure. Sa recherche s’oriente davantage vers les concepts physiques, notamment vers la thermodynamique, à partir de 1900, comme on le verra en deuxième partie.
[58] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 103. L’Homo, par opposition à l’Ego singulier, désigne l’Homme en général.
[59] Paul Valéry, Cahiers, XXV, p. 341. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit.
[60] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 104n.
[61] Ibid., p. 105.
[62] Paul Valéry, Cahiers, XX, p. 204. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 105.
[63] Nicole Celeyrette-Pietri, ibid.
[64] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 118.
[65] Ibid., p. 119.
[66] Paul Valéry, Cahiers, I, p. 384.
[67] Pierre Cassou-Noguès, op. cit.
[68] Ibid., p. 120.
[69] Ibid.
[70] Kurt Gödel, Collected Works, éd. S. Feferman, J. Dawson et al., Oxford, Clarendon Press, 1934 (Postscript 1964), t.1, p. 370. Cité et traduit de l’anglais par Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 120.
[71] Pierre Cassou-Noguès, op. cit.
[72] Voir infra, p. 7.
[73] Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 122.
[74] Paul Valéry, Cahiers, XVI, p. 571. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 108.
[75] Nous soulignons.
[76] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p.108-109.
[77] Ibid., p. 109
[78] Michel Jarrety, op. cit., p. 419.
[79] Paul Valéry, Cahiers, II, p. 517. Cité par Michel Jarrety, ibid.
[80] Michel Jarrety, ibid.
[81] Mais le Système de Valéry, informé par sa poétique qui l’informe en retour, peut-il s’excepter de la circularité uniquement parce que le cerveau s’enracine dans le « Moi-corps » [[Voir Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 102.
[82] L’expression de quantité référée est à mettre au crédit de Nicole Celeyrette-Pietri (Ibid.). On retrouve ici la problématique de la fiducia : les représentations du Système exigent, pour fonder leur valeur, échapper à l’inflation, leur conversion possible, et immédiate, en fonctionnement corporel, comme l’échange monétaire doit être garanti « moyennant échange final contre valeur-or », Paul Valéry, Cahiers, XXII, p. 879. Cité par Michel Jarrety dans la section « La monnaie du puissant esprit » à laquelle nous renvoyons, op. cit., p. 85.
[83] Les limites de l’analytique justifient pour Platon le recours au dialegesthai, à la dialectique. C’est cette clôture qui confine chez lui la mathématique au rang de simple technè.
[84] Voir Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 22.
[85] Paul Valéry, Cahiers, I, p. 896. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op . cit.
[86] Nous rappelons à ce propos à la citation de Michel Jarrety figurant qui définit le nominalisme de Valéry comme la « conscience aiguë de l’inadéquation que les mots maintiennent avec le monde qu’ils ont charge de dire, comme avec la pensée, en raison tout ensemble de l’antériorité et de l’extériorité dont ils se trouvent marqués », Michel Jarrety, op. cit., p. 22.
[87] Paul Valéry, Cahiers, XVIII, p. 303. La citation date de 1935.
[88] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 55.
[89] Le lien entre la notion d’énergie et celle de fini est signalé par Valéry dans une des dernières notations des Cahiers : « Mon premier essai psi (de psychologie ?) fut une idée du fini. Qui devint un point de vue énergétique. », Paul Valéry, Cahiers, XXIX, p. 911.
[90] Paul Valéry, Cahiers, II, p. 663. Le passage est précédé d’une condamnation de la philosophie « dont les inventions explicatives sont plus qu’à moitié des déductions naïves inutiles, vaines – ou bien la simple nomination des difficultés elles mêmes. »
[91] Voir Pierre Cassou-Noguès, op. cit., p. 118.
[92] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 56.
[93] Ibid., p. 71.
[94] Paul Valéry, Cahiers, XXVI, p. 826. Cité par Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 115.
[95] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 115.
[96] Paul Valéry, Cahiers, X, p. 393. Cité par Judith Robinson-Valéry, op. cit., p. 65. Il convient de remarquer que le cycle, comme mesure d’observation, modifie l’appréciation que l’on porte sur la partie. Ce passage met l’accent sur ce point : « Il en résulte que suivant que l’on considère les choses dans un de ces cycles, pendant le cycle, ou bien que l’on envisage la suite sans égard à cette division, à ce pas des choses, – les résultats sont très différents. »
[97] Ce parallèle que nous proposons n’est pas, à notre connaissance, présent chez Valéry lui-même. Il n’est pas non plus superposable : la dianoïa ne correspond pas au stade gazeux, le pneuma au stade liquide et le graphein au stade physique. C’est une analogie métaphorique.
[98] Nicole Celeyrette-Pietri, op. cit., p. 58.
[99] « Enfin la théorie des interventions cad des transformations de l’énergie d’un système commandées par un système énergétiquement extérieur au précédent – est inexistante… ». Paul Valéry, Cahiers, III, p. 768.
Thomas Vercruysse est actuellement chercheur postdoctorant à l’Université du Luxembourg. Membre du groupe Valéry de l’ITEM/CNRS et correspondant étranger de la revue "Aisthesis", ses recherches portent sur les liens entre esthétique et épistémologie. Il s’apprête à publier un essai chez Droz, "La cartographie poétique - Tracés, diagrammes, formes, Valéry, Artaud, Mallarmé, Michaux, Segalen, Bataille". Principales publications :
- "Parole de la mère et symbolisme du père dans la poésie de Vénus Khoury-Ghata" in "Paroles, langues et silences en héritage", Caroline Andriot-Saillant (éd.), Clermont-Ferrand, PUBP, 2009 - "La peau et le pli : Bernard Noël, pour une poétique de la réversibilité" in Lendemains, 2009, Tübingen, Gunter Naar, 2009.
- "La bêtise selon Valéry et l’idiotie de Valéry". Colloque "bêtise et idiotie" tenu à Nanterre en octobre 2008, organisé par Nicole-Jacques Lefèvre et Marie Dollé (actes à paraître).
- "Intensité et modulation : Valéry à la lumière de Deleuze" Colloque "L’intensité : formes, forces et régimes de valeurs", tenu à Poitiers en juin 2009, organisé par Colette Camelin et Liliane Louvel (actes à paraître dans "La Licorne"). Editions :
- Tome XII des Cahiers de Valéry, à paraître chez Gallimard en 2011. "Georges Bataille philosophe", Franco Rella, Susanna Mati, Vrin. A paraître en mars 2010.
- « Paul Valéry- Identité et analogie », Valérie Deshoulières et Thomas Vercruysse (éd.), revue Tangence (à paraître).