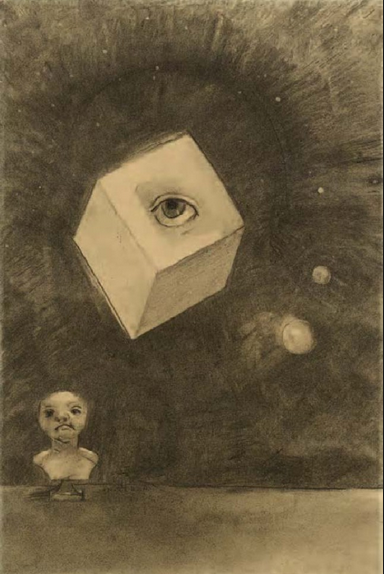Que l’identification du lecteur soit difficile dans certains textes contemporains est frappant. Dans des univers blancs et peu meublés, comme ceux de Beckett, dans des mondes comme ceux d’Éric Chevillard où se mêlent étroitement qualités réelles et lois surnaturelles mais aussi dans ceux qui sont proches du nôtre et recèlent pourtant une étrangeté inassignable (par exemple, dans les textes de Christian Gailly), comment le lecteur parvient-il à se repérer sans recourir à une identification immédiate ?
Je ferai l’hypothèse que cette reconnaissance existe bel et bien mais sous une forme différente de l’identification classique, et qu’elle motive le désir de lire. Il existe certes l’assimilation classique à un personnage dont on reconnaît les plaisirs et les peines, et qui nous ressemble par moments. Mais peut aussi avoir lieu l’empathie ponctuelle avec un personnage, fût-il antipathique et présenté négativement par le récit, comme le montre Raphaël Baroni (2007) : le suspense ménagé dans le récit nous fait parfois vibrer en harmonie avec un personnage connoté négativement, alors même qu’on ne peut en aucune manière s’identifier à lui. Aussi le lecteur, aux prises avec un texte contemporain, doit-il mettre en place une reconnaissance d’un autre ordre que celui de l’identification totale (dans le prolongement de cet article, voir Bloch 2017).
Nous voudrions montrer que, paradoxalement, le langage crée une immersion partielle du corps autant que de l’esprit à travers des repérages médiés par l’écriture. En effet, la prose poétique, de fiction ou de récit, est l’occasion d’une projection partielle du lecteur grâce au langage commun, et à l’usage des déictiques (ceux qui renvoient à l’expérience personnelle, tel le pronom je), et à ceux qui permettent l’insertion dans un contexte donné (embrayeurs de lieu et de temps). La conscience du lecteur fait appel à un corps imaginaire suscité par le simple déchiffrage de mots renvoyant à l’expérience, partagée par tous, que chacun fait du rapport entre langage, corps et esprit, à condition que le texte propose un minimum de lieux de repérages, soit par le biais de l’évocation du « je » (où le lecteur pourrait éventuellement se projeter comme locuteur ou comme récepteur), soit parce qu’il met en place une contextualisation dans un univers (qui permet, grâce à une permanence et à une régularité, de faire exister un univers et une contextualisation susceptibles d’immersion). C’est ce que la prose poétique, dans la fiction ou le récit, permet en donnant à lire un univers aux contextualisations ou aux permanences minimales ; le cas limite serait fourni par les fictions de Beckett où les personnages habitent un lieu relativement abstrait et non facilement représentable.
Je voudrais montrer ici que le je prononcé, lu, écrit, ouvre immédiatement et intuitivement sur une expérience commune au narrateur comme au personnage, à l’auteur comme au lecteur, permettant la lecture de textes. Pour ce faire, je présenterai dans un premier temps quelques hypothèses, formulées en particulier par François Récanati, à propos de l’utilisation du pronom je et de son rattachement immédiat à l’expérience psychique de soi-même. Puis, je chercherai ce qu’il en est de la pratique du je dans une écriture actuelle, comme dans le texte de François Bon intitulé Prison (1997) où s’entretissent la voix de l’auteur et celle de prisonniers s’exprimant au cours d’un atelier d’écriture. Or, je a une importance tout à fait fondamentale dans ce texte puisqu’il y est l’enjeu de l’atelier : il s’agit, pour le prisonnier, de prendre la parole ou plutôt l’écriture, ce qui, nous le verrons, ne va pas sans nécessiter la conscience de soi-même comme sujet. Dans ce contexte, le rapport au langage intérieur est un mélange de proximité et de distance : les écrits des prisonniers se fondent partiellement sur leur parole intérieure sans être pour autant des retranscriptions de parole intérieure, ni même des représentations endophasiques à proprement parler. Ensuite, nous reviendrons sur l’effet produit sur le lecteur par l’usage du pronom je lu, intégré à sa parole intérieure, avant de terminer par le voyage imaginaire dans l’espace procuré par les déictiques spatiotemporels.
En effet, parmi les permanences et régularités offertes par les textes, le mot « je » noue l’expérience corporelle de soi, celle de la conscience intime et proprioceptive de soi-même, au langage extéroceptif. Aussi toute notation du mot « je » renvoie-t-elle immédiatement à une expérience semblable que nous pourrions faire concernant notre propre nouement irréductible du corps et de l’esprit et permettant de nous immerger en destinateur ou destinataire dans le texte. Nous considérerons différentes sortes d’embrayeurs : les pronoms ne sont pas les uniques passeurs permettant l’immersion dans un texte. Le « je » perçu de l’intérieur projette un espace interne et externe (il crée l’espace), mais les indexicaux « ici » et « maintenant » sont au contraire sensibles au contexte, c’est-à-dire à l’espace de l’univers d’énonciation et de réception dans lesquels ils sont énoncés ou lus. En effet, les indexicaux spatiaux et le jeu des temps sont les vecteurs syntaxiques et formels d’immersion qui ne prennent pas seulement les auspices d’une aspiration vers le monde évoqué par les images et les références du texte. Wheeler, Stuss et Tulving (1997) font remarquer que la mémoire épisodique, c’est-à-dire le fonctionnement de notre mémoire personnelle, relie des informations factuelles (des informations contextuelles sur le lieu et le temps) et des informations autonoétiques, qui concernent la place et l’implication du moi dans ces expériences mémorisées[1]. Nous proposons de passer en revue ces différentes caractéristiques. Nous allons nous pencher sur les aspects contextuels via les embrayeurs, sur les jeux spatio-temporels et sur l’immersion auto-noétique, via l’usage du pronom je.
Car non seulement le pronom je implique le lecteur, mais tous les embrayeurs de lieu (ici, maintenant, là) renvoient à une mise dans un contexte fictif, dans un espace, qui tend à faire « entrer » le lecteur dans le lieu évoqué et feint. Semblables fonctions sont assumées par les temps qui, eux aussi, invitent à une insertion fictive dans un monde donné.
I. Quelques hypothèses empruntées à la philosophie du langage et au débat entre néo-frégéens et néo-russelliens
(Pour une présentation synthétique et voisine de notre problème campant les positions des néo-russelliens et des néo-frégéeens, voir Jacob 1989)
Le pronom je est paradoxal : tous le prononcent et, pourtant, il renvoie à chacun. Nous voudrions montrer qu’il ancre la proprioception intime de soi (en la rattachant au corps propre et individuel) en même temps qu’il est élément de langage commun et partagé par tous.
Une réflexion sur son fonctionnement étrange est proposée par François Récanati. Nous en conclurons que cet élément de la langue, arbitraire, institutionnel, commun, est rattaché par le sujet à des expériences renvoyant au lien entre le corps du sujet et le langage. Le déictique de première personne noue l’institution langagière sociale (je appartient à tous) à la perception intime de soi-même, selon François Récanati.
Celui-ci affirme ce caractère à la fois institutionnel et immédiatement subjectif du pronom je en partant des distinctions établies par Frege, dans Sens et Référence (Über Sinn und Bedeutung,1892, texte fondateur de la philosophie analytique). Récanati (1992 et 1993) rappelle tout d’abord la distinction frégéenne entre la référence, c’est-à-dire la dénotation (Bedeutung, la chose même, la portion de réel désignée par l’expression, par exemple l’étoile « Vénus ») et le sens (Sinn, c’est-à-dire l’expression, la manière de désigner la chose, par exemple « l’étoile du matin »). Puis, Récanati introduit un nouveau terme, proposé entre autres par Kaplan et Perry : le « contenu psychique » de l’énoncé, c’est-à-dire, « ce que je pense quand je prononce un énoncé ». La question que pose François Récanati, à leur suite, est donc la suivante : est-ce que le « contenu psychique » est identique au référent (à la chose même), à l’expression (au sens), ou bien est-ce encore autre chose ? Autrement dit, notre pensée est-elle confondue avec la chose, avec la manière de la dire, ou réside-t-elle encore dans une expérience spécifique ?
Si l’on s’en tient aux simples embrayeurs et indexicaux, il apparaît à Récanati qu’il convient d’établir une distinction entre, d’un côté, les indexicaux purs (comme ici et maintenant, je est relié à la perception intime qu’on a de soi-même) et, d’un autre côté, les démonstratifs du type « ce bateau », sémantiquement incomplets, et se définissant par la perception sensorielle du contexte, de l’espace. Dans le cas des expressions démonstratives, qui sont incomplètes, elles désignent un objet, tel qu’il s’offre au sujet par le contexte. Or, il se peut qu’une aberration de perception donne l’impression que « ce bateau », vu par la fenêtre de droite, soit différent de « ce bateau », vu par la fenêtre de gauche. En effet, le cadre de la fenêtre ou un trumeau peuvent masquer qu’il s’agisse du même bateau, en réalité. Ainsi, à la même expression « ce bateau » correspondront deux contenus psychiques différents pour le même référent, et la même expression. On voit donc que, dans ce cas, le contenu psychique d’un même énoncé peut être variable et déterminé par la plus ou moins bonne perception du contexte. Mais, alors que ce bateau, accompagné d’une désignation d’un bateau entr’aperçu par la fenêtre, a un contenu psychique défini par l’utilisation de cette expression dans un contexte précis (ce bateau = le bateau vu et désigné par celui qui parle), tout au contraire, le contenu psychique de je n’est pas défini par la situation linguistico-contextuelle qui serait vue ou perçue, comme Récanati le démontre selon un mode que j’essaie de résumer ci-après. Même si le pronom je peut être défini comme « celui qui énonce », nous recourons au pronom « je » par la perception intime que nous avons de nous-même et sans attendre de voir qui va parler (en l’occurrence, nous-même) pour pouvoir dire je à bon escient (nous ne nous disons pas « qui parle ? C’est moi, donc, j’ai le droit de dire je »). Nous ne nous demandons pas qui s’exprime et n’avons pas à constater de nos yeux que nous sommes en train de prendre la parole pour nous autoriser à utiliser le pronom de première personne : c’est donc que nous accédons à sa légitime utilisation par la conscience interne que nous avons de nous-même comme une entité reliant notre bouche, la perception interne de nous-même et notre pensée dans un cogito locuteur. Nous n’utilisons pas ce pronom de première personne à tort et nous ne nous prenons pas pour un autre (c’est ce que Wittgenstein appelle la « protection contre les erreurs d’identification », ce qui est vrai sauf lorsque le sujet est sous l’emprise de quelque drogue ou psychose). Une personne a conscience d’avoir les bras croisés ou non, sans avoir à le constater de ses propres yeux, de même utilisons-nous le pronom de première personne pour nous désigner sans avoir à analyser le contexte, dans lequel nous prenons la parole, sans avoir à le vérifier du regard. Je s’utilise donc indépendamment de la perception véridique ou erronée du contexte d’énonciation.
C’est pourquoi il est possible au lecteur de s’impliquer dans ce je qu’il lit, même sans partager la situation d’énonciation, ou bien en ressentant lui-même ce nœud interne du corps et du langage dans le je, ou bien en s’imaginant être le destinataire direct auquel ce je s’adresse (nous en ferons l’expérience à travers l’analyse du texte de François Bon).
Ainsi, pour François Récanati, qui s’appuie donc sur Frege, sur Kaplan et sur Perry, dans le cas de je – indexical pur –, l’expression et le contenu psychique sont directement reliés par un lien culturel insuppressible, où le contenu psychique subjectif se noue à l’expression linguistique (conventionnelle).
Michel Charolles, linguiste français, démontre aussi que le sentiment de la langue fait du « je » une ipséité (définie, par emprunt à Ricœur dans Soi-même comme un autre [1990], comme le fait que l’individu s’éprouve comme le même dans le temps) qui ne permet pas la déconnexion entre esprit et corps (voir Charolles 1996 et Ricœur 1990). Michel Charolles lit la nouvelle de Gautier Avatar, et démontre que, dans ce cas où les deux personnages principaux voient leurs âmes interchangées (le comte, Olaf, a une âme qui est mise dans le corps d’Octave de Saville et vice versa), la langue peine à désigner clairement qui est je parce qu’elle ne peut accréditer la séparation de l’esprit et du corps, ces derniers étant d’ordinaire strictement interreliés par le pronom. Selon qu’on se situe dans l’espace mental des personnages ou dans celui des apparences extérieures, les désignateurs personnels ne sont pas les mêmes. On lit à propos du comte : « il se regardait et voyait quelqu’un d’autre ». Gautier introduit là, selon Charolles, un dualisme esprit/corps violant la langue. Michel Charolles écrit : « accepter le dualisme esprit/corps, accepter qu’il puisse y avoir un je esprit et un je corps, c’est ouvrir la porte à une démultiplication indéfinie des je et c’est passer à côté d’un fait capital qu’enregistre la langue, à savoir qu’il y a une unité de la personne, que celle-ci ne se réduit pas à une collection de parties hétérogènes, que celles-ci soient physiques ou psychiques ». Nous sommes d’accord avec Michel Charolles pour dire que la phrase de Gautier introduit un dualisme non inscrit dans l’usage du pronom. Mais nous pouvons tout de même retracer la raison pour laquelle le comte peut se penser étranger à lui-même. En s’observant dans la glace, il se voit de l’extérieur, comme quelqu’un d’autre que celui qu’il se sent être par sa perception interne et proprioceptive. Cette non convergence du sens intime de soi et de la vision qu’on a de soi-même à travers un miroir (vision potentiellement erronée) s’explique par la démonstration de François Récanati vue ci-dessus. Aussi constatons-nous que le philosophe du langage est d’accord avec le linguiste Michel Charolles, pour voir dans le pronom « je » le garant d’une « ipséité » interne et/ou externe.
Revenons à ce « je » qui, d’une certaine façon, fonde l’échange entre locuteur et lecteur. Nous constatons que c’est par le pronom je que l’institution langagière commune est au plus proche du moi comme vécu propre. Puisque je est dit par tous (auteurs, personnages, lecteur), il est le lieu où le langage ouvre sur une expérience intime qui n’est pas la même pour tous, mais qui fait accéder à la même intimité instinctive pour chacun. Le paradoxe est le suivant : c’est dans le moule le plus universel du pronom « je » que le sujet scripteur coule un rapport immédiat à son corps propre, et à ses sensations, et c’est dans ce même moule que le sujet lecteur accède, par le langage et ce pronom, à ce que serait l’expérience intime de soi-même, s’il était dans la situation de dire « je ».
Vincent Descombes (1996) veut aller encore plus loin en démontrant que l’intériorité, l’intentionnalité, est institutionnelle, et donc, j’ajouterais partageable. Car, pour lui, la spécificité du mental n’est pas l’intériorité, mais la signification, c’est-à-dire l’institution (langagière, entre autres). L’esprit objectif des institutions rend possible l’esprit subjectif des personnes particulières. Ainsi, il écrit : « Le concept d’intention semble nous inviter à loger l’esprit dans un sujet des intentions (dans une tête), mais nous découvrons bien vite que ce n’est pas là sa place. C’est plutôt le sujet qui, pour acquérir un esprit, doit être logé dans un milieu qu’on aurait dit en français classique, “moral”, et en allemand, “spirituel” (geistig) ». Pour Vincent Descombes, le pronom je ne peut se concevoir sans l’existence d’un dialogue, et c’est cette antériorité dialogique qui établit la possibilité même de l’usage du pronom de première personne. D’une certaine façon, on pourrait dire que Descombes se situe ainsi (sans qu’il l’affiche clairement, me semble-t-il), à la suite d’Émile Benveniste pour qui l’énonciation dans le langage, toujours constituée de dialogue (même lorsqu’il s’agit de monologue), est transcendante à la perception du je : pour Benveniste, dire « je » , c’est se constituer en personne par l’énonciation même, le « tu » étant le « non je » (le non locuteur) et le « il » étant la « non-personne », c’est-à-dire la personne ne participant pas au dialogue[2]. Benveniste et Descombes voient dans le langage (pour le premier) et dans la société (pour le second), des termes antérieurs à la perception de l’intimité de soi. Descombes s’oppose à Récanati, qui donne une priorité au nouement de l’expérience corporelle intime et de l’institution langagière dans l’usage du pronom « je » (priorité à la perception intime de son corps pour se concevoir comme « je »). Nous nous rangeons plutôt du côté de Récanati en pensant que, dans certains textes, je est, certes, une institution du langage, mais qu’elle est expérience intime de nouement du corps et du sujet, antérieure à l’institution de soi par le dialogue avec l’autre, et demeurant un point d’ancrage et d’identification pour le lecteur.
Ainsi, la lecture du je, dans un texte de poésie ou dans une fiction, induit une empathie par projection imaginaire du corps du lecteur comme locuteur ou comme récepteur du discours tenu. Mais avant d’aborder l’expérience du lecteur, voyons ce qu’il en est de l’usage du je et du discours intérieur tenu par le locuteur qui se coule dans la flexion permise par ce pronom.
II. Réflexion sur l’usage du pronom je par l’écrivant, dans Prison de François Bon (1997)
Dans Prison de François Bon (1997), le récit est tressé de multiples fils : réflexions directement assumées par l’auteur, essais de prisonniers transcrits verbatim ou réécrits, discours indirects libres rapportés ou transposés à la suite d’entretiens avec les prisonniers. A la demande de l’auteur, animateur de l’atelier d’écriture, les prisonniers écrivent à partir de divers thèmes (le voyage, la ville) ou de certaines voix (celle de Rimbaud, en particulier). Mais ce sont leurs expériences et les circonstances, parfois d’une minceur impalpable, les ayant fait basculer dans le délit ou le meurtre, qui reviennent dans leurs récits, de manière lancinante, même si l’atelier d’écriture les détourne du témoignage immédiat. Ainsi, l’écriture comme détour devient expérience de l’intime tout court. L’écriture, voulue par l’animateur de l’atelier d’écriture, comme expérience du monde devient, sous l’impulsion de la pratique des prisonniers écrivant, une écriture de parole intérieure, laissant émerger vie intime au-delà de ce qui était initialement visé.
C’est cette absence d’intimité à soi que nous allons tenter de retracer tout d’abord. Puis, nous décrirons l’échange des voix dans l’atelier d’écriture, le partage du je, dans l’institution du langage, qui permet aux prisonniers de devenir sujets par la mise en place d’une communauté positive. Enfin, lorsque l’un des prisonniers devient véritable sujet, dans le dernier chapitre, on verra que le pronom je ne nécessite plus, pour être compris, la mise en place d’une expérience commune. Sa seule prononciation suffit à recréer une communauté car je signifie dès lors pour tous une expérience dont la communauté à autrui réside dans une intimité à soi-même partagée par tous, celle du rattachement à un corps propre, et à son propre espace d’ici et maintenant.
De là pourra s’expliquer le goût du lecteur pour une littérature moderne où des je sans ressemblance avec nous continuent pourtant à nous intéresser : c’est par la vertu du seul je que nous créons une communication fondée, non sur le partage d’une expérience de vie particulière, mais sur une simple communauté qu’est l’utilisation de je, comme liée indissolublement à l’aptitude à la proprioception et à la présence à soi.
Tout au cours de Prison, les sujets sont dénués de corps et de territoire individuels, actuels (en prison) ou passés (dans leur enfance). Ce sont des « je » privés de maison dès le jeune âge : « le mot maison n’est pas le leur, c’est moi qui avais proposé un jour qu’on travaille sur ce seul mot » (88) et qui y substituent automatiquement, parlant de leur jeunesse, le mot foyer, comme ici détourné de son sens premier pour signifier dès lors ce non-lieu, cette impossible individuation du territoire, seule susceptible de donner un corps propre (« celui qui avait fait tant de foyers lui aussi (c’était tellement presque tous) )», 65). Dans cet échange permanent entre le dedans et le dehors propre à des individus privés de constitution heureuse du moi, toute identité se constitue dans l’externalité territoriale, où la cité, communauté envahissante, se substitue à la coque ordinaire du sujet (la maison, l’appartement…) : ainsi l’individu est nommé par le nom de la cité (« affublé de tel surnom que ça vous poursuit où que vous alliez, ce surnom qu’on ma donné, cité Lumineuse », 13) et il se crée lui-même, à demi individué pourtant, dans la solidarité clanique autour de la cité opposant dans des combats de rue Californie 1 à Californie 2 (38). Pourtant ce seul marqueur d’identité, la cité, en est aussi le dévoreur ou le disloqueur, puisque la cité crée un temps où l’on « glande » : elle ourdit un non-temps, un non-lieu dans lequel l’extérieur colle à la peau sans transition. Dans une constitution du moi plus apaisée, comme on en a fait l’hypothèse ci-dessus dans le passage consacré à l’approche linguistique et philosophique, la perception du corps propre et de l’énonciation du « je » sont solidaires, transcendantes et premières par rapport au dialogue et à l’espace, à condition que le moi ait pu se constituer par les bons soins primordiaux prodigués dès l’enfance, comme corps propre, avant l’intrusion de l’espace externe.
La syntaxe choisie par Bon pour retranscrire cette intrusion d’une extériorité de la ville dans le destin individuel le montre clairement, qui associe en un raccourci saisissant, et dénué de ponctuation forte, les sujets animés et inanimés à la ville : « et, quand quelqu’un passe, le pas sonne longtemps dans la rue droite, ailleurs la ville est blanche sous le ciel bleu et j’avais froid, le jour a oublié les fureurs de la nuit et les maisons fermées ne disent rien de leur histoire au-dedans » (Bon, 1997, 10)[3]. Ainsi l’extérieur est soudainement collé au sujet sans transition ni point, la ville avoisinant le je dans un brusque décrochement où des phrases à sujets différents se trouvent précipitées les unes contre les autres, sans un quelconque liant autre que cette agression permanente du dehors sur le dedans, rendue ici par une rythmique constituée d’anacoluthes. Cependant, l’extérieur (la ville) vient délimiter le sujet en se juxtaposant à lui, en l’envahissant par l’absence de ponctuation forte (la ville/je), sans pourtant lui donner assez de force pour lui conférer une véritable essence (« les maisons ne disent rien de leur histoire au-dedans »). C’est là tout le paradoxe de cette présence de la ville qui détermine tout individu, sans pour autant lui conférer assez de caractère, ni d’essence proprement individuelle pour le constituer vraiment.
Dans la prison, les prisonniers retrouvent cette même absence de territorialité, la prison étant située, comme la cité, dans un espace de no man’s land aux confins de la ville (le chapitre II est intitulé « au bord des villes ») : « s’éloignant de la prison on longe un centre commercial abandonné aux rideaux de fer tirés » (8). C’est que l’individu entrant en prison, même pour une visite, est dépossédé de son identité : « alors que je sortais, ayant franchi la première porte-sas du bloc et repris ma carte d’identité » (7). Le sujet social est laissé à l’extérieur de la prison, ainsi que le montre une des premières phrases de ce livre, révélant de manière inaugurale cette privation de soi.
Le sujet prisonnier se retrouve, par essence, sans protection corporelle et, partant, sans intimité à soi ; aussi est-ce l’image du mollusque sans coque qui revient dans un des témoignages : « on est comme des bestioles molles dans des coquilles, et l’instant qu’il n’y a plus de coquille, qu’on est dans les couloirs devant la porte ou dans le sas avant la cour, il faut respecter le code et montrer qu’on en dispose, sinon cela se retourne contre vous » (103). Ce dénuement de toute carapace contraint dès lors à échapper à une vulnérabilité extrême par l’acceptation d’une violence supplémentaire. Retournement paradoxal : ce n’est plus seulement la violence de la prison et de l’enfermement qui assujettit, mais avec plus de radicalité, l’imposition de la loi du gang, celle qui s’édicte dans les murs par les prisonniers et à laquelle nul ne peut déroger.
Aucun comportement individuel ne peut plus subsister qui ne soit au préalable déjà édicté par le groupe. C’est que les prisonniers se tyrannisent eux-mêmes dans un espace clos où nulle échappatoire ne demeure. Seule solution dès lors : cette absurde intériorisation des règles comportementales où l’on peut se moquer d’un autre à condition de s’excuser, code de l’honneur étrange où toute dérogation devient violence ou exposition à être abaissé : « Il y en a qui sont forts pour les plaisanteries […]. Si à la fin il n’y a pas ce salut qui réinverse les rôles, c’est le lendemain que ça se paye. Et si ça ne se paye pas, tant pis pour celui qui s’est laissé bafouer, c’est tous les autres qui lui marchent dessus » (103).
C’est que le je du prisonnier est en échange avec les autres prisonniers dans un espace perpétuellement collectif où ne peut se recueillir l’individualité. Le je n’y est pas sujet, ni loi générale, mais tyrannie de la force. Ainsi, la prison représente à la fois un territoire fermé qui est l’absence de tout territoire, mais elle est aussi un non-lieu, à la frontière des villes, où survivent en commun des prisonniers non individués (ça se fait, on lui prend : autant de phrases où une loi extérieure, un non-sujet, se substituent à la volonté individuelle). C’est donc un lieu de non-subjectivité.
Mais si les prisonniers n’ont pu se constituer dans leur enfance par ce manque d’espace propre, ils ont également du mal comme adultes, à se concevoir comme sujets, en un autre sens. Il leur est en effet impossible de revenir sur eux-mêmes, tant cette anamnèse est perçue comme douloureuse. Et c’est sans doute aussi la haine de soi qui les empêche d’écrire je. Depuis l’expression « ce qui pousse aux voyages, je n’en parle pas, parce que ce n’était pas dans l’honnêteté » (69), jusqu’à « est-ce qu’on peut dire qu’on n’aime pas les voleurs, si on en est un ? » (47), tout signale la conscience taraudante de la faute que chacun veut éviter. D’où les réticences à l’atelier d’écriture : « je pourrais le faire mais c’est trop, il faudrait combien de jours », ou bien cette pathétique déclaration : « Monsieur, je ne ferai point le texte que vous attendez de moi quand vous me dites de faire un texte sur mes souvenirs, ah non, surtout pas/ car vous ne ressentez pas ce qu’est-ce que ça me fait d’évoquer un souvenir […] / car si vous le ressentiez vous auriez tellement mal[…] » (96). Dire je est accepter la roide présence de la conscience à soi. Or, tel est précisément ce que les prisonniers ne peuvent affronter : ce retour sur eux-mêmes serait recollection de soi en un concept, qui embrasse l’individu et qui risque d’empêcher une dissimulation, un mécanisme de défense relevant de l’enfouissement.
Enfin, dernière définition possible de la subjectivité et dont on voit a contrario combien elle manque aux prisonniers, outre l’espace et le corps propre, outre la recollection de soi, c’est la possibilité de déterminer son avenir. Prison montre combien cette détermination est absente : les sujets y sont des objets perdus dans un destin qu’ils ne maîtrisent pas, où le je s’égare dans la diversité du monde.
La manière de définir ce destin est en effet très caractéristique : « le destin, c’est quand tu commences à faire quelque chose et qu’il t’arrive des choses que l’on n’avait pas pensé à faire » (76), que François Bon commente lui-même (« la dissolution du tu passant de sujet à complément, avant la disparition impersonnelle, comme intériorisée par ce verbe pensé pris négativement »). En outre, le choix d’infinitifs par l’auteur, pour préciser ce qui motive à agir ou à voyager, se lit comme une syntaxe montrant la non-présence à soi : « poursuivre juste un éblouissement, danser sur » (81). Autant d’impulsions à agir qui traversent le moi et le transforment, sans pour autant qu’elles émanent directement du moi comme pouvoir de décision.
On voit que cette perte des sujets dans la diversité de ce qui arrive est l’une des caractéristiques de cette absence à soi-même. Le texte montre ainsi, en négatif, qu’une absence d’intimité à soi empêche de se construire comme différent, et individualisé. Le je est dès lors défini en creux, par les prisonniers du texte, comme tout ce qui peut faire défaut : absence de corps propre, incapacité à affronter l’intimité de soi-même (comme rapport au passé), incapacité à envisager l’avenir. Enfin, le prisonnier apparaît comme celui qui n’a pas de propriété comportementale autre que celle de la cité, ou celle de la prison, qui s’impose à lui, celle d’une fausse loi, donc, mais qui n’est que la force. La loi du langage, au contraire, peut autre chose.
Comment faire advenir un je ?
Comment dès lors recréer une certaine intimité à soi, indispensable pour pouvoir dire je ? Parier sur l’écriture pour réussir à faire apparaître le je, c’est penser, me semble-t-il, que c’est parce que des semblables ont dit je pour se désigner comme capables de retour sur soi et de décision vers l’avenir, que moi qui suis comme ceux qui ont dit je, je vais pouvoir le dire à mon tour. Ne crée-t-on pas l’intimité de soi-même en copiant quelqu’un de semblable qui affronte déjà (ou qui a affronté) de créer l’identité de soi-même (tout comme l’enfant, ayant d’abord commencé à se désigner lui-même par la troisième personne, finit par se concevoir et se dire en première personne) ?
Vincent Descombes ne serait pas d’accord avec une telle proposition puisqu’il fait reposer la subjectivité sur l’application de la loi générale à l’individu et non sur la communauté de destin ou la ressemblance entre les individus[4]. Je fais, quant à moi, deux hypothèses concomitantes, à partir de Prison : celle que le langage institutionnel et général s’applique au sujet individuel, mais qu’il ne s’applique qu’à condition que l’individu se reconnaisse par ressemblance, à d’autres individus à qui s’applique la loi générale du langage.
En suivant les traces de Rimbaud, en décrivant ses propres voyages de fugitif comme ceux que Rimbaud a pu faire, et en constatant que Rimbaud a su constituer un certain rapport à l’intimité de soi-même qui lui permette d’écrire et de dire je (fût-ce pour dire « je est un autre »), pourquoi moi prisonnier, qui ai bourlingué comme Rimbaud, n’arriverais-je pas à constituer une certaine intimité de moi-même jusqu’à dire je ? Si Rimbaud est un voyou et un voyageur comme moi, pourquoi ne pourrais-je m’emparer de l’écriture comme lui ?
Telle est sans doute la stratégie de l’atelier d’écriture choisie par François Bon qui s’appuie sur une communauté d’expérience du poète et des prisonniers pour faire advenir le sujet (« et comme Rimbaud disait que j’avais cité pour leur suggérer de parler de leurs propres routes », 76).
Même si apprendre à écrire je nécessite d’abord, du point de vue du développement psychique, une expérience commune d’actions et de vie avec tous ceux qui disent je pour pouvoir le dire à son tour, une fois acquise cette capacité à se concevoir comme individu, la simple prononciation du je suffit à créer une communauté qui ne résiderait plus cette fois dans l’expérience commune, mais dans la simple aptitude à écrire je (c’est-à-dire à se concevoir comme un être persistant dans le temps, ayant une recollection de soi-même, acceptant l’intimité avec son passé et se projetant dans le futur). Car n’est-ce pas dans cette définition que consiste l’expérience commune de dire ou d’écrire je ? Non dans le fait de partager des expériences spécifiques de vie avec d’autres, mais dans la capacité universellement répandue, d’être un je capable de proprioception. Tout se passe comme si la possibilité d’utiliser je et la perception d’une expérience commune (création d’une communauté d’intimité à soi et non nécessaire communauté d’action) étaient liées. Mais pour arriver à ce stade, il faut sans doute distinguer l’étape d’apprentissage du je, de l’étape de son utilisation ordinaire. Dans l’apprentissage du moi — celui qui est en jeu dans l’atelier d’écriture —, la communauté d’action prime et c’est par elle que François Bon fait entrer chacun en possession de soi, afin de lui donner les moyens de s’écrire comme je. Ensuite, seulement, les prisonniers pourront appréhender tout je comme simple application du sens de cet indexical pur qui désigne et construit la capacité d’intimité à soi.
C’est donc, paradoxalement, en introduisant une communauté d’expérience que l’intimité et la subjectivité peuvent se créer (on s’éloigne ici de Vincent Descombes). Aussi est-ce par l’échange des voix que ceux qui sont dépourvus d’existence spécifique réellement individuée se trouveront enfin dans la capacité d’écrire et de dire je à leur tour. Pour le lecteur, en revanche, et pour ceux chez qui la conscience du je existe, il n’est pas nécessaire de partager quelque communauté d’action avec les personnages pour éprouver un certain intérêt à les imaginer : il suffit de voir dans le je une même règle linguistique en prise sur une expérience de l’intimité de soi. C’est là que nous rejoignons Vincent Descombes : chacun est à même distance de l’autre par la règle de l’institution (ici, linguistique). Tel est sans doute le ressort de la lecture qui explique qu’on puisse, dans la littérature actuelle, s’assimiler à ce qui est différent, mais qui se coule dans le pronom je.
L’écriture en commun est donc la mise en état de se rassembler soi-même sous une même entité, désignée de l’extérieur par le concept de je et perçue de l’extérieur/intérieur par l’animateur de l’atelier d’écriture, proche de moi, qui essaie de rendre compte de mes expériences propres. De là, il n’y a qu’un pas jusqu’à devenir capable de prendre soi-même la parole pour se raconter, avec une perception interne, cette fois.
Individualisation du sujet
En prison, la présence des autres est excessive, importune. Comment, alors, la communauté de l’écriture pourrait-elle être positive ? C’est qu’elle n’est pas communauté de l’être, arasé à sa plus grande ressemblance avec autrui, mais expérience commune de l’être soi. Et l’écriture du je est le rassemblement du soi comme vu à la fois de l’extérieur (puisque désigné) et perçu de l’intérieur, dans une expérience proprioceptive, ainsi qu’on l’a vu grâce aux démonstrations de François Récanati. « Écrire, ça fait quelque chose à l’intérieur de soi » s’exclame un prisonnier (79).
Certains des prisonniers parviennent à être sujets, comme celui du dernier chapitre intitulé « Isolement » (101). Exilé dans un quartier d’isolement, il doit en passer par cet amoindrissement de son existence pour arriver à se saisir lui-même. Tout le chapitre est écrit en une focalisation interne avec le prisonnier, mais passe insensiblement du il au je. La percée de la subjectivité se fait peu à peu, au détour de phrases désaccordées qui trahissent l’émergence erratique du sujet. Parlant de son isolement total au mitard, le prisonnier/ François Bon écrit : « on est tellement bien au calme et séparé de tout et d’abord du temps comment eux ils comprendraient (même les dix jours je ne les comptais plus) » (104)[5]. Dans le heurt de soi contre le monde et dans la conflagration de cette inadéquation se joue l’explosion du système des voix, passant du on au je. Le retournement de la punition en surcroît de bien-être se dit à la fois par le contenu de la phrase et par sa forme, où un progrès se fait dans la reprise de possession de soi-même.
Tout cela permet d’aboutir à la prise de parole et à la capacité concomitante de se connaître soi-même, puisqu’on passe de la phrase « un jour il y aura être devant la porte, un sac de plastique à la main. Il y aura reprendre un bus vers la ville » (120), à la prise en main de son destin, sur laquelle finit le texte : « Je serai devant la porte et j’aurai mon sac et j’irai dans la ville » (121). La transition s’opère depuis des sujets de phrases arrimés à un simple infinitif, à de véritables actions dont le substrat est le sujet : il ne s’agit plus seulement d’être devant la porte, mais de dire je serai devant la porte. Ainsi, la capacité à dire je est concomitante du pouvoir de prendre en main son destin.
D’abord dire je en imitant ceux qui partagent le même destin que soi et qui ont osé le dire. De là, grâce à une communauté de destin, en venir à une communauté de paroles qui permet, à l’ultime étape, de dire je sans ces modèles. Ainsi émergerait, dans l’idéal, le moi.
Nous venons de voir ce que signifie l’usage de je pour l’écrivant.
III. La place du lecteur lisant « je »
De façon générale, le lecteur, lisant « je », s’identifie presque immédiatement à un je percevant (c’est-à-dire ayant une perception interne de son corps, mais aussi voyant, entendant, etc.), car, étant lui-même en situation de perception de signes écrits, il lui est aisé de s’assimiler à un je du narrateur/personnage, présenté en situation de perception et décrivant au lecteur tel ou tel contexte. Christian Metz, pour le domaine du cinéma, a souligné, dans Le Signifiant imaginaire, le phénomène de projection du spectateur qui s’établit irrépressiblement dans tout film, où le spectateur s’identifie à l’instance voyante[6]. Nous faisons ici l’hypothèse que de semblables phénomènes ont lieu davantage encore dans la lecture d’un texte à la première personne (ou la vision d’un film en caméra subjective). Le lecteur s’identifie au corps percevant qu’il devient.
Si écrire je, c’est actualiser une certaine forme de présence à soi qui provoque un rapport immédiat à la perception de son propre corps, pouvons-nous en déduire que la lecture du je provoque chez le lecteur semblable perception ?
Tout dépend de la phrase considérée. Nous pouvons dire que le lecteur a affaire à une communication mimant l’oral, s’il lit les phrases « je suis content » ou « je suis triste ». Au contraire, s’il lit une phrase comme « je suis debout » ou « j’ai les jambes croisées », cette phrase ne peut être prononcée dans le cadre d’une communication orale directe, car il serait inutile de donner une telle information à l’interlocuteur, celui-ci pouvant voir, de ses yeux, la situation corporelle de l’énonciateur. Dans le cas d’une phrase comme « je suis assis », la situation d’énonciation ne mime donc plus la communication naturelle et le lecteur est encore moins un auditeur (sauf à supposer une communication distante du type de la communication téléphonique). Il se projette désormais dans le je comme s’il s’agissait de son propre courant de conscience, certes représenté conventionnellement (car nous ne nous disons jamais « je suis assis » puisque nous le savons intuitivement), mais dans un courant de conscience qui traduirait, par la convention de la narration, le type d’information que chacun possède intuitivement sur soi-même, indépendamment de la situation d’interlocution. Nous pensons que de tels énoncés sont une représentation conventionnelle qui s’approcherait le plus possible d’une mimésis des informations intérieures qui, d’ordinaire, ne sont pas verbalisées par le sujet, mais connues intuitivement par lui, grâce à la proprioception[7]. Il faudrait peut-être introduire ici la distinction proposée par Kuroda (telle qu’elle est présentée dans l’ouvrage de ses traductions constitué par Sylvie Patron), entre les pensées dont un être peut être conscient qu’il les a et les pensées qu’il a sans en être pleinement conscient[8]. Peut-être s’agit-il en effet, dans cette représentation de la proprioception, d’états mentaux qui traversent le sujet sans qu’il en soit autrement conscient que par une autoréflexivité irréfléchie, comme S.-Y. Kuroda en fait l’hypothèse (sortes de pensées qui traversent un sujet sans qu’il se les verbalise, et que le lecteur reconstitue, comme « psycho-récit », associant à un personnage référent des prédicats de pensées non forcément consciemment sues par lui [S.-Y. Kuroda (2012)]).
On peut résumer ces remarques de la façon suivante :
* Je + présent + état interne psychique (ex. « Je suis content »), alors le lecteur est en situation de dialogue imité : il peut se concevoir comme un tu auquel s’adresse le locuteur
*Je + présent + état corporel visible (ex. « Je suis assis »), alors le lecteur n’est pas destinataire d’une information déjà possédée par sa vue, mais il s’identifie au je locuteur, parce que, dans ce mode narratif, on peut avoir l’impression qu’il s’agit d’une imitation des informations intérieures disponibles à chacun par proprioception (et non par situation d’interlocution).
Cette hypothèse peut être illustrée à partir du chapitre intitulé Isolement, dans Prison (Bon, 1999). Le texte y désigne d’abord à la troisième personne le prisonnier, décrit à la tombée de la nuit, dans le moment où, fenêtres ouvertes, les prisonniers se rassérènent après les tensions de la journée. Nous suivons les pensées et les actions du prisonnier mis en cellule d’isolement et désigné par il : « Le bruit. Il est devant la fenêtre ouverte, comme c’est le premier étage, il s’est accroupi. Mais il ne fait pas comme les autres, d’avoir dehors les jambes et les pieds. Il reste dans le noir, on ne le voit pas, il écoute » (Bon, 1999, 102). Le lecteur est confronté à une situation fictionnelle (il + focalisation interne dans « il écoute »), selon la théorie qu’en a proposé Käte Hamburger (1986) : il s’agit là d’une énonciation propre à la fiction et non d’une feintise, ce type d’énonciation ne renvoyant à aucune expérience de dialogue réel. Trois pages plus loin, cependant, le même moment est décrit par l’auteur, mais cette fois-ci à la première personne, et par le choix d’une tournure syntaxique imitative de ce qui précède : « Je suis devant les barreaux rectangulaires de fer noir et j’attends. La fenêtre est ouverte et les cris ont cessé ». Cette fois-ci, l’utilisation de la première personne, pour désigner le même personnage-focalisateur (qui devient locuteur), du présent, et de l’indication corporelle visible, dans « je suis devant les barreaux », entraîne un rapprochement inattendu opéré par le lecteur vers l’expérience vécue par le prisonnier ; le lecteur peut désormais se projeter partiellement dans ce dernier, par opposition avec le texte identique décrit plus haut, mais à la troisième personne. La proximisation, pour le lecteur, est un phénomène d’autant plus étonnant qu’elle se produit sans que le reste des tournures ni du contexte n’aient changé. Il ne peut s’agir d’une feintise de dialogue (on n’indiquerait pas à son interlocuteur où l’on se trouve : en l’occurrence ici, « derrière les barreaux »), mais d’une « traduction verbalisée » de la sensation intuitive, qu’a chacun, de son corps et de l’endroit où il se trouve (ici, le fait d’être devant les barreaux). Le je est dit par tous. Dans ce contexte, le je, lu, branche le lecteur sur la présence à soi de son propre corps.
Ainsi, l’expérience d’une intimité de soi-même, expérience de perception de son corps (liée à des verbes d’états, d’états du corps, comme à des verbes de perception, percevoir, être assis, debout…), semble rattachée par chacun à la prononciation/lecture du je, et, plus largement, est partageable par tous. Ce mode d’écriture, contrastant avec ce qui précède, provoque une proximisation puissante et induit une implication du lecteur, dans la posture décrite, sans qu’il soit nécessaire que le lecteur partage des caractéristiques ou des systèmes de valeurs avec le personnage-narrateur[9].
Mais le lecteur ne s’identifie plus, même partiellement, à un courant de conscience mental dès que l’action du je est décrite au passé : elle apparaît alors comme un récit d’événement mais non comme un partage direct d’expérience intime de soi. Il ne s’identifie pas non plus lorsque l’expérience décrite introduit une particularité de l’action ne correspondant pas aux pensées, ni au vécu du lecteur. Ainsi, page 106 de Prison : « quand j’ai tapé ça lui a cassé le nez » ne permet pas irrépressiblement de se projeter dans ce je engagé dans une action spécifique à un contexte donné, d’une part, et d’autre part, l’usage du passé composé met à distance l’action présentée comme « achevée », n’imitant plus un courant de conscience dans un reportage en direct.
On voit que l’utilisation du pronom « je » propose une actualisation variable. Ainsi, toute lecture d’une énonciation à la première personne induit une identification à une situation d’auditeur, mais parfois aussi une identification minimale à un je percevant (perception interne de soi-même, ou perception externe, comme imitation d’une réelle perception visuelle et auditive, ainsi que chez Christian Metz le dit du spectateur de cinéma). À suivre ces deux propositions, on voit qu’existe même dans L’Étranger de Camus une implication minimale du lecteur : là où le lecteur ne s’identifie ni à la psychologie (elle est absente), ni aux actions (un meurtre n’est pas une expérience partagée par tous), il s’identifie au moins à la voix et au point de vue, dans le cas d’une énonciation de perceptions par le locuteur.
Deux conclusions peuvent être tirées de ces remarques. La première est que partager le je de la voix narrative (accompagné de verbes de perception ou d’état, au présent), au cours de la lecture d’un texte en première personne, c’est aussi partager la vision : dans ce cas, voix et focalisation narratives sont confondues dans un mode narratif que le lecteur investit directement. La deuxième est plus générale : dans un texte recourant à un narrateur/personnage fantomatique à la première personne, la lecture induit pourtant le recours à une identification partielle, non à un sujet total. Le lecteur devient le support du sujet du récit, selon un processus fragmentaire, celui de l’identification partielle à une instance énonçante.
Mais outre la proximisation lectorale par immersion dans un courant de conscience, soit comme penseur, soit comme auditeur témoin, une immersion plus totale peut avoir lieu, grâce à la participation feinte à un contexte fictif, à un lieu et à un temps évoqués, potentialités liées au fonctionnement de notre mémoire épisodique qui permet un voyage imaginaire dans l’espace et dans le temps, passé, futur ou hypothétique. Or, ce voyage lectoral est rendu possible par la capacité à relier de façon autonoétique, par une conscience de soi immédiatement traduite en immersion, les lieux et les temps traversés par le moi.
IV. L’imaginaire permet le déplacement, le voyage, d’un corps fictif dans l’espace et dans le temps
Une telle supposition converge avec celle de Käte Hamburger. Dans Logique des genres littéraires (1986), elle montre que c’est un lecteur comme je-origine fictif qui se projette dans la description de la maison des Buddenbrook, parce que la description l’implique grâce à l’usage du pronom « on » (servant de support corporel au lecteur percevant) et à l’expression « à main gauche » (qui désigne le lieu où se projette le corps support) : sans s’identifier complètement à un personnage et sans être capable de « voir » vraiment ce qui lui est décrit, le lecteur se figure grossièrement par un corps imaginaire les différents espaces décrits. Elle écrit : « c’est le je-origine de chaque lecteur qui se trouve sollicité : il peut alors se construire une représentation de la pièce en partant de sa propre image corporelle » (123). La question est cependant celle du degré de concrétude de ce corps imaginaire. Est-il vrai que le lecteur projette son corps dans la fiction ou simplement qu’il imagine un je origine fictif ?
Réponse controversée selon les auteurs. Un tel débat a été proposé, en particulier par Reuven Tsur, théoricien de la poésie. Tsur critique l’idée que la poésie inciterait le lecteur à projeter un corps imaginaire à l’intérieur du texte via les centres déictiques tels qu’ils ont été définis de façon détaillée par Stockwell (2002). Il est cependant d’accord avec David Miall pour dire que l’usage du pronom je a un impact sur le lecteur : « Considérons la question de David Miall : ‘est-ce que la deixis cognitive positionne le lecteur en relation avec les points de vue offerts par le récit [ou le poème] ?’ L’analyse qui s’ensuit suggère : ‘Oui, probablement’ »[10]. Et Tsur, comme nous, semble partager cet avis, bien qu’il ne le trouve pas suffisant.
Car, Tsur insiste sur le fait que, dans beaucoup de cas, la poésie met en place des usages d’indexicaux sans pourtant que ces indexicaux aient un caractère d’orientation corporelle précise, comme par exemple dans ce poème de Nathan Alterman. Là, la deixis est dégagée d’une aptitude à mettre en place la désignation précise d’une référence :
This night.
The estrangement of these walls.
A war of silences, breast to breast.
The cautious life
Of the tallow candle[11].
En effet, au lieu d’écrire : « ces murs étranges », le poète a choisi de donner une densité à « l’étrangeté », en lui conférant le rôle de thème de la phrase : « l’étrangeté de ces murs ». Ainsi, les adjectifs sont transformés en noms (« étranger » devient « étrangeté ») et les noms sont manipulés pour devenir des lieux référentiels. Ainsi, ce ne sont plus les objets concrets qui sont au centre du message, mais leurs caractéristiques, leurs attributs qui n’ont pas de « forme visuelle stable et caractéristique »[12]. Certes, deixis il y a, comme en témoigne l’usage du démonstratif « cette », « ces » (« cette nuit », « l’étrangeté de ces murs »). Mais les deixis ont plutôt ici valeur autre que d’orientation spatiale du corps du lecteur, selon Tsur qui conteste l’implication d’un corps du lecteur : il s’agit d’une densification, d’un épaississement des prédicats d’étrangeté devenus concrets, comme si l’étrangeté était devenue elle-même un objet précis. L’usage du déictique, dès lors, selon Tsur, ne serait pas de poser une orientation du corps propre du lecteur dans l’espace, mais de donner un poids de réalité aux qualités, aux expériences psychiques (ici, l’étrangeté), de les actualiser en tant qu’expériences psychiques, comme si elles étaient réellement matérielles, mais non pas en tant qu’expériences où le corps se situerait dans un espace et un temps précis. L’actualité de la sensation surgit, mais détachée de la perception du corps propre comme d’un corps unifié.
Or, tout dépend du texte considéré. Si nous sommes d’accord avec Tsur pour dire que certains textes ont un rapport aux déictiques désancré d’une réalité référentielle du corps du lecteur (comme le texte à résonance mystique choisi ci-dessus), cependant d’autres textes permettent d’impliquer un je-origine, même fictif, dans une représentation de l’espace que se fait le lecteur, même parcellaire.
Le concept de « centre de deixis » permet d’appuyer nos propositions. Pour caractériser l’embrayage lectoral, les deux linguistes David Zubin et Lynne Hewitt (voir Duchan et al., eds, 1995) recourent au concept de « centre de deixis », qu’ils définissent comme étant les coordonnées spatiales, temporelles et psychologiques du personnage focalisateur de la perspective. Selon eux, il existe une dissynchronie entre Qui et Où utilisés tout au cours de la fiction. Le Qui représente un individu ou un groupe qui voyage(nt), tandis que le Où est à la fois lieu de destination finale et les lieux par où les personnages passent tout au cours de leur trajet. Or, ce qui permet la dynamique de l’action est ce perpétuel changement du Où tandis que le Qui demeure structure stable, comme si les différents lieux que le(s) sujet(s) serai(en)t amené(s) à traverser étaient déjà présents dans le texte de la fiction. Ainsi existe une dissynchronie entre le sujet et le lieu, qui permette d’expliquer que le lecteur soit capable de s’imaginer un lieu fictif où il n’est pas, mais qui soit tout de même défini par un corps, sujet potentiel présent en ce lieu.
Dans le même ouvrage, David Mark et Michael Gould, prouvent que les deixis de lieux lus ou dits sont perçus par les sujets en fonction de leur propre corps (voir Duchan et al., eds, 1995). Dans une expérience réalisée en sous-sol de supermarché, ils ont montré que les personnes à qui on demandait des indications pour se rendre à tel endroit, étaient capables de projeter leur corps mentalement hors du parking souterrain où elles étaient pour conseiller à leurs interlocuteurs d’aller « à main droite », « devant vous », autant d’expressions indexicales qui permettent de projeter en esprit, de mentaliser, une situation corporelle imaginaire différente de la situation corporelle réelle (on donne une indication à quelqu’un à partir de son propre corps au sujet de l’espace qu’on se représente mais où l’on ne se trouve pas). En somme, les centres déictiques corporels peuvent être nombreux et différents, et pourtant, ils permettent aux individus — et nous dirons, donc, aux lecteurs — de se projeter ailleurs que dans leur emplacement corporel réel. Aussi serait-il envisageable que le lecteur investisse partiellement un espace à partir d’un je origine fictif qui lui permette de projeter un corps imaginaire dans un lieu décrit : nous ne suivrons donc pas ici Tsur. Quel degré de concrétude ce corps spatial a-t-il ?
Tsur rappelle les constats suivants. Des chercheurs en neuroscience ont travaillé sur les états cérébraux des moines et des religieux lors des expériences de prière ou des expériences mystiques : ils ont montré (par tomographie par émission de positrons) que ces états de méditation (l’expérience a lieu chez les méditateurs tibétains et des nonnes franciscaines) semblaient être corollaires d’une désactivation de la partie du cerveau qui concerne la conscience spatiale du corps actuel, l’aire d’orientation située dans l’hémisphère gauche et qui serait reliée à la sensation mentale d’un corps limité et défini autour d’un moi. Mais ils ont montré que l’aire d’orientation de l’hémisphère droit, celle qui donne les coordonnées matricielles de l’espace dans lequel le corps peut se mouvoir (délimitant ainsi le lieu plus ou moins virtuel), continuait à être active pendant la méditation et la prière. L’aire gauche serait occupée à bloquer les informations venant du canal sensoriel relevant du corps propre, tandis que l’effort d’attention porté par les religieux méditant rendrait très active la perception mentale imaginaire de « l’objet » intellectuel ou matériel permettant de motiver la prière ou la méditation. Ce sont ces effets et ces impressions, sans formes, qui prennent le dessus sans doute aussi, dans la lecture dans la poésie méditative où les attaches au moi sont coupées, et où demeurent de simples orientations dans un espace imaginaire. On passerait dès lors en mode d’orientation diffus[13]. C’est pourquoi Tsur pense que le lecteur n’active pas de corps imaginaire.
Je prendrais, quant à moi, la position inverse. Il est en effet vraisemblable qu’une expérience méditative ou imaginaire, désactive partiellement la présence à soi du corps réel (ce dont nous faisons l’expérience quand nous sommes captivés par un livre et ce que Jean-Marie Schaeffer a appelé le désamorçage des réactions pragmatiques). Cependant, que le corps réel soit désactivé ne signifie pas que la capacité à projeter un corps imaginaire soit inactivée, comme en témoignent aussi bien l’expérience des religieux que les expériences pouvant donner lieu à des promenades imaginaires et spatiales virtuelles, suscitées par le discours.
Dans le domaine temporel également, des embrayeurs et des tactiques d’énonciation permettent de créer une véritable ubiquité du lecteur. Marcel Vuillaume, dans Grammaire temporelle des récits, montre que l’utilisation du présent de narration par Alexandre Dumas, dans Les Trois Mousquetaires, induit une présence du lecteur en de multiples temps et lieux à la fois : avec le narrateur qui le prend à témoin et, en même temps, avec les acteurs du duel qui se déroule, sous les yeux fictifs du lecteur. « Un jeune homme… – traçons son portrait d’un seul trait de plume : figurez-vous don Quichotte à dix-huit ans, don Quichotte décorcelé, sans haubert et sans cuissards », place le lecteur en concomitance avec le locuteur narrateur. Mais peu après, le lecteur est contemporain du duel, alternant ainsi la place de confident du locuteur-narrateur et celle de témoin « visuel » des exploits de D’Artagnan (Vuillaume, 1990). L’implication imaginaire du lecteur se fait par points de capiton : celui-ci se projette en un lieu, et en un temps, voire en plusieurs temps contradictoires en même temps, même sans identification totale avec un personnage. D’où l’hypothèse que le lecteur réel soit capable de se pourvoir, un temps, d’un corps imaginaire mobile, d’un esprit et de capacités perceptives virtuelles qu’il endosse pendant sa lecture.
Conclusion
Dès lors se profile l’hypothèse, selon laquelle le récit et la fiction en prose, parce qu’ils utilisent le langage de l’expérience humaine, et par là, les déictiques qui renvoient à la proprioception de soi, ou à la localisation d’un soi, permettent la projection d’une conscience lectorale qui soit aussi un corps imaginaire, voyageant dans un univers fictif ou réaliste.
A travers le « je » habitable par tous (comme nous l’avons vu en suivant les démonstrations de François Récanati), à travers les embrayeurs de lieu qui incitent à promener un corps imaginaire (selon Deixis in narrative et les travaux de Käte Hamburger), et l’usage des temps multipolaires présentés par Marcel Vuillaume, expliquant l’ubiquité du lecteur, les analyses fondées sur la philosophie du langage et la pragmatique tendent à étayer l’hypothèse selon laquelle le lecteur projette un corps imaginaire, et non seulement un esprit, lors de l’immersion dans sa lecture dans un espace créé à partir d’un corps propre, surtout quand lui sont donnés à lire des déictiques de première personne ou des coordonnées spatiotemporelles égo-centrées. D’où la force de la littérature et la capacité qu’elle aurait à permettre la mise en jeu du lecteur, dans son imaginaire total, à l’intérieur d’un univers et d’un espace.
La perception interne de son moi comme ego ayant une proprioception de son propre corps, arrime la référence d’un je à l’énonciateur. Nous faisons l’hypothèse que cette proprioception est transcendante et antérieure à l’usage du pronom de première personne, suivant en cela Récanati, et non les propositions de Benveniste ni de Descombes. Aussi se peut-il que la construction d’un discours intérieur ne soit possible pour celui qui le crée qu’à partir de cette existence d’un « ego ».
Si ce moi ne s’est pas constitué de manière paisible, comme c’est le cas pour les prisonniers de l’atelier d’écriture que fait travailler François Bon dans Prison et dont la vie psychocorporelle a été troublée dès le plus jeune âge, alors l’espace externe constitue le moi, tout autant que celui-ci est constitué comme corps propre. Le prisonnier existe en fonction de son lieu d’origine et se remplit par sa détermination sociale : son intériorité se définit de l’extérieur parce qu’il vient de telle « cité », de tel quartier de la ville. Ce n’est alors qu’en prenant la parole (et particulièrement en première personne) que se construit pour lui un discours intérieur et une vie intérieure, qui priment sur le rattachement du moi à l’espace.
Du point de vue du lecteur, au contraire, et si le lecteur n’a pas subi de traumatisme dans la construction de son moi, la lecture a été décrite comme une capacité à la projection d’un corps-esprit dans des espaces et dans des lieux, à partir des considérations linguistiques fondées sur les embrayeurs de personnes, de lieux et de temps.
Une des spécificités du texte littéraire, dans son jeu avec ces déictiques, est que la perception du lecteur devient configuration d’un voyage imaginaire et de modes d’être dans l’espace, constitué à partir d’un discours centré sur une « je ». Le discours intérieur permet alors l’imagination de sensations et la projection d’un espace. Ainsi, lire permet de vivre une situation en réalité virtuelle.
À propos de l’auteur
Maîtresse de conférences HDR à l’université Bordeaux Montaigne, Béatrice Bloch a publié deux ouvrages sur le roman contemporain (1998) et le récit poétique contemporain (2017). Elle est également l’auteur de nombreux articles sur la fiction contemporaine, la lecture, la théorie du cinéma, la poésie contemporaine et l’imaginaire littéraire. Elle est spécialiste de Claude Simon, Julien Gracq, Chloé Delaume, Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Marie-Claire Ropars-Wuilleumier. Elle dirige depuis 2017 le département des lettres.
Ouvrages cités :
Baroni R., La Tension narrative ; suspense, curiosité, surprise, Paris, Seuil, 2007.
Benveniste É., Problèmes de linguistique générale, Tome I, Paris, Gallimard, 1958.
Bloch B., Une lecture sensorielle, le récit poétique contemporain, Gracq, Simon, Kateb, Delaume, Rennes, PUR, 2017.
Bon F., Prison, Lagrasse, Verdier, 1997.
Charolles M., « Lecture et identification des personnages dans les récits de métamorphose », in La lecture littéraire, n° 1, Paris, Klinksieck, nov 1996, p. 125-159.
Cohn D., Le Propre de la fiction, traduit de l’anglais par Claude Hary-Schaeffer, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2001.
Descombes V., Les Institutions du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1996.
Duchan F., Bruder G.A., Hewitt L. E. (eds), Deixis in Narrative, a Cognitive Science Perspective, New Jersey, éd. Erlbaum Associates Inc., 1995.
Genette G., Figures III, Paris, Seuil, coll. « Poétique »,1972.
Hamburger K., Logique des genres littéraires (1977), Paris, Seuil, 1986.
Jacob P., « Sémantique et psychologie : la sémantique des attributions de croyance », Recherches sur la philosophie et le langage, Cahier du groupe de recherche sur la philosophie et le langage, département de philosophie, Université de Grenoble II, UA1230 CNRS, Vrin, 1989, p. 181-211.
Jouve V., L’Effet-personnage dans le roman, Paris, PUF, 1992.
Kuroda S.-Y., Pour une Théorie poétique de la narration, Introduction de Sylvie Patron, Paris, Armand Colin, 2012.
Mark D.M. et Gould M.D., « Wayfinding Directions as Discourse », in F. Duchan, Gail A. Bruder, Lynne E. Hewitt, Deixis in Narrative, a Cognitive Science Perspective, New Jersey, éd. Erlbaum Associates Inc., 1995.
Metz C., Le Signifiant imaginaire (Psychanalyse et cinéma) (1977), Paris, UGE, 1993.
Metz C., L’Énonciation imaginaire ou le site du film, Paris, éditions Klinscksieck, 1991.
Récanati F., « Contenu sémantique et contenu cognitif des énoncés », Introduction aux sciences cognitives, Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1992, p. 239-271.
Recanati F., Direct Reference : From Language to Thought, Oxford, Blackwell, 1993.
Ricœur P., Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990.
Stockwell P., Cognitive Poetics — An Introduction, London/New York, Routledge, 2002.
Tsur R., Toward a Theory of Cognitive Poetics, Brighton, Portland, Sussex Academy Press, 2008.
Vuillaume M., Grammaire temporelle des récits, Paris, Éditions de Minuit, 1990.
Wheeler M.A., Stuss D.T., Tulving, E. , « Toward a Theory of Episodic Memory : Frontal Lobes and Autonoetic Consciousness », Psychological Bulletin, Washington, American Psychological Association, Vol. 121, N° 3, 331-354, 1997.
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XVIII
[1] Un état de conscience dit « autonoétique » offre à l’individu la capacité de se voir soi-même « voyager mentalement dans le temps », de se représenter consciemment les événements passés et de les intégrer à un projet futur (Wheeler, Stuss et Tulving, 1997). La conscience autonoétique donne la possibilité à l’individu de prendre conscience de sa propre identité dans un temps subjectif (le « Self ») qui s’étend du passé au futur et lui offre une impression subjective du souvenir (Tulving, 1995 ; Wheeler et al., 1997). Ainsi, lors de la récupération d’un souvenir épisodique, la conscience autonoétique permet la reviviscence consciente de l’événement.
[2] Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Tome I, 1958, p. 259 : « Or cette “subjectivité”, qu’on la pose en phénoménologie ou en psychologie […], n’est que l’émergence dans l’être d’une propriété fondamentale du langage. Est “ego” qui dit “ego” ».
[3] C’est moi qui souligne les sujets.
[4] Voir le débat où il reproche à Lévi-Strauss de croire que toute société est fondée sur le partage de destins entre individus qui se retrouveraient dans la même situation et non sur l’application de la loi sociale à des individus aux rôles fonctionnellement différents dans la société (Les Institutions du sens, p. 264-266).
[5] C’est moi qui souligne.
[6] Christian Metz, dans Le signifiant imaginaire, écrit p.119: « Il ne s’agit pas ici de l’identification du spectateur aux personnages du film (elle est déjà secondaire), mais de son identification préalable à l’instance voyante (invisible) qu’est le film lui-même comme discours, comme instance qui met en avant l’histoire et qui la donne à voir ». C’est d’autant plus le cas si l’instance voyante est aussi un sujet.
[7] De tels modes d’assertions correspondraient peut-être à ce que Dorrit Cohn appelle « psycho-récit » ou à ce que Genette, dans Figures III, trouvait problématique à rendre, de manière mimétique, par la narration : « le récit de pensées », cf. Figures III, p. 189 sq.
[8] Introduction par Sylvie Patron au texte de S.-Y. Kuroda, Pour une Théorie poétique de la narration, Armand Colin, 2012.
[9] Raphaël Baroni, La Tension narrative ; suspense, curiosité, surprise. Paris : Seuil, 2007, p. 269 : on peut éprouver un suspense primaire par empathie avec un personnage repoussoir, et connoté négativement, dans lequel on ne fait que se projeter partiellement et non s’identifier.
[10] « Consider David Miall’s question : ‘does cognitive deixis position the reader in relation to the points of view on offer in a narrative [or poem]’. The ensuing analysis suggests : ‘probably yes’ », in Reuven Tsur, Toward a Theory of Cognitive Poetics, Brighton and Portland : Sussex Academic Press, 2008, p. 610 (ma trad.).
[11] « Cette nuit. / L’étrangeté de ces murs. / Une guerre de silences, poitrine contre poitrine. / La vie précautionneuse / de la chandelle de suif » (je traduis la traduction anglaise donnée par Tsur), cité par Reuven Tsur, Toward a Theory of Cognitive Poetics, Brighton and Portland : Sussex Academic Press, 2008, p. 610.
[12] « Thus, […] not the concrete objects are manipulated into the psychological centre of the message, but their attributes that have no stable characteristic visual shapes », Reuven Tsur, Toward a Theory of Cognitive Poetics, p. 611.
[13] Reuven Tsur, Toward a Theory of Cognitive Poetics, op. cit., fait ici allusion, dans les pages 613 à 615, à l’expérience menée par Andrew Newberg, Eugene d’Aquili, et Vince Rause, et rapportée dans Why God Won’t Go Away : Brain Science and the Biology of Belief, New York : Baltimore Books, 2001.