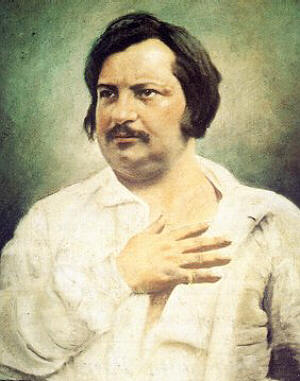Aussi proverbiale soit-elle, la place qu’occupe l’argent au sein du roman réaliste a longtemps fait l’objet d’un relatif impensé. On en décrit les manifestations thématiques et les figures stéréotypées, on souligne la lucidité d’auteurs dénonçant le Veau d’or tout en sacrifiant, le cas échéant à quelques poncifs, mais on ne s’interroge pas vraiment sur les raisons pour lesquelles le roman fut à ce point (pré-)occupé par l’argent, à la fois obsédé par le schème monétaire et quasi-militairement envahi par les réalités économiques.
La tradition critique – et l’on ne peut que saluer le rôle fondateur que jouèrent les analyses de Pierre Barbéris – a mis en évidence une série de facteurs aujourd’hui bien connus pour expliquer cette saturation. Le XIXe siècle est la période d’assomption du capitalisme, mouvement qui voit à la fois exploser les échanges économiques et financiers et se développer une doctrine économique qui, entre théorisation et réification des valeurs libérales, concourt à la promotion et à la vulgarisation d’une doxa bourgeoise… Le récit réaliste ne peut bien entendu pas rester indifférent à ces nouvelles réalités dont il est d’autant plus enclin à rendre compte que les romanciers sont eux-mêmes confrontés à de nouvelles réalités éditoriales liées à l’entrée de la littérature dans l’ère industrielle[1]. Comme le montre Illusions perdues, le commerce de la librairie souffre particulièrement d’un manque endémique de liquidités qui frappe d’ailleurs l’ensemble de la société[2]. Les auteurs sont ainsi quotidiennement conduits à manipuler des billets à ordre, lettres de change et autres effets fiduciaires qui s’imposent comme autant de monnaies de substitution, toutes moins fiables les unes que les autres. De ce fait, ils expérimentent dès les années 1820-30 la financiarisation précoce des échanges qu’impose le recours massif à des monnaies-papier extrêmement volatiles, ce qui leur confère un savoir-faire économique et juridique inédit. Facteur de précarité, le « modèle économique » régissant la librairie n’est pas dépourvu de conséquences esthétiques et éthiques puisque les auteurs doivent non seulement se rendre à l’évidence que leurs œuvres sont devenues des biens marchands, mais également accepter que la valeur de leurs productions soit désormais soumise aux fluctuations purement nominales d’une monnaie qui ne reflète parfois pas la valeur du bien échangé – l’Œuvre – mais la valeur des partenaires de l’échange. Qu’on songe aux écrits de Lucien de Rubempré dont le libraire reconsidère le prix, à la baisse, à mesure qu’il gravit les escaliers qui le mènent à la pauvre soupente du grand auteur, chacun des paliers démonétisant un peu plus l’auteur et son œuvre.
Mais si ces éléments créent un contexte propice à la thématisation de l’objet monétaire et expliquent le nouvel intérêt littéraire de l’argent, ils s’inscrivent toujours dans une perspective ou une thèse immersive qui cantonne la littérature dans une fonction de chambre enregistreuse. Ils ne permettent pas de comprendre pourquoi la littérature, en tant que telle, est conduite à se saisir de l’argent. Bien que cela puisse paraître paradoxal, cette question ne nous semble pouvoir être abordée sans opérer au préalable un détour par les configurations discursives du premier dix-neuvième siècle. Il convient notamment de considérer les discours et prétentions hégémoniques de la jeune science économique libérale qui revendique, à l’orée du XIXe siècle, une nouvelle légitimité. Compte tenu du rôle que joue désormais la production et la circulation des richesses dans la conduite des affaires, l’économie s’estime porteuse d’une représentation du monde qu’il s’agit de faire prévaloir sur les autres discours scientifiques. Or, cette prétention à la fois descriptive et prescriptive peut être considérée comme une menace, voire une concurrence par une littérature réaliste qui a également vocation à dire et prédire les évolutions de la société. Cette situation de rivalité peut ainsi déterminer le comportement d’auteurs désireux, plus ou moins consciemment, de faire prévaloir une représentation de l’homme différente de celle que promeut – avec une très forte cohérence – la théorie économique classique. Il ne s’agit pas simplement de dénoncer les méfaits de l’argent-roi et du capitalisme, mais plus fondamentalement, de critiquer les fables sur lesquelles se fonde la théorie économique. Comme si cette jeune science usurpait les fonctions de la fiction pour expliquer ses constructions théoriques et, surtout, pour donner corps aux conceptions idéales-typiques de l’homo œconomicus nécessaires au fonctionnement de son modèle.
Serait donc moins en cause, ici, la nécessité contextuelle de traiter d’un nouveau phénomène, que de réaffirmer le rôle de la fiction dans sa capacité distinctive à dire le monde. Autrement dit, la place exorbitante prise par l’argent dans le roman ne devrait pas seulement s’appréhender à l’aune d’une saturation sémantique et lexicale qui ne saurait être qu’un symptôme, mais devrait faire l’objet d’une lecture formelle et poétique établissant la manière dont l’argent devient une forme agissante du récit du siècle réaliste. Ceci conduit donc à forger l’hypothèse de l’apparition d’un « sous-genre fiction économique » réunissant un certain nombre de traits structuraux. Il va de soi qu’à ce stade de nos recherches, ce concept de « sous-genre » ne saurait avoir d’autre rôle qu’heuristique. On conviendra en effet, d’une part, qu’il s’agit d’une notion qui, au sein même de la théorie des genres, reste aléatoire et peu rigoureuse, fragilité intrinsèque que la généralité du terme « économique » accroît encore. Ce dernier recouvre en effet des réalités conceptuelles distinctes (argent, monnaie, crédit, don, spéculation…) qu’il s’agit d’autant plus de distinguer qu’ils engendrent eux-mêmes une diversité de récits selon que l’on considère la fiction écrite par les économistes (apologue, robinsonnade…) ou la fiction littéraire qui peut elle-même se décliner en récit de fortune, récit de ruine, épopée commerciale ou financière (particulièrement représentée dans le monde anglo-saxon), roman du crédit, roman du travail…
Mais cette diversité de récits économiques montre bien que le premier XIXe siècle – auquel nous cantonnerons nos analyses, de Balzac au roman populaire du milieu du siècle[3] – organise les conditions d’une rencontre entre les deux discours de l’économie et du réalisme romanesque. Le sous-genre « fiction économique » illustrerait la congruence entre les formes nouvelles de l’économie et une forme romanesque en forte mutation. Étudier la « nécessité romanesque de l’argent » implique donc une analyse poétique, qui tienne ensemble les mutations idéologiques et la question formelle. C’est sans doute à ce prix, en analysant la manière dont sont mises en textes les formes de l’échange monétaire moderne – les mécanismes, mais aussi les sèmes discursifs libéraux (conceptions de l’homme, dispositifs et valeurs…) – que l’on pourra peut-être saisir quelque chose de la littérarité de l’argent.
I. Les fondamentaux libéraux du récit réaliste
La vulgate oppose volontiers les discours littéraires et économiques en mettant en évidence leurs différences voire leur étrangeté radicale. Ce stéréotype, que dénonce la fin des Mots et les choses, constitue sans nulle doute une construction idéologique qui masque les gémellités ou les voisinages qu’entretiennent deux formes discursives qui, parce qu’elles procèdent d’une même modernité, relèvent de paradigmes identiques. Il est ainsi possible d’identifier quelques-uns des principes fondamentaux de la théorie libérale à l’œuvre au sein du récit réaliste, « motifs » d’autant plus facilement intégrés qu’ils rencontrent la poétique romanesque en cours d’élaboration. Le premier de ces principes repose bien entendu sur la conception moderne d’un individu rationnel qui, dans un rapport d’égalité avec ses semblables, peut librement poursuivre ses intérêts. Cette théorie est d’ailleurs doublement intéressante puisque, premièrement, la tradition philosophique élabore, à partir de la fin du XVIIe siècle, l’idée selon laquelle la poursuite de l’intérêt libère l’homme de ses mauvaises passions ou tout au moins lui permet de les canaliser. Développée dans le cadre d’une réflexion politique générale par Montesquieu – le « doux commerce » – elle culmine chez Hume qui « salu[e] dans le capitalisme une force capable de mobiliser certaines inclinations bienfaisantes de l’homme aux dépens de certains de ses mauvais penchants – dans l’espoir que, d’une façon ou d’une autre, cette force parviendra à refouler, voire à atrophier complètement, ce que la nature humaine recèle de plus destructif et de plus dangereux »[4]. Mais par-delà sa traduction politique, la théorie de l’intérêt fonde bientôt la fameuse « main invisible » d’Adam Smith qui montre dans La Richesse des nations que cette libre recherche du profit individuel se justifie sur le plan économique puisque « le meilleur moyen d’assurer le progrès (matériel) d’une société est de laisser chacun de ses membres poursuivre comme il l’entend son intérêt (matériel) propre »[5]. Dans un contexte post-révolutionnaire où « l’épicier devient certainement pair de France »[6], ce nouvel homo œconomicus entre bien entendu en congruence avec le personnage romanesque qu’invente le roman. L’« épopée de la mobilité sociale » que constitue selon Karlheinz Stierle La Comédie humaine[7] érige le personnage en réservoir de possibles. Pour Lukàcs, c’est même le roman réaliste qui implique, dans sa forme même, la mise en scène d’un « héros problématique » auquel l’indétermination axiologique offre une pluralité de destinées.
Le roman balzacien n’adhère cependant pas à la croyance libérale en un pouvoir libérateur de l’intérêt car il ne cesse de montrer, au gré des combinatoires actantielles, combien l’intérêt se nourrit des passions, combien les passions s’actualisent dans la recherche de l’intérêt pécuniaire. L’un des leitmotive de La Comédie humaine – explicitement affiché par l’Avant-propos – repose précisément sur le fait que les hommes sont agis par ces deux forces impossibles à distinguer voire à hiérarchiser[8]. Non seulement l’intérêt ne jugule pas les passions, mais il les aggrave potentiellement[9], réalisme spinoziste qui rejoint les interrogations de Jean-Pierre Dupuy : « comment pourrait-il y avoir concurrence s’il n’y avait pas rivalité et comment pourrait-il y avoir rivalité s’il n’y avait pas désir fouetté par la rivalité ? […] Dès lors que le désir entre en scène, toutes les mauvaises passions accourent sur le plateau »[10].
Se dessinent ici les conditions d’un malaise fondamental du roman réaliste qui « hérite » d’un type individualiste moderne et dépeint les progrès de l’intérêt… tout en ne croyant pas à la fiction heuristique de l’intérêt. Mais si Balzac ou Stendhal ne cessent de souligner l’inefficience morale de la conduite intéressée, sa toxicité psychologique et éthique, ils sont, dans le même temps, bien « obligés » d’en reconnaître l’efficacité économique. Le narrateur des Petits Bourgeois, analysant les mérites respectifs du prêt gratuit charitablement consenti par Popinot et du prêt usuraire pratiqué par l’horrible Cérizet, se rend à l’évidence : « Chose étrange, bonne à étudier d’ailleurs, l’effet produit, socialement parlant, ne différait guère »[11]. Les incises qui retardent et modalisent l’énonciation de cette maxime disent assez la surprise d’un narrateur qui ne peut que constater la séparation irréductible du moral et de l’économique.
En reconnaissant l’efficacité de mécanismes concurrentiels qu’il peut critiquer sans pour autant les invalider, le récit réaliste rallie en quelque sorte ce que nous appelons aujourd’hui le « marché auto-régulé ». L’œuvre de Souvestre est de ce point de vue paradigmatique[12]. L’Homme et l’argent (1859), un de ses récits les plus connus, met en scène la lutte que se livrent l’industrieux Severin et le banquier Gaillot. D’un côté, le modèle saint-simonien du patron vertueux, inventif et respecté, qui a su bâtir à la sueur de son front une industrie papetière rentable. De l’autre, l’homme du capital, aguiché par la prospérité de ladite industrie, qui mobilise sa fortune pour créer une entreprise concurrente qui tuera et dépouillera Severin. Bien que la problématique économique se voie superposer une intrigue amoureuse, ce roman se donne comme une thématisation du principe concurrentiel. La négociation des deux hommes s’opère en effet sur fond d’une axiomatique que n’auraient pas désavouée les traités de l’époque :
« Allons donc, dit Gaillot en riant, c’est de la concurrence, et de la meilleure. En définitive, notre lutte tournera au profit de tous puisque le bon marché qui nous ruinera enrichira les consommateurs ; c’est un des principes élémentaires de l’économie politique ; vous comprenez cela aussi bien que moi ».
Severin peut bien dénoncer cette conception de la concurrence —
« Ne consultez que les chiffres, j’y consens, puisque les économistes ont fait de notre société un grand corps sans âme dans lequel circule de l’arithmétique au lieu de sang ; avez-vous réfléchi à tous les capitaux improductivement anéantis dans ces concurrences, à toutes les forces inutilement employées en chocs et en résistance, à toutes les ressources gaspillées par une exploitation sans prévoyance et sans liberté, à toutes les crises enfin qui arrivent tôt ou tard ruinant le crédit, dérangeant l’équilibre des richesses et rejetant au flot de la vie mille destinées qui se trouvaient au port ? » [13]
— il n’en reste pas moins que le récit n’offre d’autre horizon productif que l’exercice de d’une rivalité concurrentielle apparaissant comme la seule vraie puissance de changement, quels qu’en fussent les conséquences et dégâts humains ou sociaux.
Le second grand principe réside dans le rapport, typiquement moderne, que le libéralisme économique entretient au temps. Par-delà le proverbial adage de Smith time is money, le libéralisme instaure, corollairement à ses conceptions de l’individu rationnel et entreprenant, la linéarité indéfinie du temps comme condition du développement et du progrès. Ainsi, pour Jean-Pierre Dupuy, « une condition nécessaire pour que l’opération [capitaliste] réussisse est que l’économie croie qu’elle dispose d’un avenir indéfiniment ouvert. Si l’avenir était fermé et que le terme en fût connu, un effet de domino rétrograde réduirait dès aujourd’hui toute activité à zéro. À l’approche du terme, aucun crédit ne serait possible puisqu’il y aurait pas d’avenir pour le remboursement, et la valeur de la monnaie serait nulle puisque personne ne l’accepterait en paiement »[14]. Cette linéarité – qui rompt avec la cyclicité de l’époque pré-moderne – est la condition de possibilité d’une narration qui, affranchie du temps circulaire de l’épopée, peut envisager son déploiement et construire des parcours qui semblent indéfiniment ouverts sur le futur, à l’instar des trajectoires dynamiques – mises en scène sur plusieurs romans – par Balzac (Nucingen, Rastignac…) ou Zola (Saccard)[15]. Cette temporalité ouverte est d’autant plus importante que le roman du XIXe siècle se donne comme le récit prospectif d’une société en train de se faire et de s’écrire. Le réalisme littéraire, par-delà sa stricte fonction descriptive, est une écriture de la possibilité qui dans sa compréhension du hic et nunc préfigure les évolutions de la société moderne. Cette posture fait en quelque sorte écho à la grande question de l’anticipation qui hante l’économie libérale. Qu’il s’agisse de modèles théoriques ou de plans d’affaires, économistes ou entrepreneurs doivent supposer les comportements humains prévisibles, faute de quoi il serait impossible de faire les bons paris et de grossir le mouvement des affaires. Science morale, l’économie repose sur les fictions comportementales – à commencer par la fable de l’homo œconomicus – nécessaires au développement de ses modèles. À ce titre, elle ne fait pas moins concurrence au roman que Balzac ne concurrençait l’état-civil.
Le troisième et dernier principe réside dans la logique contractualiste qui se déploie aussi bien dans les sphères économique que politique. En effet, c’est parce que les hommes sont égaux entre eux et agissent librement à la lumière d’une raison universelle, qu’ils sont en mesure de contracter. Balzac a beau dénoncer ce qui lui apparaît comme une monstruosité, il n’en reconnaît pas moins la continuité qui lie la Charte octroyée par Louis XVIII et le contrat économique. L’un et l’autre sont nés d’une même plaie – l’égalité – et engendrent les mêmes maux : la course à l’argent. Ainsi le narrateur de Splendeurs et misères des courtisanes estime-t-il que « le mal vient, chez nous, de la loi politique. La Charte a proclamé le règne de l’argent, le succès devient alors la raison suprême d’une époque athée »[16]. L’égalité se déploie d’ailleurs plus efficacement et de manière plus visible en économie qu’en politique, car elle s’appuie sur le rôle neutralisant de l’argent qui, comme l’a montré Simmel dans sa Philosophie de l’argent, permet d’objectiver les relations humaines, quelles que soient les différences de statut caractérisant les partenaires de l’échange. Le contrat économique est prodigieusement efficace car, médiatisé par l’équivalent général, il permet de tout acheter tout en libérant absolument, une fois la transaction achevée, le vendeur et l’acheteur de tout engagement. On peut, comme Faust, regretter que l’époque moderne « ne reconna[isse] que l’empire de la cire et du parchemin » en congédiant la confiance et le serment, le contrat économique et commercial n’en reste pas moins un outil de désaliénation. Là où le don d’Ancien Régime entraînait des rapports de dépendance qui survivaient à l’échange, la monnaie moderne est censée briser les chaînes des partenaires et, bien entendu, considérablement développer les échanges. Le roman ne peut que se repaître des dialectiques nouvelles qui permettent à des individus très différents d’entrer en commerce, outil de dynamisation et de développement infini du système des personnages qui s’enrichit encore du fait de l’extrême variété des objets en circulation puisque l’argent équivaut désormais à tout, objets, œuvres d’art, sentiments… La dynamique narrative du contrat est d’ailleurs d’autant plus grande qu’elle systématise la fiducie comme modalité relationnelle. Avec l’argent, les dynamiques romanesques relèvent plus que jamais et de manière essentielle des dialectiques du croire et du faire-croire. Cette conversion permet d’ailleurs de comprendre, ex post, pourquoi la sémiologie fut une lectrice attentive et souvent perspicace du roman réaliste puisque, selon Jean-Claude Coquet, « la succession sur le plan syntagmatique des épreuves […] qualifiante, décisive, glorifiante ; ou bien, sur le plan paradigmatique, l’inversion des contenus, opérations qui engagent le chercheur à étudier les relations cruciales comme celle du manque (et de sa liquidation), […] ou de la dualité sujet anti-sujet formant une structure polémique, ou encore du contrat ».[17]
Il serait bien entendu absurde – ou très idéologique – d’affirmer que la littérature importe purement et simplement dans l’ordre de la fiction des principes économiques qui sont avant tout le fruit d’une modernité dont l’esthétique réaliste et la science économique sont toutes deux héritières. Il n’en reste pas moins que l’intelligibilité de ces principes s’opère progressivement et de plus en plus exclusivement, à partir de Smith et tout au long du XIXe siècle, selon la seule grille économique. De même que le personnage balzacien n’utilise plus le terme « escompter » qu’en son sens technique et financier en oubliant sa vieille valeur morale, le contrat perd bientôt ses connotations éthiques pour n’être conçu que comme un acte économique, tandis que le temps perd sa profondeur ontologique pour se charger d’une valeur essentiellement quantitative. De ce point de vue, le roman participe, sans doute à son corps défendant, de cette modalisation économique du vivant en colportant inconsciemment les principes et les normes capitalistes. Mais s’il joue une fonction de relais essentielle et contribue à ancrer l’ethos libéral dans les mentalités collectives, le roman ne saurait être considéré comme une simple boîte enregistreuse. La mise en texte des principes structurants de l’économie libérale, tout en assurant au récit de nouveaux possibles narratifs, implique automatiquement et pour ainsi dire structurellement leur critique.
II. Structures de l’économie narrative réaliste
Une fois appréhendées les conditions de possibilité d’un sous-genre « fiction économique », il convient d’étudier les structures de l’économie narrative réaliste en montrant comment le récit reprend, en les modalisant, les trois principes ci-dessus évoqués à travers les matrices formelles de la polémologie, du retour à l’équilibre et des arythmies.
Conflictualité : polémologies du récit économique
Esthétique de la contradiction, le romantisme se place sous l’égide d’un Polemos laïcisé auquel l’économie offre au XIXe siècle ses nouveaux champs de bataille. Car, là réside l’une des causes du Mal du siècle, suite aux promesses non tenues de la Révolution et à la défaite napoléonienne, la lutte économique est le nouveau, voire le seul espace permettant au désir et à la gloire de se déployer. Source de désenchantement, cet héroïsme franchement dégradé est l’occasion de peintures acides où l’on vilipende les figures de banquier parvenu[18]. Mais par-delà ses portraits aussi convenus que stéréotypés, Nucingen a beau être, selon la formule de Félicien Marceau, un « coffre-fort déguisé en homme », il n’en est pas moins source de fascination, de même que la figure du Gundermann zolien est moins grotesque qu’inquiétante. Aussi n’est-il pas sûr qu’il faille interpréter ironiquement le titre de« Napoléon de la finance » que Balzac confère à Nucingen. Le patron d’industrie (celui du Péché de Monsieur Antoine par exemple), le grand spéculateur, le banquier (songeons encore à Saccard), le patron de presse (Bel Ami), mais aussi le viveur-débiteur (Rastignac, Maxime de Trailles) sont des figures de puissance. Ils participent du mythe romantique de l’énergie parce qu’ils semblent en mesure de dompter les flux financiers, la véritable force du siècle.
Cette énergétique ne s’établit cependant pas au niveau des seules figures romanesques – qui sont autant d’incarnations métonymiques de l’argent – et semble devoir animer la structure du récit comme si le roman du XIXe siècle actualisait ou revivifiait la traditionnelle structure polémico-contractuelle du récit à l’aide du code économique. En effet, en saisissant l’argent comme le vecteur topique (à la fois but et moyen) du libre jeu des intérêts et des passions, le récit réaliste rend compte de son temps tout en conservant la caractéristique de l’activité mimétique conçue, depuis Aristote comme une « ritualisation des relations polémiques »[19]. D’une côté, il prend acte de ce que l’économie définit l’espace contemporain du pouvoir et, de l’autre, fabrique une tension dramatique inédite en s’ordonnant autour des rôles et des schémas actantiels définis par l’argent (le riche/le pauvre ; le créancier/le débiteur, …). Ces schémas sont d’autant plus dynamiques que l’institution financière repose sur de denses circuits d’intermédiaires[20] qui disposent d’instruments financiers complexes (la lettre de change, le réméré, le fidéi-commis…) autorisant, le cas échéant à l’insu des protagonistes, une circulation débridée de l’argent. Le croisement de ces combinatoires actantielles et de la viralité de l’argent détermine ainsi une gamme potentiellement infinie de jeux d’opposition ou d’alliance qui deviennent autant de facteurs de tension et de dynamisation de l’intrigue… Se trouve vérifiée, par la grâce de l’argent, la règle énoncée par Tomachevski qui veut que « la tension “dramatique” [soi]t un trait du récit qu’il convient de rattacher à la nature polémique des actions mises en scène par l’intrigue : “plus les conflits qui caractérisent la situation sont complexes et plus les intérêts des personnages opposés, plus la situation est tendue”. »[21] Or, plus le récit se fait réaliste, plus il rapporte fidèlement les conditions réelles de fonctionnement de l’institution bancaire ou des structures commerciales, plus il crée potentiellement complexité et richesse narratives.
Sans doute la maîtrise de telles combinatoires nécessitait-elle de fortes plumes et des imaginations suffisamment puissantes pour permettre au récit de naviguer entre les écueils du didactisme, de l’entassement des faits ou de l’arbitraire. Mais on comprend en même temps que la nature intrinsèquement polémique des relations financières ait fondé la fortune romanesque de l’argent. Pour le pire comme pour le meilleur, certes, il faut bien reconnaître la fonction essentielle et rarement soulignée de l’argent comme objet mélodramatique. Bien qu’il procède le plus souvent à des instrumentalisations monétaires assez rudimentaires, le mélodrame – dont nous adopterons la définition donnée par Peter Brooks – a trouvé dans l’argent l’objet permettant de produire – c’est-à-dire d’énoncer et de manifester – le conflit moderne entre l’homme et le social dans un monde marqué par la disparition du sacré[22]. Objet clivant par excellence, l’argent permet l’affrontement manichéen entre le bien et le mal, affrontement généralement surdéterminé ici par le conflit entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas, là entre l’avoir et l’être. Doté d’une autonomie volontiers affublée du schème diabolique, il autorise des retournements plus ou moins magiques dès lors que l’argent, comme animé d’une dynamique propre, semble agir comme un Dieu caché, une force indestructible dont La Peau de chagrin est l’épopée fondatrice[23]. En cela, il participe du mode de l’excès cher au mélodrame en campant des personnages atteint de pathologies de l’argent, qu’il s’agisse de la rétention (l’avare), de la dépense (le viveur, la femme prodigue) ou de la spéculation qui sont autant de combats que l’individu livre à lui-même ou aux autres par le truchement de l’argent.
La loi du retour à l’équilibre
Toutefois, s’il est soumis à la force centrifuge des combinatoires financières, le récit conjure la puissance potentiellement chaotique de l’argent en se soumettant à des principes économiques qui, à l’instar de la règle du retour à l’équilibre, exercent une forme de contention narrative. Cette loi découle de la nécessité rudimentaire de ramener les échanges à leur point d’étiage, les recettes soldant les dépenses et les débits équivalant aux crédits, de sorte que la logique binaire et récursive de l’échange soit in fine respectée aux termes d’équilibres dont l’enchaînement dynamique rend possible la croissance. Cette règle s’avère d’autant plus impérieuse, et d’autant plus respectée, qu’elle trouve dans l’impératif bourgeois du remboursement – le fameux tu dois que Nietzsche situe à l’origine de l’ethos bourgeois[24] –un fondement moral qui lui assure une double assise mécanique et éthique. Que l’on soit petit – César Birotteau, les Rogron… — ou grand bourgeois comme Crevel, « la vertu, l’honneur, la loyauté consist[e] à payer régulièrement ses billets » (P, p. 45)[25]. Cette même éthique de la dette se retrouve également chez Véron lorsque le personnage, aux abois, donne ses dernières consignes à son fils :
De Rhétorière et toi, menez à bonne fin les affaires, la liquidation de la maison, et résignez-vous, s’il le faut, à la misère plutôt que de faire perdre un centime à nos créanciers. Il s’agit de notre nom, de notre honneur ! Lors même que vous parviendriez à sauver quelques débris de notre fortune, vendez cet hôtel, vendez la terre de Fermont, vendez tout, et reprenez cette vie simple et modeste que je n’aurais jamais dû quitter.[26]
Mais par-delà le discours des personnages, la nécessité récursive s’impose également sur le plan narratif, le récit devant assurer le remboursement de l’ensemble des sommes empruntées et revenir à l’état d’équilibre. Que le remboursement passe par le travail (César Birotteau), la réapparition d’une fortune cachée ou inconnue (La Nièce du banquier), le déplacement d’une fortune, d’un héritage ou d’un legs… (Cinq cent mille francs de rentes) ou la convocation du hasard, le récit ne peut se refermer tant que n’ont pas été soldés les débits de différents ordres – moraux, financiers ou matériels – contractés par le personnage central. Cette loi, que Balzac invente et respecte scrupuleusement dans la quasi totalité de ses romans et nouvelles[27], semble devenir une sorte de stéréotype narratif repris par ses successeurs. Le récit de Véron, Cinq cent mille francs de rentes (1855), offre une illustration particulièrement explicite de cette nouvelle stéréotypie financière. Picard est un banquier honnête et respecté qui, parti de rien, a su monter un établissement prospère qui lui assure « une fortune de quinze cent mille francs » (p. 26) et la considération des agents de la place parisienne. Ce crédit irréprochable lui vaut d’être approché par son vieil ami le Baron de Longueville, spéculateur mondain, qui lui propose d’entrer dans une affaire susceptible de lui conférer les 500000 francs de rentes censés représenter son talent. Les affaires marchent si bien que Picard réalise des gains aussi rapides qu’exorbitants et adopte un train de vie aussi irraisonnable que tapageur. Las, le banquier doit bientôt faire face à la défiance que suscite sa trop rapide ascension et aux jalousies que ses dépenses ne manquent pas de susciter. Trahi par son second, Picard voit bientôt les actionnaires se presser à son guichet pour obtenir le remboursement de dépôts qu’il n’a bien entendu plus en caisse, mouvement cumulatif de défiance qui mène le banquier aux portes de la faillite. Si quelques rebondissements inattendus permettent d’éviter le déshonneur, le narrateur note non sans malice qu’au bout du compte
Cette somme de huit cent mille francs, l’héritage du comte de la Roserie, la vente aux enchères de l’hôtel Picard, du château de Fermont, de la galerie de tableaux, — qui produisit à peine six cent mille francs — suffirent et au delà pour rembourser les avances de la Banque, couvrir les déficits, pourvoir aux derniers versements de toutes les actions industrielles, acquitter les droits de mutation assez considérables de l’héritage la Roserie ; mais, tous comptes faits, les entreprises, les opérations de Bourse, les spéculations n’avaient point accru la richesse du modeste banquier d’autrefois.[28]
En soulignant complaisamment le retour à l’état antérieur, le commentaire narratorial exhibe une norme exogène dont l’application est si impérieuse qu’elle peut, le cas échéant, nécessiter quelque entorse au vraisemblable pour que, malgré tout, les dettes soient apurées et que le récit puisse se refermer. Le récit balzacien offre maints exemples de ces rééquilibrages dont le narrateur note d’ailleurs lui-même le caractère invraisemblable tant dans Le Cabinet des Antiques, César Birotteau, Splendeurs et misères des courtisanes. Cette même mécanique est à l’œuvre dans Le Comte de Monte Cristo où la nécessité du remboursement s’impose pleinement à ceci près que les dettes in fine remboursées sont des dettes morales. Chez Dumas, les dettes financières ne sont que des outils au service d’une fin supérieure, ce qui explique peut-être que le romancier ne s’effraie pas du manque de vraisemblance de la fortune de Monte Cristo. De fait, la vérité du récit d’argent ne réside pas dans les montants, pas plus que dans l’exactitude des comptes que la critique s’épuise parfois à vérifier, mais dans la nature des relations d’obligations structurées – et rendues impératives – par l’argent[29].
Dans toutes ces œuvres, le récit ne s’accommode pas seulement de l’impératif du retour à l’équilibre, il en accuse la structure en procédant à une véritable liquidation, au double sens juridique et narratologique du terme. Le retour à l’équilibre initial équivaut alors à une annulation pure et simple de la valeur artificiellement créée par les spéculations du banquier et de tous les événements du récit qui sont comme emportés. Le fait que le récit contemporain, notamment nord-américain, réutilise ce schéma prouve bien que l’on tient là une structure narrative topique du récit d’argent aussi bien à l’œuvre dans Les Corrections de Franzen que dans Gain de Powers[30]. Ce phénomène de liquidation est d’autant plus troublant que, dans la plupart des cas (Le Cabinet des Antiques, César Birotteau, Cinq cent mille francs, mais aussi dans L’Argent de Zola…), il s’opère au pas de charge. Après la pause qu’occasionne la période astringente du remboursement, le récit s’accélère dans cette phase finale pour mieux mettre en évidence le caractère implacable d’un mécanisme de compensation économique qui emporte tout sur son passage, valeurs, fortunes, espoirs et personnages. Il faut faire le vide, laisser la place nette. En choisissant de clore son récit sur la double mort – réelle et sociale – des deux héros, Souvestre accuse un peu plus la puissance liquidatrice du récit économique. L’auteur, en effet, disposait des moyens narratifs pour trouver une fin heureuse en laissant la fille de Severin épouser le neveu du méchant banquier… Mais, au rebours de cette échappée morganatique, il fallait cette acmé mélodramatique de l’agonie de l’héroïne — « Monsieur, dit-il en lui montrant Anna immobile, vous pouvez achever vos comptes maintenant! »[31] — pour dévoiler la force inepte et inhumaine qui anime le mouvement de l’argent.
Sans doute de telles résolutions selon la norme économique ne sont-elles pas dépourvues de fonctions moralisantes. En bon saint-simonien, Souvestre souhaitait mettre en évidence la négativité d’un principe argent qui brûle tout sur son passage, broie les faibles, quitte à laisser la parole et le pouvoir aux « méchants ». Mais, par-delà cette modalisation thymique, il convient de voir plus fondamentalement l’illustration de ce que Derrida appelle la « structure odysséique du récit économique » :
La figure du cercle […] se tient au centre de toute problématique de l’oikonomia, comme de tout le champ économique : échange circulaire, circulation des biens, des produits, des signes monétaires ou des marchandises, amortissement des dépenses, revenus, substitution des valeurs d’usage et des valeurs d’échange. Ce motif de la circulation peut donner à penser que la loi de l’économie est le retour — circulaire — au point de départ, à l’origine, à la maison aussi. On aurait ainsi à suivre la structure odysséique du récit économique. L’oikonomia emprunterait toujours le chemin d’Ulysse.[32]
Cette « figure » – la sémiotique croisant en ce point la pragmatique[33] – est d’ailleurs d’autant plus nécessaire qu’elle correspond désormais à un horizon d’attente social caractéristique d’un siècle bourgeois où les remises de dette n’ont plus droit de cité[34]. Aussi comprend-on que la structure axiologique du récit économique reste fondamentalement a-morale. Peu importe que le dénouement soit moral, que l’emporte la vertu ou la cruauté, seul compte le retour à l’équilibre, car il est garant de l’avenir du capitalisme et porte cette « sacralisation de la croissance » évoquée plus haut avec Jean-Pierre Dupuy.
Profondément intégré aux structures interprétatives conventionnelles, l’impératif du retour à l’équilibre prive en un sens le récit de tout suspens puisque chacun sait et attend qu’il se conclue par le rééquilibrage des comptes. D’où cet usage fréquent de la prolepse dans un récit d’argent qui n’hésite pas à « vendre la mèche » comme le fait Véron lorsqu’il évoque la réussite de son personnage qui a « réalis[é] en peu de jours un bénéfice net de deux millions » (t.1, p.112). Au cas où le caractère artificiel de gains aussi rapides que faramineux de Picard ne serait pas apparu au lecteur, le narrateur auctorial s’emploie méthodiquement à prédire la fin du banquier en concluant presque systématiquement chacun des chapitres du roman par une prolepse déceptive prédisant la fin de l’imprudent banquier
[Elle] comprenait déjà que Picard n’était plus le père de famille laborieux et assidu ; que ce gros succès d’argent devait faire naître dans son âme deux funestes passions : l’ambition et la cupidité. (t. 1, 117)
Grisé par les millions, gâté par des flatteries perfides, intéressées, il ne pouvait plus s’arrêter sur cette pente du succès, pente plus rapide peut-être que celle du malheur. (t. 1, p.174)
La mère et la fille comprenaient que c’en était fait pour elles de cette vie toute d’intérieur et de famille, où le bonheur savait tenir la première place. (t. 1, p. 191)
Picard ne se doutait pas de toutes les déconvenues blessantes qui l’attendaient dans cette fête. (t.1, p.347)
Cet usage de la prolepse, fréquent chez Balzac, n’implique cependant aucune mise sous tutelle de la fiction. Loin de se laisser emprisonner par une dynamique monétaire autonome – un fatum moderne – à laquelle il ne pourrait que se plier, le récit conserve d’indéniables marges de manœuvre et sait, par-delà l’enchaînement apparemment inéluctable des séquences sur l’axe syntagmatique, déployer ses propres stratégies. On retrouve là un mécanisme semblable au « code herméneutique » que Barthes convoque dans S/Z pour caractériser cet espace « dilatoire » où la « textualisation de l’action » reprend ses droits sur l’action elle-même[35]. Considérons donc la manière dont le récit d’argent confronte le lecteur au « retard » ou à la « réticence textuelle » et s’organise « selon l’attente et le désir de retour ».
Arythmies
Faute de pouvoir exposer des exemples détaillés de cette structure dilatoire, fions-nous à la théorisation qu’un narrateur balzacien propose explicitement de ces mécanismes de « textualisation de l’action » économique. Alors qu’il est engagé dans le récit de l’origine de la fortune de Rastignac, Bixiou se voit reprocher par ses interlocuteurs de n’aller pas droit au but
Et allons un peu plus vite ! dit Blondet, tu marivaudes.
Je ne vois, dans toutes ces toupies que tu lances, rien qui ressemble à l’origine de la fortune de Rastignac, et tu nous prends pour des Matifat multipliés par six bouteilles de vin de champagne, s’écria Couture.[36]
Passons sur le cabotinage de Bixiou —
Je vous fais l’honneur de vous traiter en gourmets, je vous distille mon histoire, et il me critique ! Mes amis, la plus grande marque de stérilité intellectuelle est l’entassement des faits. […] Voulez-vous que je vous fasse un récit qui aille comme un boulet de canon, un rapport de général en chef […], que je donne à ma langue la sotte allure d’un livre (il feignit de pleurer) ? Malheur à l’imagination française, on veut épointer les aiguilles de sa plaisanterie ! (MN, p. 364)
— car l’essentiel est moins dans la pose du conteur que dans les pauses et les circonvolutions que le récit d’argent doit décrire pour actualiser sa littérarité. L’objectif du récit n’est en effet pas d’aller vers la fin – on la connaît, Nucingen est le Napoléon de la finance – mais de ménager le suspense et de rendre l’argent romanesque, et ce au double sens du terme. Il s’agit d’abord, comme l’exprime Balzac, de conférer à l’épopée financière « l’intérêt d’un chapitre de voyage dans un pays étranger »[37], en jouant des effets de surprise et de contrepoint, de report et de latence qu’autorise l’artillerie juridico-financière. Les outils financiers appellent des jeux d’acteurs, nous l’avons vu plus haut, qui complexifient à souhait l’action par une multiplication des protagonistes qui crée elle-même des situations de dépendance inattendues. La lettre de change dialectise ainsi le couple prêteur/emprunteur en imposant deux intermédiaires, le plus souvent distants. Il s’agit là de véritables actants puisque, par le jeu de l’endossement et du réendossement, l’effet de commerce peut être racheté par un tiers qui peut le revendre à autrui… à l’infini, parfois à l’insu de l’emprunteur premier. Cette mécanique infernale est une source inépuisable de rebondissements puisque le débiteur peut se retrouver entre les mains de créanciers auxquels il n’a jamais emprunté d’argent, mais qui ont intérêt à le tenir par « le licou de la lettre de change » (Une fille d’Ève). Le ressort est abondamment utilisé par Balzac, mais également par Souvestre puisque Gaillot se débrouille pour racheter les créances pendantes de Severin, tenant par là son rival à sa merci. Si l’on ajoute que les dettes réelles se redoublent au plan moral (ou inversement) [38], on comprendra à quel degré de complexité et de toxicité atteignent ces combinatoires actantielles. Mais la puissance proliférante des effets de commerce ne régit pas seulement l’axe paradigmatique puisque les billets à ordre, lettres de change ou autres fidéi-commis constituent autant de formes temporalisées de l’argent dont le récit joue pour (dés-)organiser le déroulement de la fable. Tout se passe comme si l’argent était doté d’une autonomie lui permettant de « vivre sa vie » à l’insu des personnages. Comme le dit Grandet, « les écus vivent et grouillent comme des hommes: ca va, ca vient, ca sue, ca produit »[39]. Si, dans le meilleur des cas, les écus font des petits et enrichissent le spéculateur, ils peuvent à l’inverse croître négativement, à l’instar de ces dettes qui enflent sans que le protagoniste ne puisse en interrompre le mouvement. Ici, César Birotteau, impuissant face au gonflement de son passif (financier et moral), est condamné à errer dans les rues de Paris avec le vain espoir de trouver quelques fonds ; là, Severin disparaît du premier plan du roman pour trouver, ailleurs, l’argent qui calmerait ses créanciers, laissant dès lors à Gaillot toute latitude pour manœuvrer. Il est même des cas où cette génération spontanée s’opère dans le silence du récit – c’est-à-dire dans le dos du personnage et du lecteur, les dettes resurgissant au moment où tout le monde les avait oubliées. Savinien de Portenduère (Ursule Mirouet), rattrapé par de vieux débits, est ainsi expédié à la prison pour dettes et abandonne le terrain à ses opposants ; Saccard (L’Argent) tombe parce qu’il n’a pu contrôler le mouvement de ses anciennes et honteuses dettes exhumées par la Méchain et habilement instrumentalisées par l’usurier Busch…
Sans doute ce ressort constitue-t-il une nouvelle illustration de l’impératif du retour à l’équilibre, mais il repose sur une latence des effets de crédit qui atteste de la valeur temporelle de l’argent. Une valeur que le récit économique sait utiliser en orchestrant des arythmies – différentes des bouleversements de l’ordre temporel évoqués précédemment – qui engendrent à leur tour des structures topiques. En effet, tous les romans semblent traiter la dépense ou l’endettement sur le mode du résumé voire de l’ellipse tandis que le remboursement ou le rééquilibrage financier, eux, relèvent de la scène ou de la pause. Par-delà don invention balzacienne[40], cette loi semble massivement reprise par le roman populaire. Cinq cent mille francs de rentes se conforme ainsi scrupuleusement à la structure duale d’un récit de crédit qui fait succéder la période du remboursement à la phase euphorique de l’endettement. La première, qui couvre une vingtaine d’années, nécessite 430 pages (vingt ans d’accumulation primitive sur une centaine de pages et trois ans de spéculation heureuse en 340 pages) et se clôt, comme dans César Birotteau, avec le banquet, tandis que la seconde qui ne dure que quelques mois s’étale quant à elle sur 270 pages, dont 210 réservées aux quatre journées nécessaires à la liquidation des dettes et de la crise. Ce spectaculaire ralentissement du récit, systématique chez Balzac, se retrouve chez Souvestre lorsque Severin, aux prises avec ses créanciers « conn[aî]t les angoisses du commerçant qui compte les jours, les heures, perd le sommeil à l’approche des échéances et attend la lettre d’un créancier comme on attend la balle d’un adversaire. » (L’Homme et l’argent, t.2, p.34). Certes, le remboursement n’est pas énoncé en termes strictement comptables, mais le récit se solde par le respect du contrat, totalement léonin, au terme duquel la richesse de Severin, dépouillé et livré au chagrin de sa fille morte, est transférée à Gaillot. Cette douloureuse paralysie du récit d’argent, y compris dans ses formes les plus stéréotypées – qu’on se souvienne de la manière dont l’action du Comte de Monte Cristo se ralentit au moment où les méchants doivent payer leurs dettes à Dantès – n’est pas qu’une ficelle narrative. Elle illustre au contraire la puissance herméneutique d’une forme narrative qui, en persévérant dans sa littérarité, parvient à délivrer un savoir distinctif sur l’argent en illustrant les violences qu’il fait subir au sujet. Dès lors, l’argent devient romanesque – mais en un sens second – à partir du moment où la mise en texte lui confère une valeur pour le sujet en permettant au lecteur d’expérimenter les phénomènes de subjectivation qui accompagnent chacun de ses usages. De ce point de vue, le récit réaliste doit être considéré comme une entreprise de démystification des fictions économiques : de même qu’il dénonce la fable de la victoire de l’intérêt sur les passions, il montre – au rebours du credo libéral de l’objectivité monétaire exposé par Simmel – que l’argent et la monnaie sont tout sauf des agents neutres. Il prouve que tout échange implique la temporalité et la valeur d’un sujet économique qui laisse toujours quelque chose de lui-même dans ce commerce.
On ne saurait affirmer l’existence d’un « sous-genre fiction économique » sans développer une critériologie rigoureuse et sans s’appuyer sur un corpus large que les bornes étroites de cet article ne permettent que d’esquisser. Il n’en reste pas moins que ces coups de sonde dans la littérature romanesque du premier XIXe siècle révèlent des invariants fictionnels économiques qui structurent le récit. Le fait que ces invariants semblent également se retrouver dans le récit du XXe siècle prouve que l’on n’a pas seulement affaire à un phénomène conjoncturel, mais que se joue, à travers l’hypothèse d’un récit économique topique une mutation d’ordre esthétique et politique. Car c’est bien de la fonction et de la nature politique de la mimesis qu’il s’agit, soit qu’on adopte une perspective économiciste ou matérialiste où la littérature se « contenterait » de transcrire des mutations libérales à l’œuvre depuis le mitan du XVIIIe siècle ; soit qu’on préfère une conception anthropologique de l’échange dont l’économie la littérature ne seraient que des représentations. Le débat n’a rien d’anecdotique. Là, une vision classique – qui réunit marxistes et libéraux – considérant l’œuvre comme la résultante des conditions socio-économiques ; ici, une vision hétérodoxe qui dénonce le caractère téléologique de l’économie libérale moderne et réinscrit les formes de l’échange dans une conception globale des relations humaines quelles qu’en soient les formalisations, économiques ou littéraires.
La seconde position semble devoir être privilégiée pour deux raisons. D’une part, tout en permettant d’observer la manière dont l’économie et la pensée calculante contaminent, avec leurs référentiels comptables, les autres sphères de la vie humaine, elle analyse la propension de l’économie libérale à naturaliser ses théories en faisant de l’échange monétaire une invention moderne, au détriment de formes alternatives dont la littérature atteste la résistance. Elle ouvre d’autre part et conséquemment sur une conception historiciste de l’argent littéraire autrement plus féconde. En effet, dès lors que littérature et économie sont considérées comme deux formalisations de l’échange, on comprend que la première se soit toujours intéressée à l’argent et que chaque période de crise ait naturellement suscité son lot de récits d’argent, de pièces à intrigue financière… Mais, dans cette histoire de l’argent littéraire qui reste à écrire, le moment dix-neuviémiste occupe une place et un statut bien particuliers. L’argent, à ce moment-là, actualise ses qualités fictionnelles parce que s’opère une mutation libérale qui, ainsi que l’ont montré Polanyi ou Hirschmann[41], provoque une rupture à la fois épistémologique, morale, sociale et politique. Le romancier ne parle pas seulement d’argent parce que l’argent est partout, mais parce que la configuration idéologique nouvelle place l’argent et son éthique au cœur des régulations socio-politiques. Il faudra que s’écoule un large XIXe siècle pour que ce choc de civilisation soit absorbé et que la nouvelle norme économique se banalise. Ceci explique peut-être que l’argent disparaisse progressivement de la littérature de l’entre-deux-guerres pour ne réapparaître qu’à la fin d’un XXe siècle, c’est-à-dire quand un nouveau paradigme (néo-)libéral autorise un nouveau mouvement d’autonomisation de l’argent, quand les capacités d’abstraction et de virtualisation de l’argent atteignent un tel degré qu’elles semblent s’opérer au mépris ou au détriment des logiques politiques et sociales. C’est en ces moments de crise que le récit d’argent (re-)surgit pour affirmer une vocation critique qui ne s’épuise pas dans la dénonciation, mais réinscrit la valeur du sujet au cœur de la mécanique économique.
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. XII
Œuvres citées
Ancelot, Virginie : La Nièce du banquier, Paris, Hippolyte Boisgard éditeur, 1853.
Balzac, Honoré de : La Comédie humaine, Avant-propos de La Comédie humaine, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, P.G. Castex éd., 1977-1981
Barbéris, Pierre : – Mythes balzaciens, Paris, Armand Colin, 1971 ; – Le Monde de Balzac, Paris, Kimé, 1999.
Baroni, Raphaël : La tension narrative, Paris, Seuil, 2007.
Brooks, Peter : L’imagination mélodramatique, Paris, Garnier, 2011
Coquet, Jean-Claude : Sémiotique L’Ecole de Paris, Paris, Hachette, 1982
Derrida, Jacques : Donner le temps – La Fausse monnaie, Paris, Galilée, 1991.
Dupuy, Jean-Pierre :L’avenir de l’économie, Paris, Flammarion, 2012
Fontaine, Laurence : L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle, Paris, Gallimard, 2008.
Hautcoeur, Pierre-Cyrille (dir.) : Le marché financier français au XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, vol. 1.
Hirschman, Albert O. : Les Passions et les intérêts, Paris, PUF, 1997.
Mollier, Jean-Yves : Le Commerce de la librairie en France au XIXe siècle, 1789-1914, Paris, IMEC/Maison des sciences de l’homme, 1997.
Péraud, Alexandre : « “La panacée universelle, le crédit ! ” (César Birotteau). Quelques exemples d’inscription narrative du crédit dans la littérature du premier XIXe siècle », Romantisme, Paris, n°151 (2011-1) ; Le crédit dans la poétique balzacienne, Paris, Garnier, 2012 ; La Comédie (in)humaine de l’argent,Floirac, Le Bord de l’eau, 2013.
Polanyi, Karl : La Grande transformation, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1983.
Souvestre, Émile : L’Homme et l’argent, Paris, Charpentier, 1859.
Vaillant, Alain : Mesure(s) du livre, actes du colloque organisé par la Bibliothèque nationale et la Société des Études romantiques, Paris, Publications de la Bibliothèque nationale, 1992.
Véron, Louis : Cinq cent mille francs de rentes, Paris, Librairie Nouvelle, 1855
[1] Voir Jean-Yves Mollier, Le Commerce de la librairie en France au XIXe siècle, 1789-1914, Paris, IMEC/Maison des sciences de l’homme, 1997 ; Alain Vaillant, Mesure(s) du livre, actes du colloque organisé par la Bibliothèque nationale et la Société des Études romantiques, Paris, Publications de la Bibliothèque nationale, 1992.
[2] Voir Pierre-Cyrille Hautcoeur (dir.), Le marché financier français au XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, vol. 1.
[3] Dans le cadre étroit de cette étude, nous nous appuierons essentiellement sur les œuvres d’Émile Souvestre (L’Homme et l’argent), de Louis Véron (Cinq cent mille francs de rente) et de Virgine Ancelot (La Nièce du banquier) que nous mettrons en regard de La Comédie humaine.
[4] Albert O. Hirschman, Les Passions et les intérêts, Paris, PUF, 1997, p.64.
[5] Ibid., p. 102.
[6] Avant-propos de La Comédie humaine, I, p.9.
[7] Karleinz Stierle, La Capitale des signes. Paris et son discours, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, 2001
[8] Par exemple lorsqu’il caractérise les Scènes de la vie de province comme « l’âge des passions, des calculs, des intérêts et de l’ambition » ; Honoré de Balzac, La Comédie humaine, Avant-propos de La Comédie humaine, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, P.G. Castex éd., 1976, p. 18, tome 1 (toutes les citations de La Comédie humaine, tome et page, renvoient à cette édition).
[9] L’homme n’est ni bon ni méchant, il naît avec des instincts et des aptitudes ; la Société, loin de le dépraver, comme l’a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur ; mais l’intérêt développe aussi ses penchants mauvais. », Avant-propos de La Comédie humaine, op. cit., p. 12.
[10] Jean-Pierre Dupuy, L’avenir de l’économie, Paris, Flammarion, 2012, p. 67.
[11] Les Petits Bourgeois, t. VIII, p. 120.
[12] On se réfère ici essentiellement aux récits « mondains » d’un auteur qui s’était par ailleurs fait une réputation avec ses romans régionalistes bretons. Voir Françoise Sylvos, « Émile Souvestre ou la réclame telle qu’elle sera », La Réclame, Romantisme 2012/1 (n°155).
[13] L’Homme et l’argent, Paris, Charpentier, 1859, t. 1, p. 191 -192 et p. 193.
[14] Jean-Pierre Dupuy, L’avenir de l’économie, Paris, Flammarion, 2012, p. 153. Ce tropisme projectif est assorti chez cet économiste d’un destin apocalyptique puisque : « la condition de possibilité du capitalisme est que ses agents le croient immortel. Son péché originel est qu’il a besoin d’une ouverture indéfinie de l’avenir pour avoir une chance de tenir à tout moment ses promesses. C’est là que s’enracine la sacralisation de la croissance » (ibid., p. 188).
[15] Se pose, chez Zola, la question de la compatibilité entre, d’une part, l’ouverture infinie du capital – fondatrice de la fable économique – et d’autre part, le principe entropique qui régit le cycle des Rougon-Macquart si bien qu’on peut se demander si l’argent zolien est soumis au paradigme thermodynamique.
[16] Splendeur et misères des courtisanes, t. VI, p. 591
[17] J.-C. Coquet, Sémiotique L’Ecole de Paris, Paris, Hachette, 1982, p. 36.
[18] Songeons à la figure de Desnorest, le banquier du récit de Virginie Ancelot, La Nièce du banquier, « un de ces bourgeois vaniteux qui ont trôné en France pendant quelques années. […] Il réunissait « tous les dédains de l’aristocratie, qu’il détestait pourtant parce qu’il n’était pas noble, et toute la mauvaise humeur de la démocratie, qu’il méprisait souverainement parce qu’il était millionnaire. Tout cela produisait en lui les plus singulières contradictions ». Ce même banquier exprime très clairement le transfert de la virtu du champ de bataille au terrain commercialo-boursier : « Est-ce que par hasard vous voudriez que je me fusse ruiné, ou que j’eusse seulement mis du mien dans les affaires publiques ? On se serait joliment moqué de moi ! Oh ! Si je n’avais pas été sûr d’y doubler mes fonds, est-ce que j’aurais jamais avancé un sou ? Allons donc ! C’était bon pour les ci-devants de faire la guerre à leurs dépens ! ». Virginie Ancelot, La Nièce du banquier, Paris, Hippolyte Boisgard éditeur, 1853, p. 17 et p. 25.
[19] J.-M. Schaeffer cité par R. Baroni, La tension narrative, Paris, Seuil, 2007, p. 79.
[20] Balzac livre un exemple typique de cette pyramide du crédit parisien au début des Petits Bourgeois : « En haut la maison Nucingen, les Keller, les Du Tillet, les Mongenod; un peu plus bas, les Palma, les Gigonnet, les Gobseck; encore plus bas, les Samanon, les Chaboisseau, les Barbet; puis, enfin, après le Mont de piété, cette reine de l’usure, qui tend ses lacets au coin des rues pour étrangler toutes les misères, pour n’en pas manquer une, un Cerizet » (X, 120). Pour un commentaire de cet énoncé balzacien fondamental, voir Alexandre Péraud, Le crédit dans la poétique balzacienne, Paris, Garnier, 2012, p. 78 sqq. et Jean-Joseph Goux, La Comédie (in)humaine de l’argent, « L’or, l’argent, le papier, dans l’économie balzacienne »,Floirac, Le Bord de l’eau, 2013.
[21] R. Baroni, op. cit., p. 80. Il faudrait réfléchir à l’espèce de malentendu idéologico-critique qui fit que les formalistes russes d’inspiration marxiste ont conçu un modèle fondé sur le conflit avec la lutte des classes comme horizon idéologique… alors même que le récit réaliste dont ils furent les commentateurs précieux ne faisait quant à lui, que thématiser ou mettre en texte le principe libéral du libre affrontement des intérêts.
[22] Le mélodrame naît de la Révolution, du « moment épistémologique […] qui, tant symboliquement que littéralement, marque la liquidation finale du sacré traditionnel et de ses institutions représentatives (l’Eglise et le monarque), le bouleversement du mythe de la chrétienté, la destruction de la cohésion organique et hiérarchique d’une société, et, partant, l’invalidation des formes littéraires (tragédie, comédie de mœurs) qui découlaient d’une telle société. Le mélodrame ne représente pas seulement la chute de la tragédie, il est aussi une réponse à la perte de la vision tragique. Il intervient dans un monde dans lequel les impératifs de vérité et d’éthique ont été violemment remis en cause, et dans lequel pourtant la promulgation de la vérité et de l’éthique, leur instauration au rang de mode de vie est une question politique immédiate et quotidienne », Peter Brooks, L’imagination mélodramatique, Paris, Garnier, 2011, p. 25.
[23] La Peau de chagrin fonde le caractère fantastique de l’argent en attribuant au fétiche moderne les attributs du talisman et participe de la détermination d’un stéréotype de l’argent magique qui irrigue tout le siècle. On en retrouve ainsi des manifestations explicites non seulement chez Balzac (Melmoth réconcilié…), mais aussi dans le roman populaire, par exemple chez Véron : « Il reste aux hommes aimables, spirituels, intelligents, qui ont tout perdu, une ressource plus sûre et plus honnête que la carte biseautée, c’est la lettre de change. La lettre de change est un chiffon de papier qui ouvre toutes les caisses… » ; « la maison Picard régnait despotiquement au parquet et dans la coulisse. Les opérations nouvelles dont elle se chargeait y excitaient l’engouement des spéculateurs ; les entreprises agonisantes qu’elle ressuscitait dans son crédit reprenaient aussitôt la faveur et la popularité. » Louis Véron, Cinq cent mille francs de rentes, Paris, Librairie Nouvelle, 1855, t.2, p.300-01 et t. 1, p.168.
[24] Nietzsche développe cette thèse dans La Généalogie de la morale dans le cadre de ses analyses sur la dette.
[25] Cette valeur, Balzac l’a intégrée au plus haut point comme en témoigne une lettre de 1833. Justifiant l’ajournement de son voyage en Ukraine, il déclare : « que de travail d’ici là, payer ses dettes, grandir de réputation », cité par Pierre Barbéris, Le Monde de Balzac, Paris, Kimé, 1999, p. 56.
[26] Cinq cent mille francs de rentes, op. cit., t.2, pp. 255-6.
[27] Pour une étude précise de l’application systématique de cette loi balzacienne, nous nous permettons de renvoyer à notre ouvrage, Le crédit dans la poétique balzacienne, op. cit., p. 202 sqq.
[28] Cinq cent mille francs de rentes, op. cit., p.376-77
[29] Verne réutilise cette structure à l’identique dans Mathias Sandorf, matrice que l’on retrouve également dans Les Mystères de Paris. Toutefois, le remboursement constitue chez Sue un moteur narratif premier puisque c’est le sentiment de devoir rembourser une dette, puissamment intériorisé par le personnage, qui meut Rodolphe dans sa quête et lance le récit.
[30] Le titre de Jonathan Franzen, Les Corrections, est, dans sa polysémie, particulièrement intéressant car par-delà le double sens moral ou punitif et financier du terme, il désigne bien le mécanisme boursier (corrections, en anglais) au terme duquel les titres reviennent à leur valeur « réelle ».
[31] L’Homme et l’argent, Paris, Charpentier, 1859, p. 257.
[32] Jacques Derrida, Donner le temps – La Fausse monnaie, Paris, Galilée, 1991, p. 18.
[33] On peut ici renvoyer aux analyses de la sémiotique contemporaine que déploie Raphaël Baroni dans La tension narrative, Paris, Le Seuil, 2007.
[34] Laurence Fontaine montre dans L’économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l’Europe préindustrielle (Paris, Gallimard, 2008) que l’économie dissymétrique d’Ancien Régime pratiquait couramment la remise de dette. Il faudrait ainsi analyser la manière dont toute une littérature du XVIIIe siècle intériorise cette pratique et la transpose dans l’ordre symbolique la fiction. Loin d’être tendue vers la restitution ou le retour à l’équilibre, elle privilégié au contraire le reste, l’imperfection de l’échange, c’est-à-dire la création d’un espace où puisse précisément se déployer l’humain.
[35] « Le grand mérite de Barthes a été de souligner l’importance non seulement de l’action représentée, mais également des énigmes qui structurent l’intrigue, c’est-à-dire des incertitudes textuelles générées, stratégiquement entretenues et finalement résolues par la narration ». Cité par R. Baroni, op. cit., p. 71
[36] La Maison Nucingen, t. VI,p. 351 et p. 369. Remarquons que, ce faisant, Bixiou reproduit le comportement du véritable héros de son histoire qui n’est pas Rastignac mais bien Nucingen. En effet, si la troisième liquidation du banquier est un véritable chef d’œuvre, c’est parce qu’il parvient à se rendre maître du temps. Rappelons-nous que « la maison Nucingen avait sciemment et à dessein employé ses cinq millions dans une affaire en Amérique, dont les profits avaient été calculés de manière à revenir trop tard. Elle s’était dégarnie avec préméditation » (p. 371, nous soulignons).
[37] Honoré de Balzac, Illusions perdues, V, p. 492.
[38] Songeons à cet échange, chez Souvestre, entre le banquier et sa femme dont les imprudences extra-conjugales menacent la réputation non de l’époux – on ne s’intéresse guère à ces niaiseries -, mais de l’homme d’affaires. « Ceci est une question de chiffres et non de sentiment. Ce n’est point de mon honneur que je vous demande compte, c’est du ridicule dont vous m’avez couvert. » « S’il est vrai que j’aie pu nuire à votre crédit, je suis prête à réparer ce tort. Ah ! Je vous en conjure, monsieur, cessons des débats cruels, puisque ce n’est pour vous qu’une question d’argent. Je suis riche, prenez dans ma dot et épargnez-moi vos reproches! » L’Homme et l’argent, p.160 et 161.
[39] Eugénie Grandet, II, p. 1131.
[40] Voir Le crédit dans la poétique balzacienne, op. cit., pp. 301 sqq.
[41] Karl Polanyi, La Grande transformation, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1983 ; Albert O. Hirschmann, Les passions et les intérêts, Paris, PUF, 1980.