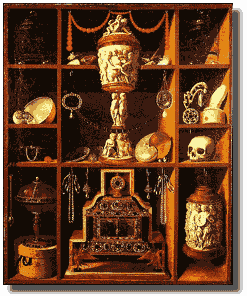Lorsque Bouvard et Pécuchet entreprennent de faire le tour des lieux parisiens d’exposition du savoir, ils ne manquent pas de parcourir « les galeries du Muséum » pour s’ébahir devant les « quadrupèdes empaillés », admirer les « papillons », rêver devant les fossiles et s’ennuyer devant les métaux et « la conchyologie »[1]. Le mot de « muséum », sans majuscule cette fois, est employé de nouveau pour désigner la pièce où Bouvard et Pécuchet entreposent notamment, dans leur maison de Chavignolles, des haches en silex[2]. Ce musée dégradé se distingue alors de son modèle parisien par le capharnaüm qui y règne et par la nature des objets exposés devenus très rapidement, sous la plume ironique du narrateur, les « curiosités les plus rares »[3]. Au cadre d’exposition d’objets dignes d’être connus du grand public que constitue le musée national se superpose subrepticement celui du cabinet de curiosités.
La même transformation du « musée » en cabinet se produit dans Mardi, au moment où les compagnons font halte sur l’île de Padulla pour satisfaire le désir de Média de jeter un œil au « very museum » de l’antiquaire Oh-Oh[4]. Très rapidement, ses composantes sont désignées par le nom de « raretés » et le « cabinet », comme dans la maison de Chavignolles, jouxte une bibliothèque[5]. Dans le musée de Bouvard et de Pécuchet et dans le cabinet d’Oh-Oh, se côtoient les « antiquités » et les « objets d’art » qui composent aussi les collections du jeune architecte dans Die Wahlverwandtschaften. Celui-ci distrait Charlotte et Odile en leur montrant « diverses reproductions et divers projets de tombeaux, de vases antiques », puis « sa collection d’armes et d’ustensiles divers » trouvés dans les tertres des peuples du Nord et, enfin, d’autres trésors d’origine allemande : « bractéates, monnaies épaisses, sceaux et tout ce qui s’y peut rapporter »[6]. Cet ensemble apparemment hétéroclite est complété plus loin dans le roman par les collections du voyageur anglais qui, à son tour, trompe l’ennui des dames, en leur permettant de contempler des dessins et des reproductions de paysages naturels, de monuments ou de lieux historiques. Il faudrait sans doute ajouter, au catalogue des musées et des cabinets de curiosités romanesques, des objets qui eux-mêmes semblent pouvoir constituer des cabinets en miniature : dans Die Wahlverwandschaften, le ravissant coffret offert par Édouard à Odile pour son anniversaire, tout débordant de mousseline et de dentelle, annonce la comparaison tissée par le narrateur entre la collection portative de l’architecte et des « boîtes de modiste »[7] et le coffret rappelle les étuis de métal soudés glissés dans les creux de la pierre commémorative au chapitre IX qui rassemblent des objets fort hétéroclites :
Diese Metallnen zugelöteten Köcher enthalten schriftliche Nachrichten ; auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges eingegraben ; in dieser schönen gläsernen Flaschen versenken wir den besten Wein, mit Beizeichnung seines Geburtjahrs ; es fehlt nicht an Münzen verschiedenen Art, in diesem Jahre geprägt […] [8].
Il convient sans doute de ne pas exagérer l’opposition entre les deux modes d’appréhension et d’étude du monde naturel que peuvent incarner le cabinet de raretés et de curiosités et le musée. Au XVIIe siècle encore, à l’âge moderne, les manuels destinés aux voyageurs abondent en listes de prodiges et de merveilles qu’il faudrait observer et Lorraine Daston a montré déjà que la curiosité dirigée vers l’étrange et le bizarre pouvait être considérée comme la première forme de l’esprit empirique : il s’agissait de soumettre les merveilles et les monstres à l’examen, au même titre que le banal et le commun[9]. Et ce, même si certains naturalistes déplorent l’attention excessive portée au surnaturel et encouragent leurs pairs à embrasser l’ensemble du monde naturel en ne négligeant pas les espèces les plus banales et les plus communes[10]. Au XIXe siècle où, selon Michel Foucault, « la théorie de la représentation disparaît comme fondement général de tous les ordres possibles ; le langage comme tableau spontané et quadrillage des choses »[11], les objets et les choses du savoir accèdent, par rapport au langage, à une autonomie certaine et gagnent une cohérence propre, liée à l’introduction, dans leur appréhension, d’une certaine historicité. Mais les monstres et les merveilles (les surnaturalia) resurgissent alors sous la plume d’Étienne et d’Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, notamment, comme les preuves possibles d’une transformation progressive des espèces ; les classer en un tableau taxinomique, inventer une science des monstres est une manière de réintroduire le monstrueux dans le banal pour mieux comprendre les lois de la Nature et de l’évolution des espèces communes. Interroger la nature « monstrueuse » ou « merveilleuse » des objets recueillis par Oh-Oh, Bouvard et Pécuchet, l’architecte ou le voyageur est aussi une manière de réfléchir plus largement à la valeur herméneutique d’un objet jugé digne de figurer dans un musée.
L’idée de l’incongruité de la confusion, dans les romans, entre le musée et le cabinet pourrait aussi, d’un point de vue plus anecdotique cette fois, se heurter à la création en 1841 par Phineas Taylor Barnum de l’American Museum of New York. Le musée était alors conçu comme un mélange très éclectique d’attractions sensationnelles et voyantes telles que Tom Pouce ou que la sirène des Fidji, d’espèces naturelles, d’œuvres d’art et de figures de cire. Mais cela ne suffit pas à expliquer les raisons pour lesquelles Melville, dans Mardi, est si fidèle aux descriptions des cabinets de curiosités du XVIe et du XVIIe siècles en n’oubliant aucune de leurs composantes les plus fréquentes pour énumérer les merveilles d’Oh-Oh : on y retrouve en effet non seulement les « œuvres de Dieu », les produits de la nature et les fabrications humaines dignes d’une nature d’avant la révolution scientifique où des similitudes sont suggérées entre le visible et l’invisible, mais aussi les instruments scientifiques (télescope et microscope) qui incarnent le primat de l’observation ainsi que des livres. Et toutes ces composantes sont exactement celles que définit le catalogue de Pierre Borel étudié par Krzysztof Pomian au moment où celui-ci, étudiant la « culture de la curiosité », entreprend de donner l’exemple de ce qu’un cabinet pouvait être à l’âge moderne[12].
Car les cabinets de curiosités et les collections privées naissent au XVIe siècle et se sont développés au XVIIe siècle avant de progressivement disparaître au Siècle des Lumières[13]. Le premier musée national et public est créé en 1753 : le Parlement britannique fonde le British Museum. Le Muséum d’Histoire naturelle de Paris est créé officiellement, à partir du Jardin du Roi, en 1795. En d’autres termes, si la superposition romanesque du cabinet de curiosités au musée ne signifie peut-être pas de manière manifeste la résurgence d’une épistémé pré-moderne dans la littérature d’un siècle dit « positif », elle témoigne d’un certain anachronisme : bien que contemporains des musées, les auteurs des Wahlverwandtschaften, de Mardi et de Bouvard et Pécuchet privilégient, au moment d’exposer un lieu et des objets du savoir, le caractère étrange, désordonné et hétéroclite du cabinet de curiosités.
L’énigme de la référence constante à ce type de lieux désuets se double d’un certain nombre de différences de nature, de structure et de visée qui devraient empêcher qu’on confonde cabinets et musées. Les « raretés » et « curiosités » sont par définition étranges et uniques ; les espèces exposées dans les galeries des musées d’histoire naturelle sont banales et communes. Le musée est le lieu de l’ordre systématique : l’ordre spatial dans lequel sont rangés les objets montrés est dicté par les taxinomies élaborées par les savants naturalistes ; le cabinet est par nature hétéroclite et l’ordre qui préside à l’exposition de ses composantes ne se donne pas immédiatement. Le musée est la somme exhaustive des composantes du monde naturel ; le cabinet est un microcosme, reflétant le macrocosme. Le musée ouvre ses portes au grand public ; le cabinet est réservé le plus souvent aux érudits ou aux savants, il est une collection privée.
Que serait alors l’étrange monstre romanesque composé de la surimposition du cabinet au musée ? Un espace fictif où l’ensemble des oppositions mentionnées ci-dessus deviendraient autant d’interrogations sur la nature des savoirs et sur le rapport entre les savoirs et leurs « objets ». Plus fondamentalement, la présence des musées et des cabinets de curiosités dans trois romans du XIXe siècle pourrait être interprétée comme l’indice d’une interrogation fondamentale sur l’ordre du savoir contemporain, sur la spécialisation en cours et sur le but du savoir scientifique.
L’inscription de ces lieux d’exposition dans le tissu romanesque est aussi, d’un point de vue poétique, une gageure. Musées et cabinets ne racontent pas, ne décrivent pas, mais exposent. Tenter de se faire l’équivalent, en mots, de ce qui devrait s’en passer est une manière de mettre à l’épreuve la capacité du roman à décrire et exposer. Et le catalogue des composantes de ces lieux du savoir, par lequel le roman éprouve ses vertus descriptives, s’accompagne nécessairement du récit de leur visite. Les cabinets et les collections ne se donnent, dans les romans, que visités par certains des principaux personnages. Ces lieux romanesques sont, en littérature, les exacts équivalents de tableaux tels que le Cabinet d’amateur de tableaux de Frans Francken II ou le Cabinet d’Art de Cornelis Van der Geest de Wilhelm Van Haecht. De ces espaces on peut dire ce que Pomian déclare à propos des représentations picturales de cabinets ; ils désignent le roman comme une « allégorie de l’appréhension par l’homme des œuvres de la nature et de l’art »[14]. Faut-il ajouter que le roman est lui-même une œuvre de l’art et que, derrière une expérimentation romanesque des rapports entre les mots et les choses, se joue alors la tension, à l’intérieur du roman, entre plusieurs modalités possibles du rapport entre le récit et le monde, entre plusieurs chemins possibles d’une connaissance romanesque qui puisse définir ses objets propres ? Il s’agirait en quelque sorte de vider ces lieux empruntés aux savoirs en critiquant la valeur herméneutique de leurs composantes pour mieux les remplir à nouveau d’objets romanesques signifiants.
La critique romanesque des objets du savoir
Parmi les objets qui composent les diverses collections présentes dans Die Wahlverwandschaften, Mardi et Bouvard et Pécuchet, se retrouvent ceux qui traditionnellement composent les grandes collections contemporaines. Les trois romans sont encore tributaires des modèles contemporains des collections et des cabinets privés et semblent cependant se saisir du lieu « nouveau » du musée pour accentuer et caricaturer des tensions propres à la constitution des cabinets d’antiques et de curiosités.
Les collections présentées comme telles dans le roman de Goethe semblent obéir à des critères d’ordre et de sélection bien définis. Les objets qui les composent en effet se caractérisent par leur relative homogénéité. D’un côté, l’architecte perpétue la tradition des cabinets d’antiques en recueillant des armes et des monnaies dans des tertres funéraires ou en collectionnant les esquisses de portraits funéraires ; de l’autre, le voyageur anglais présente, dans « la plus agréable et la plus intéressante des collections » des esquisses de paysages et de lieux historiques[15]. Tous les objets recueillis ont valeur de témoignage historique et se distinguent de curiosités ou de raretés naturelles dont Odile, avant d’avoir contemplé les dessins du voyageur, condamne la bizarrerie. Cela ne signifie pas pour autant que la collection soit indemne de tout soupçon et que sa contemplation vaille acquisition d’un savoir.
La collection d’antiquités nordiques de l’architecte est en effet si bien présentée, si bien ordonnée, qu’elle modifie la nature même des objets exposés. Plus exactement, le regard porté sur ces objets ne retient plus guère leur signification historique : « Er hatte alles sehr reinlich und tragbar in Schubladen und Fächern auf eingeschnittenen, mit Tuch überzogenen Brettern, sodaβ diese alten, ernsten Dinge durch seine Behandlung etwas Putzhaftes annahmen und man mit Vergnügen darauf wie auf die Kätschen eines Modehändlers hinblickte »[16]. La manière même dont sont agencés les objets historiques leur confère une futilité propre qui empêche qu’ils instruisent réellement le spectateur ; l’esthétique l’emporte sur le savoir.
Devenue la vitrine d’une boutique de modiste, la collection de l’architecte est mise sur le même plan que le cadeau d’anniversaire d’Édouard et ressemble fort aussi aux étuis de métal soudés qui sont supposés constituer des témoignages de l’époque présente pour les temps à venir. Par un curieux hasard, ceux-ci renferment aussi bien des plaques de métal gravé de « toutes sortes de faits remarquables », que des pièces, qui deviendront antiques, et que des « peignes de chevelure, des flacons de parfum et d’autres parures » dignes à nouveau d’une boutique de modiste[17]. Dans ce cabinet de curiosités en miniature, l’analogie des antiquités avec les futilités des modistes prend un sens littéral et ce petit étui s’oppose moins aux collections « sérieuses » de l’architecte et du voyageur qu’il ne les redouble. L’ordre qui alors obéit à un critère de sélection suspect équivaut à un certain désordre, l’intérêt savant des objets exposés peut être remis en cause. Il se pourrait même que le seul fait de les exposer, de les mettre en scène, les vide de tout intérêt savant : dans les musées comme dans les romans, la mise en forme est susceptible de métamorphoser la nature et le sens de ce qui est dit.
Les descriptions comiques par Flaubert et Melville des musées de Bouvard et Pécuchet et d’Oh-Oh caricaturent encore le désordre qui y règne et l’aspect hétéroclite des objets qui les peuplent. Certes on peut retrouver la trace, dans chacun des deux musées, des grandes catégories traditionnelles des « raretés » admises dans les cabinets. Les naturalia pourraient être assez bien illustrées à la fois par les « deux noix de coco (appartenant à Pécuchet depuis sa jeunesse » qui ne sont plus guère cependant, en 1880, des espèces exotiques rares et inconnues, par le « chat tenant une souris dans sa gueule, – pétrification de Saint-Allyre »[18] ou encore par le « squelette complet d’un immense requin-tigre avec, à l’intérieur, les os de la jambe d’un pêcheur de perles »[19]. Les artificialia et les scientifica qui révèlent le talent des hommes sont également présentes dans les deux musées. Les antiquités de la maison de Chavignolles contiennent comme il se doit des armes, des pièces et une statue dont la description empêche qu’on y lise la trace d’un passé antique ou d’un artisanat remarquable : « Mais le plus beau, c’était dans l’embrasure de la fenêtre, une statue de saint Pierre ! Sa main droite couverte d’un gant serrait la clef du Paradis, de couleur vert pomme ; sa chasuble que des fleurs de lis agrémentaient était bleu ciel, et sa tiare très jaune pointue comme une pagode »[20]. Les artificialia dans Mardi sont désignées par la description que le narrateur en fait dans des commentaires entre parenthèses et en italiques, mais leur désignation principale, dans le texte, suggère qu’elles sont bien davantage, aux yeux du collectionneur des surnaturalia : il en va ainsi du « mystic fan »[21] qui pourrait constituer le résultat banal de l’artisanat des mers du Sud. L’ironie du narrateur vient donc, dans un cas comme dans l’autre, mettre en doute la capacité même d’inscrire a priori les objets exposés dans les grandes catégories de curiosités répertoriées.
Le choix, par le narrateur et par le collectionneur, de certaines de ces raretés suggère même que la définition de ces objets en termes de « raretés » et de curiosités tient davantage à leur présence dans un cabinet ou dans un musée qu’à leur propre nature. La première pièce du musée de Chavignolles est « une vieille poutre de bois » qui « se dressait dans le vestibule »[22]. Elle n’est pas sans rappeler le « inscrutable, shapeless block of a mottled-hued, smoke-dried wood. (Three unaccountable holes drilled through the middle) »[23] du cabinet d’Oh-Oh. Dans les deux cas, une pièce de construction tout à fait banale devient une « curiosité » à partir du moment où elle est extraite de son domaine d’usage pour être exposée, seule, dans un musée. L’insistance ironique et hyperbolique du narrateur, dans la description et dans son commentaire, sur le caractère « mystérieux » ou « inexplicable » de l’objet dit assez que cet objet n’est rare ou merveilleux que d’être exposé et décrit dans le lieu où il se trouve. Plus fondamentalement aussi, elle suggère que le caractère merveilleux ou remarquable d’un objet tient souvent davantage à l’ignorance de celui qui le possède qu’à l’objet lui-même.
Du même coup, Flaubert et Melville résolvent l’apparente contradiction entre le « banal » exposé dans les musées et l’extraordinaire propre aux cabinets : un objet « commun » ou « banal » peut passer pour une rareté à partir du moment où on l’extrait de son contexte et, inversement, un spécimen peut sembler extraordinaire à cause de l’ignorance où l’on est de l’existence d’autres spécimens semblables. Les raretés des cabinets ne le sont que parce que le collectionneur les estime telles et leur choix dépend donc de l’état des connaissances de ce collectionneur ; les espèces exposées dans les musées sont choisies par des naturalistes en fonction des progrès des découvertes accomplies et procèdent tout autant d’un critère de sélection susceptible de varier au fur et à mesure de l’acquisition de connaissances nouvelles ou de variations dans les définitions théoriques des espèces et des genres. Le même soupçon d’arbitraire pèse sur le cabinet et sur le musée.
Les musées fictifs décrits regroupent souvent des objets qui, n’étant pas par nature remarquables, le deviennent en pénétrant dans l’espace du musée et qui, de plus, ne sont « remarquables » que par la description qu’on en fait. Le narrateur de Mardi mime le caractère arbitraire de la sélection, par le collectionneur, des objets de son cabinet en s’amusant à son tour à présenter le catalogue de la collection comme le résultat de la sélection qu’il a faite lui-même des « most prominent of his rarities »[24]. Dans ce cas, la description dénonce moins le pouvoir du langage à fabriquer des merveilles qu’elle ne mime, dans le langage, l’application de critères de sélection savants au choix d’objets faisant sens et son caractère arbitraire.
Le caractère arbitraire du choix présidant à l’exposition des objets retenus par les collectionneurs apparaît d’autant mieux, dans Bouvard et Pécuchet, que le musée se transforme pour faire place à des « galeries » dont la valeur scientifique n’apparaît pas immédiatement. Il suffit en effet que Bouvard et Pécuchet se plongent dans l’archéologie celtique et que le narrateur affirme qu’« un culte obscène a persisté » là où il y a des menhirs pour que les deux protagonistes ajoutent à leurs salles d’exposition « un compartiment nouveau, celui des Phallus »[25]. L’hypothèse savante de la signification symbolique des menhirs a certes dicté le choix des objets exposés à la manière dont une théorie naturaliste reposant sur une taxinomie préside au choix des spécimens montrés et à l’ordre de leur exposition. Mais les objets si hétéroclites exposés alors ne viennent plus illustrer ou prouver la théorie initiale et la théorie ou le symbole, ici, président au plus grand chaos sans que ce chaos ne révèle rien des lois du monde ou de la Nature. De même que Buffon critiquait Linné sous le prétexte qu’en choisissant arbitrairement de classer les plantes suivant la configuration de leurs organes sexuels, il ne parvenait qu’à ranger dans des catégories identiques des plantes qui jamais, dans la nature, ne se côtoyaient ou ne se ressemblaient, Bouvard et Pécuchet, dans le compartiment nouveau du musée, représentent le monde, dans son ensemble, à travers la grille du « phallus » et ne révèlent plus rien alors des composantes de ce monde.
Le risque de la tautologie d’un discours qui, sous couvert de s’ouvrir à l’extériorité (en reposant sur des objets du monde extérieur), ne renvoie qu’à lui-même apparaît, ainsi que l’idée d’un certain arbitraire de théories savantes qui prétendent reposer sur des preuves fabriquées ; l’objectivité savante connaît là une crise. La tautologie est en cause lorsque des objets ne deviennent remarquables que par leur présence dans le musée (est alors remarquable, aux yeux du visiteur, ce qui figure dans un lieu qui ne réunit que des objets remarquables) et l’arbitraire des choix présidant à la constitution des collections s’illustre dans les romans par le désordre des descriptions.
Le lecteur n’a plus d’autre choix que de se fier à l’autorité du collectionneur dont seul dépend la sélection des collections de raretés et de curiosités. Or Mardi et Bouvard et Pécuchet ont en commun de faire du collectionneur lui-même un objet de sa collection. Cela vaut, littéralement, du roman de Flaubert où Bouvard participe au spectacle donné par les objets recueillis. Les urnes ne deviennent dignes d’intérêt que lorsque Bouvard en montre l’usage à Mme Bordin et M. Marescot : « il approcha de ses yeux la fiole, afin de montrer par quelle méthode les Romains y versaient des pleurs »[26]. Bouvard mime un combat pour animer l’exposition des vieilles armes, il joue enfin le rôle du moine pour augmenter encore l’effet du prie-Dieu et du vitrail : « Bouvard s’éloigna, et reparut, affublé d’une couverture de laine, puis s’agenouilla devant le prie-Dieu, les coudes en dehors, la face dans les mains, la lueur du soleil tombant sur sa calvitie ; – et il avait conscience de cet effet, car il dit : -« Est-ce que je n’ai pas l’air d’un moine du moyen âge ? »[27]. Le collectionneur participe au spectacle merveilleux offert par les curiosités ; il devient par là-même une de ces curiosités. Mais on peut soupçonner alors que, de même que Bouvard « fait » le moine, les curiosités du musée ne sont que des curiosités illusoires, des apparences de curiosités.
Fait écho à cela l’insistance du narrateur de Mardi sur l’aspect spectaculaire et remarquable du nez d’Oh-Oh : « And all Mardi over, a remarkable nose is a prominent feature , an ever obvious passport to distinction »[28]. Le nez de l’antiquaire est, parce qu’il est visible et remarquable, une merveille digne des curiosités qu’il collectionne ; comme ces curiosités, il se doit d’être « distingué » des autres. Mais peut-on se fier à un collectionneur dont la nature, comme celle des objets qu’il collectionne, devient elle-même objet de doute et d’interrogation ? Le nez d’Oh-Oh permet de nouveau de répondre à cette question et sa « topographie » en fait une métonymie de l’antiquaire lui-même : « an exclamation point in the face of the wearer, forever wondering at the visible universe »[29]. Comme l’indiquait déjà son patronyme, l’antiquaire est celui qui admire tout et n’importe quoi et cette admiration perpétuelle, cette curiosité extrême devient elle-même l’objet de notre curiosité. Dès le XVIIe siècle, Descartes condamnait les dérives possibles de l’admiration vers la superstition[30] : l’admiration sans bornes d’Oh-Oh le conduit tout droit, parce qu’elle repose sur l’ignorance, à l’idolâtrie. Là encore, il semble moins que Melville, Flaubert ou Goethe n’aillent chercher dans la philosophie de l’âge moderne les critiques de la forme ancienne du cabinet de curiosités qu’ils n’en élargissent la portée en les appliquant également aux musées et à la science « moderne ».
La presque totalité des objets constituant le catalogue des merveilles « les plus remarquables » d’Oh-Oh est constitué de « preuves » historiques d’une religion mardienne ; ils sont aussi, comme l’écrit le narrateur, des « relics »[31]. Le lecteur ne peut s’empêcher de sourire toutefois en lisant les commentaires ironiques du narrateur qui désenchante la mythologie mardienne à laquelle croit l’antiquaire. Que penser du pot de fleur banal contenant la dernière empreinte du pied d’un Dieu parti pour des régions inconnues, si ce n’est que le pot a été vendu comme tel et pris pour tel par un collectionneur qui ne voit le monde qu’à travers ses croyances ? Que dire encore du peigne de sirène, qui pourrait n’être que la crête d’un oiseau si, comme le précise le narrateur entre parenthèses, Oh-Oh n’était pas par avance disposé à croire à l’existence des sirènes ? Oh-Oh est superstitieux, crédule et idolâtre et détourne l’espace du savoir que pourrait être le cabinet de curiosités en un ensemble d’objets banals que ses croyances transforment a priori en reliques et en preuves.
Il faut mettre à leur crédit que Bouvard et Pécuchet ne font preuve ni de la même superstition, ni de la même crédulité. Leur expérience mystique et religieuse les conduit à discuter du sens littéral et allégorique des Écritures, à interroger le curé sur les « preuves » des miracles et se heurte au refus de la superstition dont fait preuve madame de Noaris en conservant des reliques et de remèdes saints[32]. Mais le musée des deux bonshommes traduit peut-être une autre forme de superstition, une confusion possible entre la Religion et la Science soutenue alors par les prophètes du scientisme. Ainsi se comprendrait peut-être leur intérêt tout particulier pour les cultes idolâtres. Et Bouvard et Pécuchet qui, à chaque visite, se demandent « si le visiteur méritait qu’on fît « le moine du moyen âge » » cherchent manifestement à produire une forme d’effroi sacré devant ce que le visiteur ne peut comprendre (parce qu’il n’y a précisément rien à comprendre)[33].
Sur un mode parodique et dégradé, Flaubert réinvente à Chavignolles un musée dont les composantes ne peuvent être admirées que par des ignorants : n’est-ce pas là un des risques du musée que de transformer des objets du savoir en objets « sacrés » et de forcer l’admiration d’un public qu’on voudrait instruire ? Cette dénonciation du musée comme un temple sacré dont les composantes ne peuvent être appréhendées (et non nécessairement comprises) que par des sectateurs zélés et idolâtres résume assez bien la critique formulée par Odile, dans son journal, des collections naturalistes : « Ein Naturalienkabinett kann uns vorkommen wie eine ägyptische Grabstätte, wo die verschiedenen Tier – und Planzengötzen balsamiert umherstehen. Einer Priesterkaste geziemt es wohl, sich damit in geheimnisvollen Halbdunkel abzugeben ; aber in den allgemeinen Unterricht sollte dergleichen nicht einflieβen, um so weniger, als etwas Näheres und Würdigeres sich dadurch leicht verdrängt sieht »[34]. Le cabinet dont il est question est manifestement moins la galerie du musée que le cabinet de « curiosités » où le naturaliste concentre son attention sur les espèces exotiques et inconnues. La métaphore filée de la sépulture et de la caste assimile le savoir spécialisé à une forme d’idolâtrie et à un savoir mort au monde ; les objets et le discours des sciences spécialisées deviennent inaccessibles au large public qui ne peut à son tour, face aux découvertes savantes, que se fier à l’autorité des spécialistes et idolâtrer un savoir qu’il ne peut acquérir.
L’image du tombeau parcourt aussi la description des collections de l’architecte dans Die Wahlverwandtschaften. Celui-ci ne s’intéresse qu’aux objets trouvés dans les tombeaux anciens ; ces objets appartiennent au royaume de la mort et, d’un certain point de vue, sont déjà morts au monde. À moins que leur déplacement dans une collection ne soit précisément ce qui les éloigne le mieux du monde et ce qui les désigne comme un savoir vain et inutile. La manière dont l’architecte justifie de plus le fait de réserver sa collection à ceux qu’il en juge dignes témoigne d’un respect sacré pour ce qu’il expose, dont on ne sait au juste s’il faut le prêter à l’écrivain qui ainsi suggérerait les limites auxquelles se heurte l’entreprise de vulgarisation des savoirs par les musées publics : « Wenn Sie wüβten, sagte er, wie roh selbst gebildete Menschen sich gegen die schätzbarsten Kunstwerke verhalten, Sie Würden mir verzeihen, wenn ich die meinigen nicht unter hin und her gehen laβe »[35]. Odile ajoute alors qu’« il ne serait pas mal d’insérer, à l’avenir, dans les manuels de civilité, après les chapitres sur la façon de se comporter à table en société, un chapitre bien détaillé sur la manière de se conduire dans les collections et les musées »[36]. L’intérêt de l’exposition publique se heurte donc non seulement à l’ignorance du peuple (du monde ici) mais aussi à son manque de savoir-vivre.
Le narrateur de Mardi use exactement de la même métaphore de la sépulture sans toutefois lui accorder la signification d’une nécessaire sacralisation de l’œuvre d’art ; ne demeure là que la dénonciation du cabinet de curiosités comme d’un lieu d’exposition de savoirs morts au monde parce qu’ils ne méritaient sans doute pas d’y demeurer. Dès le chapitre CXXII est suggérée, par la description des lieux visités, qu’on s’enfonce dans les méandres d’un souterrain en pénétrant dans l’antre d’Oh-Oh : « But within, so intricate and grotesque its brown alleys and cells that the interior of no walnut was more labyrinthine.
And here strewn about, all dusty and disordered, were the precious antics […]”[37]. L’espace romanesque du cabinet n’incarne pas seulement d’emblée le désordre et l’étrangeté ; fouillis « poussiéreux », il devient un cabinet de vanités, rappelant aux hommes et aux savoirs qu’ils sont mortels : dans ce labyrinthe inextricable « dorment » des antiquités. L’analogie du cabinet et du tombeau se précise au chapitre suivant dont le titre désigne explicitement les galeries de curiosités comme des « Catacombs »[38]. La description de la bibliothèque qui clôt celle du cabinet de Mardi répond mot pour mot aux propos d’Odile : « Upon gaining the vault, frth flew a score or two of bats, extinguishing the flambeau and leaving us in darkness, like Belzoni deserted by his Arabs in the heart of a pyramid. The torch at last relumed, we entered a tomb-like excavation, at every step raising clouds of dust, and at last stood before long rows of musty, mummyish parcels, so dingy-red, and so rolled upon sticks that they looked like stiff sausages of Bologna but smelt like some fine old Stilton or Cheshire[39]. L’irrévérence de la dernière comparaison empêche de lire cette description comme un plaidoyer pour la sacralisation des arts et des savoirs. Certes l’image des « saucisses » contribue à réduire les manuscrits observés à leur simple matérialité et participe peut-être de cette pétrification du langage et des livres qui contribue à les sacraliser. Mais, introduisant dans un lieu de culte aux savoirs vains un prosaïsme certain, il est aussi ce qui désacralise : les livres sont ici devenus des choses insignifiantes que l’humour des narrateurs contribue à faire revivre, ne serait-ce qu’en en dénonçant l’inanité.
Le mot et la chose
L’humour qui, dans les trois romans, préside de manière plus ou moins manifeste à la description des collections est le moyen dont usent les trois écrivains pour marquer l’écart qui peut exister entre une exposition d’objets et sa description romanesque en mots. Les musées et cabinets de curiosités sont à chaque fois l’occasion de proposer des articulations nouvelles des mots et des choses, de réfléchir sur la préséance des premiers ou des seconds. La transposition, dans le roman, de telles expositions, se heurte immédiatement à l’aporie évidente de ne pouvoir donner à voir des objets sans les passer au crible des mots qui les disent. Se situant d’emblée dans la sphère du langage, le cabinet ou le musée romanesque doit tenter à la fois de faire voir et de faire comprendre : le lecteur doit pouvoir imaginer les objets décrits et comprendre ou interpréter les raisons de leur présence dans le récit. Chacun à leur manière, Flaubert, Goethe et Melville résolvent l’aporie d’un microcosme romanesque qui ne fait signe que dans le roman et interroge cependant le rapport entre le récit et le monde extérieur, objectal en réfléchissant à la manière dont le mot peut se faire l’équivalent de la chose, la remplacer et, parfois, la dénaturer.
Pour que les collections de dessins du voyageur anglais intéressent Charlotte et Odile, il faut, manifestement, que la contemplation s’accompagne de récits et de discours : « Ein groβes Portefeuille das er mit sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sie, theils durch das Bild, theils durch die Auslegung »[40]. L’image ne se suffit pas à elle-même pour faire sens et cela vaut particulièrement de représentations de lieux historiques qui ne méritent d’orner la collection que parce qu’ils ont « un nom dans l’histoire »[41]. Le lieu ne vaut pas en soi mais a été investi d’un sens par le récit des événements qu’il a abrités ; le récit historique préside à la sélection des objets remarquables. De la même manière, l’ouvrier qui préside à la pose de la première pierre engage les invités d’Édouard et de Charlotte à déposer dans des étuis de métal des « objets, destinés à servir de témoignages à un lointain avenir »[42] ; autant d’objets, donc, qui ne méritent pas de figurer dans les boîtes soudées pour ce qu’ils signifient au moment du récit mais pour ce qu’ils signifieront dans les récits historiques à venir. Les choses et les mots se confondent ici et il semble même que les mots précèdent les choses ou, plus exactement, que les choses ne soient « remarquables » qu’à cause des mots qui les disent ou les diront ; encore faut-il que le lecteur ou le spectateur sache leur donner un sens.
Ces mots qui confèrent un sens nouveau et inédit aux choses, qui les excluent du sens commun et du langage ordinaire, peuvent relever soit du récit historique, soit du discours savant, soit encore de la légende. L’exemple sans doute le plus fameux, dans Bouvard et Pécuchet, de la manière dont le discours savant et le récit imaginaire peuvent envahir le monde romanesque au point d’investir les objets communs de caractéristiques extraordinaires, est celui du vieux bénitier enfoui dans le cimetière sur lequel le comte de Faverges attire l’attention des deux bonshommes[43]. Les deux collectionneurs identifient immédiatement, en le voyant, une « cuve druidique » mais décident cependant, sur les conseils de Larsonneur, de se renseigner sur les rites celtes. Ils entreprennent, après de multiples lectures, de voir les menhirs qui, « d’une égale insignifiance, les ennuyèrent promptement »[44] : l’objet en lui-même ne signifie rien et la pierre a perdu là toute signification. Leur guide, cependant, les mène vers de gigantesques blocs de granit et ce cadre minéral devient le lieu de scènes de sacrifices imaginaires : « Il était facile d’imaginer sous les feuillages, les prêtres en tiare d’or et en robe blanche, avec leurs victimes humaines les bras attachés dans le dos – et sur le bord de la cuve la druidesse, observant le ruisseau rouge, pendant qu’autour d’elle, la foule hurlait, au tapage des cymbales et des buccins faits d’une corne d’auroch »[45]. Cette scène fantasmée à partir du paysage et des lectures savantes est alors ce qui justifie que le vieux bénitier du cimetière soit, aux yeux de Bouvard et Pécuchet, une cuve druidique et mérite donc de figurer parmi leurs curiosités archéologiques. C’est ici l’image, la « figure » qui préside au choix des objets : plus exactement les objets fictifs retenus deviennent le référent fictif d’un sens figuré ; c’est la fiction qui définit la nature des objets exposés.
Dans le cabinet d’Oh-Oh, le récit précède l’objet et, seul, le justifie : « The old man was exceedingly importunate in directing attention to his relics, concerning each of them he had an endless story to tell. Time would fail-nay, patience, to repeat his legends »[46]. C’est dire assez que quiconque verrait ces objets, sans connaître les légendes auxquelles le collectionneur veut croire, ne verrait sans doute pas le moindre intérêt dans ces reliques, ni ne leur accorderait la moindre signification. C’est dire aussi la distance qui peut exister entre la nature de ces objets et ce qu’ils sont supposés être dans l’espace du roman. Les objets romanesques ne sont donc exposés qu’à titre de preuves imaginaires de croyances légendaires : la fiction, là, envahit le monde des objets qu’elle investit de définitions et de descriptions propres, sans que ces objets puissent faire signe vers un extérieur de la fiction.
Encore faut-il nuancer : si les curiosités extravagantes d’Oh-Oh ne font que justifier a posteriori la crédulité de l’antiquaire, ces raretés ne sont pas immédiatement admises comme telles dans l’espace du roman où le narrateur introduit un écart entre la description que pourrait en faire l’antiquaire et celle qu’il en fait.
Le narrateur de Mardi refuse en effet de se faire l’écho des récits imaginaires de l’antiquaire et entreprend de dresser en son nom un catalogue de ces « merveilles » : « So in order here follow the most prominent of his rarities »[47]. Dans l’ordre romanesque, l’énumération pourrait être le strict équivalent du musée ou du cabinet de curiosités. L’objectivité affichée par le narrateur se traduit par la juxtaposition des mots ou des phrases dont la succession ne répond a priori à aucune logique. Devant une énumération, le lecteur, comme le visiteur du musée, est invité à considérer le mot pour lui-même et à rétablir un ordre qui ne se donne pas immédiatement. Dans doute Melville est-il celui des trois auteurs qui use jusqu’à l’extrême de l’énumération et de la rupture qu’elle introduit dans le récit. Mais la première description du musée de Bouvard et Pécuchet obéit au même impératif : le récit pose ou expose des groupes nominaux ou des phrases qu’aucune connexion logique ne relie entre eux : « Une vieille poutre de bois se dressait dans le vestibule. Les spécimens de géologie encombraient l’escalier ; – et une chaîne énorme s’étendait par terre tout le long du corridor »[48]. L’usage quasi systématique des verbes pronominaux réduit la description au seul objet et évite d’introduire la moindre perspective ; la ponctuation accentue encore l’autonomie de chacune des composantes du paragraphe. À peine la description semble-t-elle obéir à un ordre spatial ; sitôt qu’un plan est défini, il est envahi par une multitude qui vient elle-même nier la moindre tentative de subsumer la diversité des objets sous une catégorie nominale quelconque : « Une table au milieu exhibait les curiosités les plus rares : la carcasse d’un bonnet de Cauchoise, deux urnes d’argile, des médailles, une fiole de verre opalin »[49]. Comment la plus grande rareté pourrait-elle se dire au pluriel ? Sans doute le paradoxe de la rareté des médailles vient-il souligner l’ironie d’une description supposée objective où le narrateur, par la description, dénonce l’inanité des critères de sélection choisis par les collectionneurs et désigne les rouages par lesquels un mode d’exposition, même littéraire, peut modifier la nature d’un objet banal et inintéressant.
Au sein même de l’énumération qui exhibe chaque nom ou chaque description pour elle-même en lui refusant tout lien avec le récit, la description de l’objet absent peut se dédoubler et offrir deux désignations entre lesquelles le lecteur, plus ou moins sensible à l’ironie du narrateur, est sommé de choisir. Dans les chapitres CXXII et CXXIII, Melville a à deux reprises recours à l’énumération. La typographie utilisée dans le texte original comme dans la traduction de Philippe Jaworski contribue, sur l’espace de la page, à créer alors un espace propre. Dans le cadre du catalogue des raretés se succèdent à chaque « objet » une phrase descriptive suivie, entre parenthèses, de ce qui pourrait être un commentaire ou un complément descriptif, sans qu’on sache exactement si l’une ou l’autre phrase relève du narrateur ou du collectionneur (dont le narrateur reprendrait en les résumant les propos avant d’ajouter un commentaire de son cru entre parenthèses). L’usage dans la traduction en français de commentaires en italiques accentue la polyphonie de ce catalogue.
Flaubert joue également du dédoublement de la description et de la désignation pour jeter le doute sur la nature des objets décrits : à une première description, qui use systématiquement des structures de l’énumération, répond la description du musée visité par Mme Bordin et M. Marescot où Bouvard se livre à une « démonstration »[50] et il est maintes fois suggéré, en réponse à l’étonnement des visiteurs, que les objets recueillis ne le sont qu’au nom de ce qui a été dit d’eux ou de ce qu’on a imaginé de leur usage. Même la justification de leur présence par le récit ne suffit pas à convaincre les visiteurs de leur intérêt réel ; en témoigne le mépris de Marescot : « Il ne comprenait pas cette galoche qui avait été l’enseigne d’un marchand de chaussures, ni pourquoi le tonneau de faïence, un vulgaire pichet de cidre »[51]. Le récit des aventures rares dont ces objets sont les « témoins » ne suffit donc pas à faire oublier leur banalité et la seconde, sans doute, contribue à rendre suspect le récit de leur rareté. Mais l’opposition qui surgit ici n’est pas seulement celle qui séparerait la description (à même de cerner les caractéristiques physiques de l’objet) du récit (qui investirait l’objet de qualités extraordinaires). C’est au sein même des moments les plus descriptifs que l’écart entre la désignation et l’objet désigné se fait le plus grand.
Dès l’énumération liminaire, par le narrateur, des trésors de ses protagonistes, apparaissent en effet les indices d’une double définition (et désignation) possible des objets décrits. On se heurte ainsi à une « auge de pierre » que des parenthèses transforment en « (un sarcophage gallo-romain) »[52] ; sans la précision entre tirets que le « chat tenant une souris dans sa gueule » est une « – pétrification de Saint-Allyre – »[53], le lecteur pourrait se demander ce qui rend un tel spécimen si remarquable. Et il ne pouvait guère se douter de la nature exacte de la « vieille poutre de bois »[54]si Bouvard manifestement n’avait éprouvé le besoin de préciser à ses hôtes que « la poutre n’était rien moins que l’ancien gibet de Falaise, d’après le menuisier qui l’avait vendue – lequel tenait ce renseignement de son grand-père » (p. 169). Sans doute cette voix qui chuchote entre parenthèses ou entre guillemets vient-elle souligner l’écart qui peut exister entre la chose et le mot ; elle ressemble fort à du discours indirect libre qui, dès la description liminaire, ne dit pas son nom mais qui par l’ironie se moque de ce que les collectionneurs croient détenir. Il n’en demeure pas moins que le texte descriptif, revenant ainsi sur lui-même au moment où il est supposé refléter au moins formellement l’objectivité de l’exposition muséale, semble à la fois pousser à l’extrême sa capacité à décrire des objets du monde extérieur et exposer son pouvoir de transformer les objets par des mots qui eux-mêmes deviennent des objets dont le sens est propre à l’espace romanesque : les collections de Bouvard et Pécuchet excluent du monde de l’expérience des objets banals et connus de tous et leurs confèrent, en les désignant ou en les définissant de manière extravagante, de nouvelles significations. Le mot qui dit la chose semble avoir lui-même été pétrifié (sorti de son usage et érigé en tout autonome par l’énumération) pour devenir un objet signifiant, à l’intérieur de la fiction. Et que cela se dise au moment où le roman fait place, par l’énumération, à un cas-limite de description, donc au moment où le roman est supposé mettre à l’épreuve sa capacité à décrire le monde de l’expérience n’est pas innocent.
Bien souvent au chapitre CXXII de Mardi, la description ou la désignation seconde des antiquités, entre parenthèses, remet en cause la validité de la première description tout en feignant de la justifier. Ainsi est-il précisé entre parenthèses que « The identical canoe in which, ages back, the god Unja came from the bottom of the sea » est « (Very ponderous ; of lignum-vitae wood) »[55]. Dans un premier temps semblent se succéder la désignation imaginaire (d’après la légende) et la description prosaïque de l’objet. La description de l’objet peut venir prouver le caractère remarquable de sa nature : venir du fond des mers avec un canoë « très pesant » confine nécessairement au miracle. Mais elle peut aussi avoir l’effet inverse et désigner le fossé qui sépare l’objet commun (le bois pesant d’un vulgaire canoë) de sa définition merveilleuse par un antiquaire crédule.
Le narrateur inverse parfois l’ordre du prosaïsme et de la merveille en décrivant dans un premier temps un objet banal et en suggérant entre parenthèses les raisons pour lesquelles il a été jugé digne de figurer dans le cabinet : le « bizarre petit hameçon » est supposé avoir été « (Fait avec les os digitaux de Kravi le Rusé) »[56]. La description peut aussi décréter « inexplicable » ou « rare » ce qui a priori ne semblait guère l’être : le bloc de bois mystérieux, informe, veiné, séché à la fumée est un bloc de bois de construction qui peut fort bien être percé de trous sans que ceux-ci ne soient inexplicables. À moins qu’il ne faille entendre par là la manière dont on peut rendre remarquable et énigmatique un objet utile ou artisanal en l’excluant de sa sphère d’utilité et, corrélativement, la manière dont un narrateur peut rendre un mot inexplicable en n’en faisant pas un usage commun. D’autres raretés sont plus inquiétantes en ce qu’elles font apparaître, sous couvert de description objective et exhaustive, l’idée d’une fabrication et d’une manipulation : il y a peu de chance pour qu’un squelette de requin n’ait pas laissé échapper les os de la jambe d’un pêcheur de perles et pour que ces os soient immédiatement identifiés comme étant ceux d’un pêcheur de perles. Il est probable cependant qu’Oh-Oh croie ce que le vendeur de cette « merveille » naturelle lui a dit d’elle.
Restent encore des cas où, dans le catalogue des curiosités d’Oh-Oh, des descriptions mêlent l’énumération des caractéristiques physiques de l’objet et sa désignation au point où l’on ne sait plus distinguer ce qu’est l’objet et ce à quoi il ressemble. Cela vaut particulièrement des reliques de sirènes. « A long tangled lock of mermaid’s hair, much resembling the curly silky fibres of the finer sea-weed. (Preserved between fins of the dolphin »[57]pourrait fort bien être des fibres d’une espèce d’algue très fine, prises dans les écailles d’un dauphin et pouvant figurer, pour qui croit en l’existence des sirènes, des « cheveux de sirènes ». Le discours ainsi, fabrique une merveille, en inversant comparant et comparé et la fiction donne corps alors au sens figuré. La même chose pourrait être dite du peigne de sirène fait de la crête d’un pétrel : ne s’agit-il pas avant tout à la crête d’un oiseau qui, pour celui qui croit aux sirènes, peut figurer un « peigne de sirène » ? Le commentaire entre parenthèses vient à la fois démontrer la puissance de la fiction à créer un monde métaphorique et dénoncer les dérives de la fabrication, par la fiction, de fausses merveilles.
Les descriptions qui composent le catalogue des objets d’Oh-Oh illustrent à chaque fois des écarts possibles entre les mots et les choses et, corrélativement, la manière dont les mots de la fiction peuvent fabriquer des choses. On peut donner à lire des « merveilles » en jouant de l’invraisemblance (du poids d’un canoë, par exemple), en fabriquant des monstres à la manière des tératologues, en rendant le langage commun énigmatique en lui ôtant tout référent, en usant enfin de comparaisons et de métaphores où le comparant fait oublier le comparé. L’énumération suggère qu’en se faisant l’équivalent du musée qui expose des objets ou du cabinet qui juxtapose des raretés, le récit romanesque met à l’épreuve la manière dont il peut user de mots pour fabriquer des merveilles et rompre paradoxalement avec toute tentation de référentialité, au moment même où il prétend décrire le mieux et avec le plus d’objectivité.
La récurrence, dans Mardi, Bouvard et Pécuchet et Die Wahlverwandschaften, des motifs des musées et des cabinets de curiosités, est l’indice de la manière dont les trois écrivains entendent mettre à l’épreuve les capacités descriptives et représentatives de la fiction romanesque. Hésitant entre le cabinet (ses objets remarquables, ses monstres et ses merveilles imaginaires) et le musée (sa tentation d’exhaustivité et la banalité de ses composantes), les trois écrivains se saisissent du traitement romanesque de ces lieux d’exposition pour dessiner différentes voies poétiques possibles : d’un côté, la tentation d’une fiction qui évolue dans un univers propre et n’entend pas représenter le monde de l’expérience et, de l’autre, l’idéal réaliste reposant encore sur l’impératif mimétique.
L’énumération romanesque des composantes de collections fictives est le lieu où se joue le passage entre une littérature tributaire encore de l’impératif aristotélicien de relater les actions des hommes et d’en cerner la signification à une littérature du détail et de l’objet, donnant autant d’importance aux objets qu’aux hommes, refusant la hiérarchie des sujets et des mots et pétrifiant finalement le langage littéraire pour le refermer sur sa propre matérialité. Les trois romans étudiés reflètent assez bien, d’un point de vue chronologique, l’écroulement du système des Belles-Lettres et le développement de la notion de « littérature ». Et Jean-Paul Sartre, dans Qu’est-ce que la littérature ?, prenait précisément exemple de Flaubert pour illustrer l’émergence des champions de la littérature pure : « Flaubert écrit pour se débarrasser des hommes et des choses. Sa phrase cerne l’objet, l’attrape, l’immobilise et lui casse les reins, se referme sur lui, se change en pierre et le pétrifie avec elle »[58]. L’objet exposé dans le musée imaginaire s’efface au profit du mot qui le dit et n’existe que d’être dit et ce mot lui-même se referme sur sa propre signification, « purement » romanesque. Mais il faudrait ajouter aussitôt que, dans les trois romans, les descriptions dédoublées des musées pétrifient les mots en s’interrogeant sur la possibilité, pour le mot, de dire la chose et en exposant les différentes articulations possibles de la chose et du mot. Si la « pétrification » des mots à l’œuvre dans les romans est bien la marque du renoncement à une certaine poétique héritée, elle est aussi, comme le souligne Jacques Rancière, l’occasion de proposer une nouvelle manière de lier les mots et les choses et de définir de nouveaux régimes de la représentation romanesque[59].
Passées au crible du choix opéré par le narrateur qui revendique la composition du « catalogue », les collections d’Oh-Oh, dans la description qui en est faite, retrouvent une signification ainsi que la capacité de faire signe vers un au-delà du récit légendaire qui n’est autre que l’espace romanesque de Mardi dans lequel évoluent le narrateur et ses compagnons. Or le musée et le cabinet de curiosités non seulement dessinent l’écart entre la légende et le roman mais se désignent aussi comme des microcosmes romanesques, comme des matrices du récit dans son ensemble.
Le livre et le monde
Pénétrant dans la collection « d’anciens et curieux manuscrits » conservés par Oh-Oh, le philosophe Babbalanja plaisante : « My lord, this is like going down to posterity »[60]. La déclaration peut être entendue au sens littéral : au chapitre CXXIII, les héros romanesques de Mardi prennent place dans la bibliothèque de l’antiquaire Oh-Oh et le roman qui contient la bibliothèque imaginaire devient aussi l’une de ses composantes. Sur les rayons de cette bibliothèque figurent d’ailleurs des chroniques dont les héros sont déjà des personnages de Mardiet l’on pourrait aisément tracer de nombreux parallèles entre les grandes catégories « génériques » retenues pour classer ou décrire les ouvrages de l’antiquaire et les genres que le roman accueille en son sein comme autant de modèles ou de repoussoirs. Certaines étagères pourraient accueillir Mardi qui ne déparerait pas l’ensemble des « long and tedious romances with short and easy titles»[61].
On ne peut traiter, dans des romans à vocation encyclopédique[62], de musées ou de cabinets de curiosités sans que le roman lui-même ne tende à devenir un lieu d’exposition des savoirs. L’effet de mise en abyme du roman par la description du cabinet se déploie en effet aussi bien dans Mardique dans Die Wahlverwandtschaften et dans Bouvard et Pécuchet. Ce sont dans les fondations imaginaires du texte que sont ensevelis les étuis de métal soudé, au chapitre IX des Affinités électives, et il revient au roman de conserver leur contenu pour la postérité qui saura leur donner un sens. Et le coffret des parures d’Odile, véritable cabinet de curiosités en miniature, est déposé dans le cercueil de la jeune femme qui, elle-même, devient grâce au couvercle en verre, objet de contemplation et d’admiration : le roman alors se fait sépulture.
Ni Goethe, ni Melville, ni Flaubert ne sont d’ailleurs les premiers à tenter de créer l’équivalent fictif du cabinet de curiosités. Dans l’avant-propos de l’Instauratio Magna Scientiarum (1626), Francis Bacon décrit le contenu de son ouvrage inachevé et consacré à l’histoire naturelle comme s’il s’agissait d’une collection comprenant à la fois les objets de la nature libre ou naturalia, les objets de la nature transformés par l’homme ou artificialia et les objets servant à transformer la nature ou scientifica. Il considérait donc qu’il était possible de faire le tour des connaissances et de proposer des disciplines savantes une nouvelle organisation en transposant, dans le domaine de la fiction utopique, le modèle du cabinet de curiosités. Déjà dans les Essays qui comprenaient un traité sur le voyage, Bacon recommandait aux voyageurs de visiter absolument les cabinets de curiosités ou de raretés, comme si leur observation pouvait tenir lieu de celle de l’ensemble du territoire[63] ; les compagnons de Mardi s’en souviennent sans doute. Le cabinet de curiosités de Padullah à la fois s’inscrit dans la lignée des îlots parcourus et constitue la matrice de l’ensemble de l’archipel ; sa description pourrait remplacer le récit romanesque de l’ensemble de la pérégrination et le récit, dans son entier, se désigner ainsi comme descriptif.
On ne peut nier que les romans de Goethe, de Flaubert ou de Melville contiennent, dans leur ensemble, un certain nombre de merveilles et de monstres. Si l’on accepte de plus que l’équivalent du monstre dans l’ordre romanesque peut être l’invraisemblable (ce qui a priori défie les lois du récit romanesque), il faut reconnaître aussi que les différents narrateurs manifestent un certain plaisir à désigner leur récit comme impossible et incompréhensible. Le lecteur de Mardi est ainsi averti du caractère invraisemblable du texte et de la nécessité de cette invraisemblance. Au chapitre XCVII, le narrateur se livre à une digression intitulée « Faith and Knowledge » et affirme : « A thing incredible is about to be related ; but a thing may be incredible and still be true; sometimes it is incredible because it is true”[64]. L’argument qui porte ici d’abord sur les relations entre le savoir et la foi est dans le chapitre suivant appliqué au genre du récit de voyage : « It was Samoa who told the incredible tale, and he told it as a traveler »[65]. Le passage de relai d’un narrateur à l’autre, par la reprise des mêmes termes, indique assez bien la mise en abyme : ce que le narrateur dit du récit du voyageur Samoa ne pourrait-il être dit également du récit du voyageur qu’est le narrateur, c’est-à-dire de Mardi lui-même ? Et, si le lecteur n’en était pas convaincu, il lui suffirait de lire la fin du roman pour s’en persuader : la plus grande invraisemblance, dans le domaine du récit de voyage réel ou imaginaire, consiste à raconter le récit d’un voyageur qui n’est pas revenu.
Goethe met également en scène de grossières invraisemblances comme si toute convention en la matière, pour ce qui est du roman des Affinités électives, importait peu. Elles s’incarnent dans le personnage du monstrueux petit Othon, si vite évacué du roman. Étrange mélange de ceux auxquels ses parents pensaient en le concevant, le petit Othon est un monstre qui provoque l’effroi d’Odile, pendant la cérémonie du baptême[66]. L’enfant imaginaire n’est pas, du point de vue des connaissances contemporaines en matière de génération, un cas possible et n’est pas destiné à faire jouer une quelconque vraisemblance scientifique contre une quelconque vraisemblance romanesque. Certes en 1847 paraît le Traité physiologique et philosophique du docteur Lucas qui formule ce qu’il appelle l’« hérédité d’influence » : la matrice de la mère étant supposée avoir gardé le modèle ou la forme du premier amant, les enfants d’un second mariage peuvent ressembler au premier mari. Zola s’en inspire pour illustrer la théorie de l’imprégnation et Michelet défendra également une telle idée. La théorie génétique de Mendel, publiée en 1866, n’aura pas vraiment d’influence à sa sortie et ce qu’on appelle la « télégonie » au début du XXe siècle (autre nom de l’hérédité d’influence), bien que lointainement inspirée des constats dressés par des éleveurs anglais dès les années 1815, n’a réellement d’influence en Europe qu’à partir des années 1860 et jusqu’aux années 1920. Bien après, donc, que Goethe a inventé Othon.
Avant que le docteur Lucas ne s’en mêle, les hypothèses formulées au XIXe siècle sur la génération et le rôle de la matrice femelle n’ont pas réellement progressé depuis le XVIIe et le XVIIIe siècles : les débats tournent autour de la prééminence accordée à la femelle ou au mâle. Certaines sources antiques sont parfois citées qui évoquent davantage l’effet de l’imagination de la femme sur le fœtus durant la gestation que l’idée d’une matrice imprégnée de la forme d’un autre. Ainsi Hippocrate ou Aldrovandi sont parfois évoqués par les médecins pour expliquer le cas de naissances monstrueuses par l’imagination de la mère. Ambroise Paré, dans Des monstres & prodiges (1579), énumère ainsi les causes de naissances monstrueuses, et évoque comme il se doit Aristote, Hippocrate et Empédocle pour traiter de l’« Exemple des monstres qui se font par imagination » : « Les anciens qui ont recherché les secrets de Nature, ont enseigné d’autres causes des enfans monstrueux, et les ont referés à une ardente et obstinée imagination que peut avoir la femme ce pendant qu’elle conçoit, par quelque objet, ou songe fantastique, de quelques visions nocturnes, que l’homme ou la femme ont su l’heure de la conception »[67]. Pour illustrer la théorie des anciens, Paré tire deux exemples de la Bible et d’un roman d’Héliodore (Les Éthiopiques), comme si le roman était là la preuve de l’invraisemblance scientifique : « Qu’il soit vray, Heliodore escrit que Persina, royne d’Ethiopie, conceut du roy Hydustes, tous deux Ethiopiens, une fille qui estoit blanche, et ce par l’imagination qu’elle attira de la semblance de la belle Andromeda, dont elle avoit la peinture devant ses yeux pendant les embrassemens desquels elle devint grosse » (p. 116). Othon est non seulement le fruit de deux imaginations, mais sa seule vraisemblance est d’ordre romanesque : il s’inscrit dans la lignée de Clariclée.
La mise en abyme du roman par la description du cabinet ou du musée peut avoir également un sens structural. Elle introduit, à l’intérieur du texte, une tension entre un ordre descriptif, reposant sur l’inventaire et un ordre narratif reposant sur l’aventure ou sur la mise en intrigue. Et si le musée répond, par sa création, à un désir d’exhaustivité, sa métamorphose romanesque en cabinet de curiosités dénonce comme un leurre la possibilité de tout dire sans toutefois établir un ordre dans le désordre et la liste. L’intrigue, dans le second mouvement du roman de Melville, est à la fois celle, minimale, de la quête et celle du tour du monde (de l’insulaire) ; elle repose sur l’idée d’une exhaustivité (redoublée par le désir du roi Média de faire le tour de l’archipel) nécessaire à l’aboutissement de la quête. Or cette déclaration liminaire d’exhaustivité qui fait ressembler le récit à la forme encyclopédique (on fait le tour des îles comme on fait le tour des connaissances du temps) est sans cesse perturbée par des déclarations des compagnons selon lesquelles certaines îles ne seront pas visitées parce que Yillah ne saurait y demeurer ou parce que Yillah n’y est plus.
Au chapitre CXXXVII, effrayés par la multiplicité des îles qui les entourent, le roi et le philosophe reconnaissent d’ailleurs l’impossibilité de deviser tout l’archipel : « much must be left unseen. Nor everywhere can Yillah be sought, noble Taji »[68]. Si l’on se place du point de vue de la quête amoureuse, les étapes du voyage en archipel sont le plus souvent déclarées arbitraires et inutiles. Sans doute faut-il comprendre par là que Yillah n’est pas ce qu’elle semble être et que la quête de Yillah acquiert une autre signification tout au long de la circumnavigation. La quête elle-même demeurera inachevée (ou plusieurs fois achevée) comme si la circumnavigation promise ne pouvait elle-même constituer le modèle structural du roman.
La mise en évidence d’une succession de grands domaines de connaissance n’explique pas non plus, dans Bouvard et Pécuchet, l’évidente lâcheté des liens tissés entre les différents chapitres et, au sein de chaque chapitre, entre les diverses expérimentations et études entreprises par les deux bonshommes. Si Bouvard et Pécuchet semblent parfois poussés par leurs échecs à explorer les fondements scientifiques des expériences malheureuses tentées par eux, ils ne font jamais retour ensuite sur les expériences premières dont ils devraient cependant avoir ultérieurement compris le fonctionnement. Il arrive également que les nouveaux sujets d’étude de Bouvard et Pécuchet ne soient dus qu’au simple hasard. Ayant abandonné la gymnastique et se rendant à l’auberge pour acheter quelques bouteilles de vin d’Espagne, Bouvard rencontre par hasard « le clerc de Marescot et trois hommes » qui « apportaient une grande table de noyer »[69]. C’est ainsi que Bouvard « connut la mode nouvelle des tables tournantes »[70], – ce qui détermine une initiation des deux héros, d’abord sceptiques, aux pratiques du magnétisme.
Non seulement, donc, la mise en intrigue affichée à l’orée des récits se révèle un leurre, mais les narrateurs des trois romans ont en commun de se jouer de la motivation du récit. Ainsi la première partie des Affinités électives s’achève-t-elle sur le trouble d’Odile que le narrateur nous promet d’éclairer par « quelques passages » de son « journal ». Mais il faut attendre la fin du second chapitre de la deuxième partie pour avoir effectivement accès à ce journal. Et l’extrait est alors annoncé par le narrateur en des termes curieux :
Übrigens waren diese Tage zwar nicht reich an Begebenheiten, doch voller Anlässe zu ernst hafter Unterhaltung.Wir nehmen daher Gelegenheit, vor demjenigen, was Ottilie sich daraus in irhen Heften angemerkt, einiges mitzuteilen, wozu wir keinen schicklichern Übergang finden als durch ein Gleichnis, das sich uns beim Betrachten ihrer liebenswürdigen Blätter aufdringt.
Wir hören von einer besondern Einrichtung bei der englischen Marine. Sämtliche Tauwerke der königlichen Flotte, vom stärksten bis zum schwächsten, sind dergestalt geht, den man nicht herauswinden kann, ohne alles aufzulösen, und woran auch die kleinsten Stücke kenntlich sind, daβ sie die Krone gehören.Ebenso zieht sich durch Ottilien Tagebuch ein Faden der Neigung und Anhänglichkeit […]. Selbst jede einzelne von uns ausgewählte und mitgeteilte Stelle gibt davon das entschiedenste Zeugnis[71].
Du point de vue de la logique de l’énonciation, comme de la motivation de la narration, on ne peut pas dire que le narrateur fasse beaucoup d’efforts. Le commentaire qu’il fait ici de son propre texte fait apparaître le recours au journal comme un pis-aller ; comme il n’y a rien à raconter, autant citer le journal d’Odile. Vient alors, toujours sous la forme du méta-texte, la comparaison aux cordages anglais, donnée comme subitement venue à l’esprit du narrateur mais également comme clef de lecture des fragments qui suivent. Il y aurait donc un « fil rouge » dans les fragments, une continuité qui se donne à celui qui veut bien les lire ; et cette continuité donnerait la clef du caractère d’Odile. Mais le narrateur signale in fine qu’il a lui-même choisi ces fragments et que la clef de la sélection des éléments de la liste est bien plutôt de son fait que de celui d’Odile. La manière même dont les narrateurs des Wahlverwandtschaften, de Mardi et de Bouvard et Pécuchetcommentent avec ostentation les rouages de leurs récits marque une distance évidente par rapport aux impératifs formels de mise en intrigue et de vraisemblance hérités de la poétique aristotélicienne. Et l’adoption de grilles d’écriture figées fait même l’objet, dans les trois romans, de critiques très vives : le roman, comme les curiosités, doit se faire monstrueux.
Et il le fait en dénonçant l’inanité des catégories génériques. Cela, dans Mardi, se joue dans la manière dont les compagnons descendent un temps dans la bibliothèque d’Oh-Oh pour mieux en ressortir. Là, la classification des ouvrages en catégories génériques peut être mise au compte du narrateur autant que de l’antiquaire et le jeu consiste à illustrer de manière parodique, en inventant les titres fantaisistes d’ouvrages fictifs, les attentes génériques des lecteurs ou les constantes pratiquées par les auteurs. L’application de ces règles aboutit à chaque fois à l’effondrement de la catégorie générique composée de titres qui nient sa spécificité. Ainsi les « traités de métaphysiques » englobent quatre ouvrages qui, deux à deux, s’opposent par des titres exactement contraires et la métaphysique s’informe en sophistique[72]. Les « livres de voyage » qui devraient obéir aux contraintes de l’exactitude, de l’objectivité et de la scientificité (on attend du voyageur qu’il puisse tenir un discours général sur les mœurs des tribus fréquentées) sont composés d’un récit qui n’a pu que difficilement être écrit par un homme sans main (« Un séjour chez les anthropophages, par un voyageur dont la main fut mangée au déjeuner par les sauvages »), par une satire et par un texte dont la prétention à la généralité s’accorde mal avec la durée du voyage accompli (« Trois heures à Vivenza, contenant un compte rendu complet et impartial sur ce pays, par un sujet du roi Bello »)[73]. Au cœur du cabinet de curiosités se joue donc la critique, par le romancier, de l’application de critères génériques préétablis et l’on sait que Melville avait lutté contre les remaniements que l’éditeur voulait imposer à ses premiers récits de voyage au nom du respect des attentes des lecteurs, en montrant que l’application de ces critères formels portait atteinte à l’exigence de vérité du texte référentiel.
L’application de règles génériques préétablies fait l’objet de critiques de la part des narrateurs des Wahlverwandschaften et de Bouvard et Pécuchet. Le narrateur des Affinités électives livre ainsi une étrange introduction à la deuxième partie de l’ouvrage :
In gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopoë als Kunstgriff des Dichters zu rühmerspflegen, daβ nämlich, wenn die Hauptfiguren sich entfernen, verbergen, sich der Untätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein Zweiter, Dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt und, indem er seine ganze Tätigkeit aüβert, uns gleichfalls der Aufmerksamkeit, der Teilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint [74].
La justification d’un ordre préétabli, de principes poétiques (même artificiels), a ceci de paradoxal (et d’arbitraire) qu’elle devient d’ailleurs la justification du désordre ou, du moins, de l’énumération et de la liste : le seuil de la seconde partie préside au défilé des « experts » dont aucun ne l’emporte vraiment sur l’autre. Le comique de la transition réside dans le fait de se saisir de ce qu’un genre a de plus artificiel pour en faire une loi du récit. La seule loi du roman, par cette référence au grand genre épique, n’est autre que l’arbitraire ; et le genre ne vaut en quelque sorte que par l’inanité de ses préceptes qui dissimulent mal les « trucs » du poète. Les lois génériques sont donc susceptibles de n’avoir pas de sens ou, du moins, de ne pas découler d’une logique esthétique ou morale. La pratique de la littérature ne saurait se réduire à l’application de préceptes poétiques et esthétiques. En témoigne la lecture que font Bouvard et Pécuchet de la Pratique du théâtre de d’Aubignac, – lecture qui les conduit à abandonner l’écriture de leur pièce. Cependant la première phrase de Goethe suggère aussi que ce qui, en art, semble arbitraire et artificiel est en réalité le plus conforme à la Nature.
Renonçant à l’application de ces règles génériques, les romanciers font en sorte que leurs romans ne puissent s’inscrire dans des catégories préétablies. Il n’y a pas seulement là la trace de la critique romantique des genres. Bâtir des romans monstrueux et les revendiquer comme tels est aussi une manière de penser un nouveau rapport du roman au monde et de tenter de rompre peut-être avec l’impératif mimétique. Or le cabinet de curiosités est par nature le lieu où peut être interrogé le rapport de la nature à l’art et Horst Bredekamp a montré, en étudiant ses composantes, qu’il avait contribué, en réunissant des monstruosités ou des merveilles naturelles, des raretés artificielles et les instruments de la transformation par l’homme de la nature, à introduire dans la nature la notion d’histoire, « qui aboutira à la théorie darwinienne de l’évolution »[75]. Dans le cabinet de curiosités romanesques, le visiteur est invité à résoudre l’énigme de l’ordre du cabinet et à observer les rapports qui se jouent entre des objets toujours déjà romanesques et le langage qui les dit (qui est, en mots, l’équivalent des artificialia). À l’intérieur des musées romanesques sont donc mis à l’épreuve le rapport entre des « objets » et le discours et le récit qui les disent et, plus fondamentalement encore, le rapport entre l’univers romanesque et le monde. Si les mots y sont pétrifiés comme les objets exposés, en étant exclus de leur domaine de signification, ce n’est pas seulement pour creuser l’écart entre l’univers de la fiction et le monde de l’expérience, c’est davantage pour exhiber le caractère non-référentiel du monde de la fiction, pour rompre même avec l’illusion réaliste et suggérer dans le même temps que ces objets propres au monde romanesque signifient d’autant plus qu’ils ne ressemblent à rien de ce que le lecteur connaît.
À l’endroit des cabinets de curiosités, la fiction romanesque se pose en description imaginaire de merveilles imaginaires pour échapper aux critères de vraisemblance ou, tout du moins, pour dégager leurs caractéristiques formelles de toute valeur de vérité. Cela ne signifie pas que la littérature n’y parle que de littérature ou que le mot n’y renvoie qu’au mot ; cela signifie que le mot, ne renvoyant qu’au mot, peut y être réinvesti de significations qui ne se donnent qu’à celui qui sait interpréter les symboles ou les métaphores. Le roman ne représente pas le monde, il est un microcosme métaphorique du monde de l’expérience.
Ainsi peut se comprendre le fait que le philosophe Babbalanja puisse, dans un premier temps, attribuer à un écrivain fictif le désir de créer un monde autre pour se divertir et, dans un second temps, ériger le monde romanesque extravagant d’un second écrivain fictif nommé Lombardo en univers analogue à celui du monde de l’expérience. La définition de l’épopée de Vavona vaut pour Mardi : « I will build another world. Therein let there be kings and slaves, philosophers and wits, whose checkered actions – strange, grotesque, and merry-sad, will entertain my idle moods »[76]. La défense par le philosophe du manque de cohésion condamné dans le Kostanza de Lombardo convient également au roman de Melville : lorsque le roi Abrazza déplore que le livre soit « désordonné, sans liens, tout en épisodes », Babbalanja rétorque pour faire de ces apparentes transgressions des règles aristotéliciennes les marques de la plus grande vraisemblance du roman, de la plus grande coïncidence de sa forme avec l’objet qu’il décrit : « Comme Mardi lui-même, Majesté. Rien que des épisodes : vallées et montagnes, rivières divaguant, lianes qui se promènent partout, galets et diamants, épines et fleurs, forêts et fourrés, çà et là marais et marécages. Le monde du Kostanza est pareil »[77].
Ainsi le rejet des règles génériques et la défense de l’invraisemblance n’aboutissent-ils pas seulement à l’illustration d’un savoir proprement littéraire destiné à élaborer de nouveaux préceptes d’écriture romanesque ; ils n’extraient chacun de ces romans d’une certaine tradition romanesque que pour mieux illustrer la possibilité, pour le roman, de faire signe vers un monde extérieur en ne niant pas son appartenance au domaine de la fiction. Mais cela va plus loin encore : dans les musées où le mot décrit une réalité qui n’existe qu’en mots, le roman décrit d’autant mieux le monde qu’il nie son caractère référentiel. Plus la fiction est descriptive, moins elle est, en quelque sorte, référentielle.
La survivance, dans des romans du XIXe siècle, du cadre ancien du cabinet de curiosités pourrait être l’indice de la volonté des romanciers de restaurer, dans le domaine de la fiction, l’unité d’une Nature où les choses et les mots sont autant de signes, de chiffres à déchiffrer. Mais elle est aussi l’occasion d’appliquer aux musées les critiques qui valaient déjà pour leurs lointains ancêtres : les savoirs spécialisés qui président à l’organisation des musées sont susceptibles aussi de conduire à une fascination et à une admiration qui transformeront les objets exposés en idoles plutôt qu’en sujets de connaissance. Les musées, les collections et les cabinets de curiosités, dans les romans de Goethe, de Flaubert ou de Melville se rejoignent en ce qu’ils sont à chaque fois le lieu d’une interrogation sur les dérives de l’exposition des objets supposés fonder le savoir en vérité. Et leur description, qui met à l’épreuve la capacité du roman à décrire et à figurer, est l’occasion par là-même de mesurer aussi les limites de la fiction à dire le monde. Ces lieux d’exposition explorent les pouvoirs des mots et illustrent la possibilité d’inventer, par le langage de la fiction, des mots qui ne renvoient à rien et ne signifient rien. Il faut sortir de ces musées qui sont autant des modèles que des repoussoirs ; les narrateurs des Affinités électives, de Mardi et de Bouvard et Pécuchetsemblent y exposer les mauvaises manières de décrire, de nommer et d’inventer tout en suggérant que sont possibles de nouvelles articulations possibles du récit et du monde. La visite du cabinet de curiosités est l’exposition d’un nouveau chemin de connaissance romanesque qui oscille désormais entre l’exhaustivité et l’exemplarité : le roman se fait allégorique davantage que mimétique. Les objets qui composent les collections romanesques sont avant tout des mots et n’existent que dans l’univers de la fiction ; devenus des choses par les pouvoirs de l’énumération, ils ressemblent aux composantes des cabinets d’antiques et de raretés. Ils supposent alors d’être déchiffrés et interprétés pour faire sens dans un monde extérieur au roman.
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.) VOL. X
[1] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Claudine Gothot-Mersch (éd.), Paris, Gallimard, 1979, p. 61. Les éditions des romans en langue originale et en traduction française utilisées dans cet article sont les suivantes : Johann Wolfgang Goethe, Die Wahlverwandtschaften, Tübingen, J. G. Gottaischen Buchhandlung, 1809, t. I et t. II et Les Affinités électives, trad. fr. Pierre du Colombier, Paris, Gallimard, « Folio Classique », 1980 ; Herman Melville, Mardi. And A Voyage Thither, Tyrus Hillway (éd.), New Haven, College & University Press, 1973 etMardi, trad. fr. Philippe Jaworski, Paris, Gallimard, “Folio classique”, 2011.
[2] Ibid., p. 169.
[3] Ibid.
[4] Herman Melville, Mardi. And A Voyage Thither, op. cit., p. 316 : “Now it was to obtain a glimpse of this very museum that Media was anxious to touch at Padulla”.
[5] Ibid., resp. p. 317 : « So in order here follow the most prominent of his rarities” et p. 319 : “Then returning to his cabinet, he pointed to a bamboo microscope”.
[6] Johann Wolfgang Goethe, Les Affinités électives, trad. fr. Pierre du Colombier, p. 179-180 : Die Wahlverwandtschaften, t. II, resp. p. 22 : « die verschiedenen Nachbildungen und Entwürfe von alten Grabmonumenten, Gefäβen », p. 22 : « seine Sammlung von mancherlei Waffen und Gerätschaften » et p. 22-23 : « Brakteaten, Dickmünzen, Siegel, und was sonst sich noch anschlieβen mag ».
[7] Johann Wolfgang Goethe, Les Affinités électives, p. 179 ; Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 22 : « die Kätschen eines Modehändlers ».
[8] Johann Wolfgang Goethe, Die Wahlverwandschaften, t. I, p. 156-157 : Les Affinités électives, p. 97 : « Ces étuis de métal soudés renferment des documents, sur ces plaques de métal sont gravés toutes sortes de faits remarquables, dans ces belles bouteilles de verre, nous ensevelissons le meilleur vin vieux, avec l’indication de son âge ; il ne manque pas de monnaies de diverses sortes, frappées cette année […] ».
[9] Lorraine Daston, « Marvelous facts and miraculous evidence in early morder Europe », Critical inquiry, 1991, n°18, p. 93-123.
[10] Cf. à ce propos Marie-Noëlle Bourguet, « La collecte du monde : voyage et histoire naturelle (fin XVIIesiècle-début XIXe siècle », Le Muséum au premier siècle de son histoire, Claude Blanckaert, Claudine Cohen, Pietro Corsi et Jean-Louis Fisher (éd.), Paris, Éditions du Muséum national d’Histoire naturelle, 1997, p. 163-196.
[11] Michel Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 14.
[12] Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1987, p. 61-63.
[13] Cf. à ce propos Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1987, p. 47-59.
[14] Krzysztof Pomian, op. cit., p. 66.
[15] Johann Wolgang Goethe, Les Affinités électives, p. 259 ; Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 186 : « die angenehmste und interessanteste Sammlung ».
[16] Johann Wolgang Goethe, Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 22; Les Affinités électives, p. 179 : “Il avait tout disposé d’une manière très propre et portative, dans des tiroirs et des compartiments, sur des planches entaillées, revêtues de drap, en sorte que ces vieilleries rébarbatives prenaient par ses soins un air de coquetterie, et qu’on les regardait avec plaisir, comme on regarde les boîtes d’une modiste ».
[17] Johann Wolfgang Goethe, Les Affinités électives, p. 97 ; Die Wahlverwandschaften, t. I, p. 157-158 : “Haarkämmern”, “Riechenfläschchen und andre Zierden”.
[18] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 164.
[19] Herman Melville, Mardi, p. 336.
[20] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 164.
[21] Herman Melville, Mardi, p. 318 ; Mardi,trad. fr. Philippe Jaworski, p. 336 : « L’éventail sacré ».
[22] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 162.
[23] Herman Melville, Mardi, p. 318 : Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 336 : « bloc de bois mystérieux, informe, veiné, séché à la fumée (Percé, au milieu, de trois trous inexplicables) ».
[24] Herman Melville, Mardi, p. 317.
[25] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, resp. p. 179 et p. 180.
[26] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 169.
[27] Ibid., p. 172.
[28] Herman Melville, Mardi, p. 316 : Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 334 : « Et dans Mardi, un nez remarquable est une très éminente caractéristique, donc une garantie toujours bien visible de distinction ».
[29] Herman Melville, Mardi, p. 317 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 335 : « un point d’exclamation, d’étonnement perpétuel devant le spectacle de l’univers ».
[30] Réné Descartes, Les Passions de l’âme [1649], Œuvres de Descartes, Charles Adam et Paul Tannery (éd.), Paris, Vrin, 1996, t. XI, art. LXXV-LXXVIII, p. 384-386. Notamment p. 386 : « Et bien que cette passion semble se diminuer par l’usage, à cause que, plus on rencontre de choses rares qu’on admire, plus on s’accoutume à cesser de les admirer, et à penser que toutes celles qui se peuvent présenter par après sont vulgaires : toutefois lorsqu’elle est excessive et qu’elle fait qu’on arrête seulement son attention sur la première image des objets qui se sont présentés, sans en acquérir d’autre connaissance, elle laisse après soi une habitude qui dispose l’âme à s’arrêter en même façon sur tous les objets qui se présentent, pourvu qu’ils lui paraissent tant soi peu nouveaux ».
[31] Herman Melville, Mardi, p. 335.
[32] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 354-355.
[33] Ibid., p. 173.
[34] Johann Wolfgang Goethe, Die Wahlverwandtchaften, t. II, p. 150-151 ; Les Affinités électives, p. 242 : « Un cabinet d’histoire naturelle peut nous apparaître comme une sépulture égyptienne, où se tiennent embaumées les diverses idoles animales et végétales. Il convient certes à une caste sacerdotale d’en traiter en un clair-obscur mystérieux, mais cela devrait d’autant moins s’introduire dans l’enseignement général, que des objets plus proches et plus dignes d’intérêt s’en trouvent aisément chassés ».
[35]Johann Wolgang Goethe, Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 112; Les Affinités électives, p. 338 : « Si vous saviez, dit-il, avec quelle grossièreté les gens cultivés eux-mêmes se comportent à l’égard des œuvres d’art les plus précieuses, vous me pardonneriez de ne pas produire les miennes parmi la foule ».
[36]Johann Wolfgang Goethe, Les Affinités électives, p. 339 ; Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 113 : « wäre es nicht übel, wenn man künftig in das Büchlein von guten Sitten nach den Kapiteln, wie man sich in Gesellschaft beim Essen und Trinken benehmen soll, ein recht umständliches einschöbe, wie man sich in Kunstsammlungen und Museen zu betragen habe ».
[37] Herman Melville, Mardi, p. 317 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 335 : « À l’intérieur, un dédale de couloirs et de recoins sombres et tortueux, plus inextricable que le dedans d’une noix. Là, dans un fouillis poussiéreux, dormaient les antiquités précieuses […] ».
[38] Ibid, p. 320.
[39] Ibid., p. 320 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 339 : «Arrivés au fond, nous vîmes s’envoler quelques douzaines de chauves-souris qui éteignirent la torche, nous laissant dans les ténèbres, comme Belzoni abandonné par ses Arabes au cœur de la pyramide. La torche rallumée, nous pénétrâmes dans une excavation assez semblable à un sépulcre, en soulevant des nuages de poussière à chaque pas ; et nous nous trouvâmes enfin devant de longues rangées de paquets moisis, emmaillotés comme desmomies, si rouillées de vieillesse, si étroitement roulés sur des bâtons qu’ils ressemblaient à de raides saucisses de Bologne ».
[40] Johann Wolgang Goethe, Die Wahlverwandtschaften, t. II, p. 186-187; Les Affinités électives, p. 259 : “Il présenta aux dames un grand portefeuille qu’il emportait avec lui, et il les intéressa à la fois par l’image et le commentaire”.
[41] Ibid.
[42] Johann Wolfgang Goethe, Les Affinités électives, p. 97 ; Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 156 : « Hier in diese unter schiedlichen gehauenen Vertiefungen soll verschiedenes eingesenkt warden zum Zeugnis für eine entfernte Nachwelt”.
[43] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 174.
[44] Ibid., p. 176.
[45] Ibid., p. 177.
[46] Herman Melville, Mardi, Tyrus Hillway (éd.), op. cit., p. 317 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 335 : « Avec une insistance des plus opportunes, le vieil homme attirait notre attention sur ses reliques, et à propos de chacune d’elles il avait une histoire interminable à raconter. Le temps et surtout la patience me manqueraient pour vous les répéter ».
[47] Herman Melville, Mardi, p. 317 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 335 : « Mais voici un catalogue succinct de ses objets les plus remarquables ».
[48] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 162.
[49] Ibid., p. 163.
[50] Ibid., p. 169.
[51] Ibid., p. 170.
[52] Ibid., p. 162.
[53] Ibid., p. 164.
[54] Ibid., p. 162.
[55] Herman Melville, Mardi, p. 317 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 335 : “Le canoe authentique dans lequel, jadis, le dieu Unja arriva du fond de la mer.
(Très pesant ; en bois de gaïac) ».
[56] Herman Melville, Mardi, trad. Philippe Jaworski, p. 336 ; Mardi, p. 317 : « A quaint little fish-hook.
(Made from the finger-bones of Kravi the Cunning)”.
[57] Herman Melville, Mardi, p. 318 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 337 : « Une longue boucle emmêlée de cheveux de sirène, ressemblant beaucoup aux fibres enroulées et soyeuses d’une espèce d’algue très fine. (Conservée entre des écailles de dauphin) ».
[58] Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, dans Situations II, Paris, Gallimard, 1948, p. 172.
[59] Cf. Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007, notamment p. 11-82.
[60] Herman Melville, Mardi, p. 320.
[61] Ibid., p. 322.
[62] Cf. à ce propos la thèse de Hildegard Haberl, Ecriture encyclopédique – écriture romanesque : représentation et critique du savoir dans le roman allemand et français de Goethe à Flaubert, thèse en ligne, http://arch.revues.org/index3982.html.
[63] Cf. à ce propos Horst Bredekamp, Machines et cabinets de curiosités, trad. fr. Nicole Casanova, Paris, Diderot Éditeur, 1996, p. 89-118.
[64] Herman Melville, Mardi, p. 255.
[65] Ibid., p. 256.
[66] Johann Wolfgang Goethe, Les Affinités électives, p. 247 : « La prière était achevée ; on avait posé l’enfant sur les bras d’Odile, et, lorsqu’elle se pencha sur lui avec affection, elle ne fut pas peu effrayée devant ses yeux ouverts » ; Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 162 : « Das Gebet war verrichtet, Ottilien das Kind auf die Arme gelegt, und als sie mit Neigung auf dasselbe untersah, erschrack sie nicht wenig an seinen offenen Augen ».
[67][67] Ambroise Paré, Des Monstres & prodiges [1579], Paris, Éditions L’Œil d’Or, 2003, p. 116.
[68] Herman Melville, Mardi, p. 362 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 387 : « nous devons renoncer à visiter une grande partie de l’archipel, car nous ne pouvons pas rechercher Yillah partout, noble Taji ».
[69] Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, p. 277.
[70] Ibid.
[71] Johann Wolgang Goethe, Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 25-26; Les Affinités électives, p. 181 : “D’ailleurs ces jours, pauvres en événements, furent pleins d’occasions à entretiens sérieux. Nous en profitons pour faire connaître quelques passages de ce qu’Odile en nota dans son journal, et nous ne trouvons pas, à cet effet, de transition plus convenable qu’une comparaison, qui se présente à nous en jetant les yeux sur ces pages aimables.
On nous parle d’une pratique particulière à la marine anglaise. Tous les cordages de la marine royale, du plus gros au plus mince, sont tressés de telle sorte qu’un fil rouge va d’un bout à l’autre et qu’on ne peut le détacher sans tout défaire ; ce qui permet de reconnaître, même au moindre fragment, qu’ils appartiennent à la couronne.
De même, il passe à travers le journal d’Odile un fil d’amour et de tendresse qui relie tout et caractérise l’ensemble […]. Même chacun des passages que nous avons choisis, et que nous communiquons, pris à part, en donne le témoignage le plus net ».
[72] Herman Melville, Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 340 ; Mardi, p. 321 : « metaphysical treatises”.
[73] Herman Melville, Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 340 et p. 341 : Mardi, p. 322 : « “ A Sojourn among the Anthropophagi, by One Whose Hand Was Eaten off at Tiffin among the Savages.”» et « “Three Hours in Vivenza, Containing a Full and Impartial Account of that Whole Country, by a Subject of King Bello”».
[74] Johann Wolgang Goethe, Die Wahlverwandschaften, t. II, p. 5; Les Affinités électives, p. 171 : “Dans la vie de tous les jours, il arrive souvent ce que, dans l’épopée, nous avons coutume de célébrer comme un artifice du poète : lorsque les personnages principaux s’éloignent, se cachent, s’adonnent à l’inaction, tout aussitôt un personnage de second ou de troisième plan, un personnage à peine remarqué jusque-là, emplit la scène, et, en exprimant toute son activité, nous paraît à son tour digne d’attention, de sympathie, voire de louange et d’estime ».
[75] Horst Bredekamp, Machines et cabinets de curiosités, op. cit., p. 110.
[76] Herman Melville, Mardi, p. 487 ; Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 534 : « Je veux bâtir un autre monde. Qu’il y ait là des rois et des esclaves, des philosophes et des beaux esprits, dont les actions bigarrées, étranges, grotesques, mêlées de rires et de larmes, me feront passer le temps ».
[77] Herman Melville, Mardi, trad. fr. Philippe Jaworski, p. 541-542; Mardi, p. 493 : « wild, unconnected, all episods » et « And so is Mardi itself – nothing but episodes, valleys and hills, rivers disgressing from plains, vines roving all over, boulders and diamonds, flowers and thistles, forests and thickets, and here and there fens and moors. And so the world in the Kostanza ».