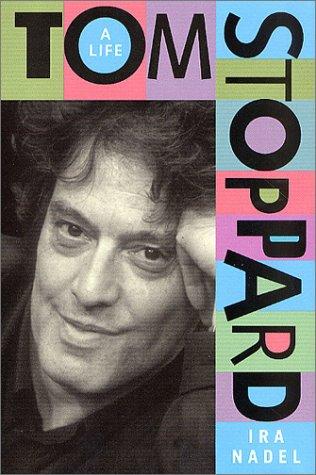Depuis une vingtaine d’années, des domaines aussi divers que la thermodynamique, la mécanique quantique, ou la neuroscience ont fait leur apparition dans le dialogue de théâtre britannique, et cette intégration du discours scientifique au texte dramatique semble marquer une rupture par rapport aux représentations traditionnelles de la science. Tandis que le théâtre du vingtième siècle, et surtout celui de l’après-Hiroshima [1], mettait en avant les responsabilités et les dilemmes éthiques des chercheurs, celui des années 90 et 2000 s’intéresse bien moins au rôle politique de leurs découvertes qu’à la représentation du réel construit par les discours de la science [2].
Chez Michael Frayn, Tom Stoppard ou dans les créations du Théâtre de Complicité, la théorie scientifique est examinée dans sa fonction de description du réel, et ses modèles sont exploités à des fins métaphoriques et narratives. L’exploration esthétique et épistémologique de la science prend ainsi le pas sur le débat éthique.
Dans cet engouement du théâtre pour la science, Tom Stoppard joue le rôle d’un précurseur. Ses pièces au contenu scientifique le plus explicite, Hapgood (1988) et Arcadia (1993), correspondent au début de la vague contemporaine de science plays, et Arcadia a été applaudie comme l’un des mariages les plus réussis entre science et théâtre [3]. Mais l’intérêt de Stoppard pour le modèle scientifique ne date pas des années quatre-vingts, et nous retracerons ici son évolution depuis ses premières créations dans les années soixante. Le « modèle » scientifique a ici deux sens différents, car si d’une part le raisonnement logique et la formule mathématique ont servi de modèles à l’écriture dramatique de Stoppard, et la pensée mathématique est donc un exemple qu’il cherche à imiter, d’autre part un certain nombre de théories (la mécanique quantique, la théorie des catastrophes et la théorie du chaos) et de modèles mathématiques ont servi de métaphores structurantes à certaines de ses œuvres. Nous nous proposons ainsi d’analyser ces deux niveaux d’interaction avec les discours de la science, en cherchant à élucider le rapport qui s’y établit entre le modèle scientifique et la fable dramatique.
Pour Stoppard, la beauté mathématique est d’abord celle de l’équation et de la formule, et nous commencerons par analyser sa tendance à construire l’intrigue comme un problème logique. Le désir de logique éprouvé par les personnages de son théâtre est cependant frustré par des renversements de perspective et une instabilité herméneutique qui les pousse à remettre en cause leur raisonnement. Chez Stoppard, semble-t-il, la position objective du spectateur raisonnant n’est pas tenable ; elle sera toujours remise en cause. Cette déstabilisation postmoderne trouve alors ses métaphores dans certaines théories de la science du vingtième siècle, qui lui permettront de réconcilier la tentation de la logique avec l’impossibilité de la prévision. En se tournant vers les théories de l’incertitude et de la discontinuité, Stoppard trouvera des structures permettant à la fois de remettre en cause le fonctionnement linéaire traditionnel de la fable et de renouveler celle-ci, la rendant apte à exprimer l’imprévisibilité des systèmes humains.
I. La formule dramatique
Depuis le succès retentissant de Rosencrantz and Guildenstern are Dead en 1966, Tom Stoppard est devenu l’un des auteurs emblématiques du théâtre anglais contemporain. Ses dialogues comiques nourris de théories philosophiques, scientifiques et littéraires lui ont donné la réputation de dramaturge intellectuel, et l’un des traits les plus constants de son écriture est le jeu de langage sous toutes ses formes, que certains ont qualifié de « cerebral wit » [4] ou de « mécanique stoppardienne de la cérébralité » [5] . Son œuvre examine le langage et la représentation sous toutes leurs coutures et « offre une surabondance de mots, de signes, de référents et une théâtralité exacerbée » [6].
Or, dans cette réflexion sur le langage, la représentation mathématique occupe une place privilégiée, car le foisonnement du sens est toujours contenu par une forme logique. Lorsqu’il décrit son œuvre deux images reviennent régulièrement dans les propos de Stoppard : l’équation et le paradoxe. L’évènement théâtral devient “une équation qui se transforme sans cesse et dont la plupart des variables sont déterminées par la représentation” [7]. L’image de l’équation permet ainsi d’exprimer l’équilibre vivant de la représentation, équilibre qui dépend d’un public toujours différent et d’une performance qui ne se répète jamais à l’identique. Cette mathématisation de l’expérience théâtrale est renforcée par une insistance sur la forme logique dans la structure dramatique, car Stoppard souligne que son théâtre est toujours « logique et rationnel » [8] et que le paradoxe est une structure qui l’attire particulièrement : « Paradox appeals to me. Paradoxes have a shape, like a piece of architecture. […] They’re like a thought process in concrete form – you can see the actual shape and structure of it » [9].
On voit ici à quel point la logique séduit par sa forme et par sa capacité à structurer l’œuvre théâtrale [10] De fait, la formule et le paradoxe vont souvent fournir la forme dramatique des pièces de Stoppard. Dès 1969, il place une équation au centre de sa pièce radiophonique Albert’s Bridge. Albert est un diplômé de philosophie devenu peintre, et son travail quotidien consiste à repeindre le pont de Clufton Bay. L’équipe d’entretien comprend quatre peintres, et la vitesse de détérioration de la peinture fait de leur travail une opération continue : dès que les ouvriers atteignent une extrémité du pont, l’autre extrémité a de nouveau besoin d’être repeinte. Au début de la pièce, l’ingénieur Fitch propose une restructuration de l’opération : en utilisant une peinture quatre fois plus résistante, et en n’employant plus qu’un seul peintre, la ville pourra économiser des sommes considérables. Albert sera ce peintre solitaire, et le drame qui s’ensuit découle d’une simple erreur de calcul, puisque Fitch omet de prendre en compte la phase de transition au cours de laquelle l’ancienne peinture s’effritera aussi vite qu’avant, et le peintre chargé de son entretien ne pourra pas la remplacer assez vite par la nouvelle. Cette erreur de calcul produit une comédie noire dans laquelle la détérioration rapide du pont, qui scandalise les habitants de Clufton, est accompagnée par une détérioration tout aussi rapide du caractère d’Albert, qui se laisse enivrer par le sentiment de maîtrise et de supériorité que lui procure sa position au-dessus de la ville. Sa misanthropie ne cesse de grandir, et il abandonne progressivement femme et enfant pour se réfugier dans l’abstraction et la solitude, avec pour seul compagnon un suicidaire récidiviste, Fraser, dont les tentatives répétées échouent toujours face à la beauté du spectacle offert par la ville. La pièce se conclut par l’effondrement du pont, lorsque Fitch décide d’envoyer mille sept cent quatre-vingt dix-neuf peintres terminer le travail en une journée : l’effet combiné de leurs pas déclenche l’oscillation de la structure, et la belle équation de l’ingénieur s’écroule en quelques instants.
Le pont d’Albert incarne ainsi un désir d’ordre et de maîtrise du monde qui sera toujours voué à l’échec. Fitch et Albert partagent cette fascination pour l’équation qu’il représente : « It’s poetry to me », s’extasie Fitch, « a perfect equation of space, time and energy… It’s continuity, control – mathematics » [11]. La formule mathématique exprime la maîtrise logique du réel et s’oppose au chaos de la vie quotidienne des citadins. Ce contraste est souligné à plusieurs reprises par Fraser, qui fuit le désordre de la ville pour se réfugier dans la tranquillité de la perspective mathématique :
– FRASER … I couldn’t bear the noise, and the chaos. I couldn’t get free of it, the enormity of that disorder, so dependent on a chance sequence of action and reaction. […] Quite ordered, seen from above. Laid out in squares, each square a function, each dot a functionary. I really think it might work. Yes, from a vantage point like this, the idea of society is just about tenable [12].
Le pont devient le symbole d’une réalité maîtrisée par la géométrie et la formule mathématique, et si les fantasmes d’Albert et de Fitch sont détruits par son effondrement final, la maîtrise mathématique de l’auteur est, elle, parfaitement conservée, car l’oscillation destructrice du pont peut elle aussi être exprimée par une formule physique. Celle-ci sera évoquée dans les derniers instants par Fraser : «the physical laws are inviolate […] if you carry on like that a bridge will shiver, the girders tensed and trembling for the release of energy being driven through them… » [13]. La structure architecturale s’effondre peut-être, mais la forme logique de la pièce reste intacte.
La séduction de l’équation réside donc autant dans l’idée d’équilibre que dans la notion de formule, si l’on songe à la racine latine du mot forma et à l’idée de forme de pensée. Cette fascination pour la formule réapparaît dans les pièces philosophiques et politiques des années soixante-dix et quatre-vingt, dans lesquelles Stoppard joue de plus en plus avec le paradoxe. Dans la comédie philosophique Jumpers (1972), il met en scène un philosophe moral en lutte contre le positivisme logique, qui tente inlassablement de prouver l’existence de Dieu en explorant les paradoxes de l’argumentation adverse. Puis, dans une série de pièces dénonçant la répression dans les pays du bloc de l’Est, Stoppard fait le procès du raisonnement totalitaire en l’examinant d’un point de vue logique. Every Good Boy Deserves Favour, Professional Foul, et Squaring the Circle abordent le totalitarisme en démontrant que le langage et la logique peuvent être des outils de répression politique, et en soulignant les paradoxes qui en découlent. La formule mathématique devient alors le lieu de la contradiction et de l’insoluble, notamment dans la « pièce pour acteurs et orchestre » issue d’une collaboration avec le compositeur André Previn, Every Good Boy Deserves Favour.
En 1976, sa rencontre avec le dissident tchèque Victor Fainberg pousse Stoppard à dénoncer une pratique fréquente des régimes répressifs : l’internement des dissidents dans des asiles sous prétexte de troubles mentaux. Stoppard milite pour la libération du dramaturge Václav Havel, interné lui aussi, et commence alors à s’intéresse à ce qu’il nomme la « logique de la répression » [14]. Every Good Boy Deserves Favour illustre cette logique par une situation fictionnelle semblable à celle de Havel. Alexander Ivanov y est interné dans un hôpital psychiatrique pour avoir critiqué le régime de son pays. Son internement et sa grève de la faim ont soulevé l’indignation internationale, et sa libération est immanente, mais le régime doit trouver une façon de procéder qui lui permette de sauver la face : « They don’t want to lose ground », affirme Ivanov, « They need a formula » [15]. Ainsi le discours politique est représenté par l’idée de formule, qui connote le slogan de propagande mais aussi la formule mathématique. Lorsque Ivanov refuse de déclarer qu’il a été interné pour de bonnes raisons et menace de mourir de faim à l’hôpital, le directeur de l’hôpital se dit alors confronté à une « impasse logique », puisque le régime ne peut se contredire publiquement. L’idée de logique est donc déterminée par le discours politique qui l’emploie, et les syllogismes et paradoxes qui en découlent sont fondés sur la contrainte.
Afin de mieux souligner l’absurdité du raisonnement politique, Stoppard l’intègre aux scènes d’école où le fils d’Ivanov, Sacha, récite ses leçons de géométrie :
–SACHA ‘A point has position but no dimension.’
– TEACHER The asylum is for malcontents who don’t know what they’re doing.
– SACHA ‘A line has length but no breadth.’
– TEACHER They know what they’re doing but they don’t know it’s anti-social.
– SACHA ‘A straight line is the shortest distance between two points.’
– TEACHER They know it’s anti-social but they’re fanatics.
– SACHA ‘A circle is the path of a point moving equidistant to a given point.’
– TEACHER They’re sick.
– SACHA ‘A polygon is a plane area bounded by straight lines.’
– TEACHER And it’s not a prison, it’s a hospital [16]
L’effet de cette juxtaposition est double : d’une part, les axiomes de la géométrie euclidienne produisent un écho ironique aux propositions de la maîtresse (la « position » des mécontents répond à celle du point, l’hôpital est un exemple de polygone, etc.) et leur donne une résonance mathématique ; d’autre part, l’enchaînement limpide de l’axiomatique forme ici un contrepoint au raisonnement de la maîtresse, et en fait ressortir les multiples contradictions. Dans Every Good Boy Deserves Favour, le discours géométrique représente donc un certain espoir de résistance par la raison. Dans les années suivantes, Stoppard reprendra la notion de contradiction inhérente au système dans deux pièces écrites pour la télévision : Professional Foul et Squaring the Circle. Inspiré par la charte 77 et la répression des intellectuels qui sévissait en Tchécoslovaquie, le scénario de Professional Foul intègre des notions de la théorie des catastrophes pour explorer les paradoxes éthiques soulevés par les régimes répressifs. Puis, dans Squaring the Circle, Poland 1980-1, Stoppard étudie le conflit qui oppose au début des années quatre-vingts le syndicat Solidarité à l’état communiste polonais, et perçoit la situation comme une impasse qui découle de la contradiction entre deux systèmes de valeurs. Il intitule donc sa pièce « la quadrature du cercle », et la géométrie lui permet ainsi d’exprimer à nouveau l’idée du problème insoluble [17].
La formule mathématique permet ainsi de décrire métaphoriquement les systèmes humains explorés par le dramaturge, et la fable dramatique est redéfinie en termes de problème qui sera résolu par la logique. Prenons comme dernier exemple Hapgood (1988), un thriller d’espionnage empreint de physique quantique qui poursuit de façon plus systématique cette imitation du raisonnement scientifique. Dans une atmosphère de mystère et de double jeu inspirée par les romans de John Le Carré, l’intrigue repose sur une enquête menée par l’espion britannique Hapgood, à la recherche d’un agent double qui agirait dans son équipe. La duplicité est omniprésente dans l’intrigue, l’identité des personnages se transforme sans cesse, et la présence d’un physicien dans l’équipe permet d’exprimer cette ambivalence fondamentale par une métaphore scientifique : celle de la dualité de la lumière, qui présente simultanément des propriétés d’ondes et particules. La fonction dramatique du physicien Kerner est de décrire régulièrement l’intrigue en termes de problème logique, et Hapgood jongle ainsi avec deux genres non-dramatiques : la pièce peut être lue à la fois comme un pastiche du roman d’espionnage, qui joue de son vocabulaire et de ses scènes incontournables, et comme un hommage à la rhétorique de la communication scientifique. Kerner, grand amateur de romans d’espionnage, s’exaspère parfois devant leur complexité par comparaison avec l’écriture scientifique :
KERNER … When I write an experiment I do not wish you to be surprised, it is not a joke. This is why a science paper is a beautiful thing : first, here is what we will find ; now, here is how we find it ; here is the first puzzle, here is the answer, now we can move on. This is polite. We don’t save up all the puzzles to make a triumph for the author [18].
Or, la structure logique du « science paper » décrite par Kerner correspond exactement à la structure dramatique de Hapgood, car la pièce prend à contre-pied le fonctionnement classique du roman d’espionnage : les hypothèses de départ (l’identité du traître, et plus généralement la duplicité de l’identité humaine) sont annoncées dans le premier acte, et le deuxième acte se résume à leur démonstration. Le mot « hypothesis » est employé par les personnages au sujet de l’identité présumée du double espion, et le deuxième acte est ainsi conçu comme une vérification expérimentale de cette hypothèse. Enfin, Stoppard lui-même reprend fréquemment cette notion dans ses entretiens : « That was the hypothesis which generated the play itself, that the dual nature of light works for people as well as things, and the one you meet in public is simply the working majority of that person » [19].
Appuyée par une terminologie scientifique, la représentation semble donc fonctionner comme une validation expérimentale d’une hypothèse initiale.
II. La raison désorientée
La fable stoppardienne est ainsi structurée par la formule et le paradoxe, et la scène y est redéfinie comme un lieu de démonstration. Toutefois cette recherche de la forme logique ne caractérise pas seulement la démarche du dramaturge : elle est aussi le propre des personnages du théâtre de Stoppard. Leur désir de logique y est exploré sous toutes ses coutures, et fait l’objet d’une grande suspicion.
Animée par la quête du sens, la scène de Stoppard est peuplée de raisonneurs. Les deux personnages éponymes de Rosencrantz et Guildenstern sont morts, deux personnages mineurs d’Hamlet promus sur le devant de la scène, n’en finissent pas de chercher la logique à l’œuvre dans leur destin. Pour Guildenstern “[t]he scientific approach to the examination of phenomena is a defence against the pure emotion of fear” [20], et il n’aura de cesse de chercher à expliquer leur existence en apparence absurde. Cette obsession de l’explication est reprise en 1967 dans Another Moon Called Earth, où un logicien, Bone, s’efforce de découvrir la trame cachée des évènements de l’histoire, animé par la conviction que « tout est logique, tout s’intègre à notre destinée universelle » [21] , tandis que sa femme prône le relativisme moral et commet un meurtre sans aucun motif apparent. « Logic is all I ask » s’écrie Bone, et ce cri du cœur pourrait être celui de bien des personnages stoppardiens par la suite : le philosophe George Moore dans Jumpers, le prisonnier Alexander Ivanov dans Every Good Boy Deserves Favour, mais aussi l’espion éponyme de Hapgood ou l’historienne Hannah dans Arcadia, et bien d’autres encore, dans une longue galerie de raisonneurs qui se heurtent inévitablement à la résistance du réel sous le schéma logique.
En effet la position du raisonneur est sans cesse mise en péril, car deux de ses facultés sont constamment déstabilisées : celle de l’observation objective d’une part, celle de la prévision d’autre part. Comme le souligne Valérie Francoite-Chabin, le théâtre de Stoppard met en œuvre un « discrédit sévère des critères objectifs d’explication du monde et d’émergence du sens » qui aboutit à une « dislocation des certitudes » [22]. Ses pièces juxtaposent des versions contradictoires de la vérité, et les différentes visions des évènements s’y heurtent sans cesse. On a souvent remarqué que cette insistance sur la fabulation pouvait être rattachée à une esthétique postmoderniste [23]. Mais ce qui nous intéresse ici dans cette multiplication des points de vue est surtout la déstabilisation de l’observateur qui en résulte. Qu’il s’agisse de philosophes, d’historiens ou d’acteurs politiques, les raisonneurs de Stoppard cherchent inlassablement une vue d’ensemble, une vision globale qui leur permettrait de maîtriser les évènements. Cette stabilité leur est toutefois refusée, et c’est ainsi une conception théorique de la connaissance qui se trouve remise en cause, conception dans laquelle la notion grecque de theoria (de theôrein, « observer ») associe le savoir à la vision. L’observateur stoppardien ne peut trouver un point fixe d’observation, il est constamment désorienté et impliqué dans le monde qu’il contemple [24]. Dans un article publié en 1975 dans The Encounter, Cliver James compara cette déstabilisation constante à un univers Einsteinien qui se serait substitué à celui de Copernic, et Stoppard reprit ensuite cette description à son compte :
There is no observer. There is no safe point around which everything takes its proper place, so that you see things flat and see how they relate to each other. Although the Einstein versus Copernican image sounds pretentious, I can’t think of a better one to explain what he meant – that there’s no point of rest [25].
L’affirmation qu’il « n’y a pas d’observateur » peut paraître surprenante, puisque la figure du raisonneur implique toujours une tentative d’observation. Mais Stoppard réfute ici la possibilité d’une position neutre d’où l’on pourrait observer l’ensemble de la situation, et par là-même l’existence d’un pur spectateur. Sur cette scène instable, tout observateur sera aussi acteur des évènements.
La position théorique de ses personnages est ainsi systématiquement déstabilisée. Dans Albert’s Bridge, l’effondrement du pont marque de façon très dramatique la fin du regard surplombant, et on ne peut manquer de remarquer que le nombre de peintres envoyés par Fitch – 1800 en comptant Albert – correspond à la fin du siècle des Lumières et du règne philosophique de la raison. Selon Ewa Keblowska-Lawniczak, la fin d’Albert’s Bridge est représentative de la multiplication des perspectives et de la perte de la maîtrise visuelle qui sous-tend le théâtre de Stoppard, et qui prend ici la forme d’une « chute du sujet cartésien » [26]. En effet, la chute d’Albert marque l’impossibilité d’un regard détaché et dissocié de la réalité physique, et donc d’un fantasme de l’œil maîtrisant son spectacle. La fin de la belle équation du pont sonne le glas du rêve d’une existence neutre :
ALBERT … there are no consequences to a coat of paint. That’s more than you can say for a factory man ; his bits and pieces scatter, grow wheels, disintegrate, change colour, join up in new forms which he doesn’t know anything about ; in short he doesn’t know what he’s done to whom [27].
A l’instar d’Albert, les observateurs Stoppardiens ne pourront échapper aux « conséquences » : ils seront sans cesse impliqués dans cette vie qu’ils essaient de contempler, et surtout, dans ces histoires qu’ils tentent de narrer. Car le plus souvent, leur rationalisation du monde est une rationalisation des structures narratives qui les gouvernent, qu’il s’agisse de l’Histoire ou des autres récits qui ordonnent leur existence [28] . Ainsi dans Jumpers le professeur Moore tente de prouver une fois pour toute l’existence de Dieu, mais sera arraché à son grand travail théologique par la réalité de plus en plus incontournable d’un meurtre que sa femme dissimule dans sa chambre. Et nous verrons que dans Hapgood, cette impossibilité de l’observation neutre devient la clef de l’intrigue, puisque le physicien Kerner compare les incertitudes de l’interprétation politique à celles de la mécanique quantique, en soulignant que l’observateur influe toujours sur les réponses qu’il obtient.
La position du raisonneur se révèle donc toujours instable. Comme le soulignait déjà Stephen Toulmin en 1982, les spectateurs de Stoppard seront toujours impliqués dans les phénomènes observés, et cette méfiance postmoderne reflète ainsi les révolutions scientifiques du vingtième siècle, à une époque où « la posture traditionnelle du chercheur comme theoros, ou spectateur, ne peut plus être maintenue » [29] . Il paraît alors peu surprenant que Stoppard se soit tourné vers la science contemporaine pour y puiser ses métaphores.
III. L’incertitude modélisée
Stoppard remet ainsi en cause la position du sujet connaissant, et sa déstabilisation est renforcée par l’imprévisibilité des systèmes qu’il étudie. L’être humain – car le projet de connaissance est toujours, au fond, celui d’une connaissance de l’humain – déjoue les tentatives de prédiction en désobéissant aux règles qu’on lui a fixées. Nous atteignons ici une ambivalence constitutive de ce théâtre, car le raisonnement mathématique n’en reste pas moins un modèle : bien que la contradiction et le désordre viennent perturber les systèmes du raisonneur, la structure dramatique tend toujours vers une explication et une réaffirmation de la causalité intelligible [30]. L’instabilité épistémologique n’est que temporaire, et c’est dans le cadre de ce retour à l’explication logique, afin de formuler l’incertitude, que se produit le détournement de certaines théories mathématiques et physiques. Nous concluons donc cette analyse par une comparaison de trois pièces dont l’intrigue est explicitement structurée par une théorie scientifique et ses modèles : la théorie des catastrophes dans Professional Foul, la mécanique quantique dans Hapgood et la théorie du chaos dans Arcadia. Dans ces trois pièces l’emprunt scientifique se fait sur le mode du détournement métaphorique : à travers le monde de l’électron où les systèmes turbulents, c’est toujours de l’homme qu’il s’agit, et de sa rationalisation dans un modèle qui permet d’intégrer l’incertitude et la contradiction.
C’est dans sa pièce télévisée Professional Foul que Stoppard utilise pour la première fois une théorie scientifique pour structurer sa trame narrative. L’intrigue de Professional Foul repose sur le dilemme éthique rencontré par un philosophe, Anderson, pendant une visite à Prague en 1977. Invité par les autorités tchécoslovaques pour donner une communication sur l’éthique dans une conférence internationale, Anderson retrouve un de ses anciens étudiants, devenu dissident politique, qui lui demande d’emporter une thèse dans ses bagages lorsqu’il quittera le pays. Anderson refuse tout d’abord, car il serait contraire à ses principes éthiques de trahir la confiance d’un gouvernement dont il est l’invité. Le titre souligne cette idée, « foul » signifiant une faute commise dans un jeu, un coup qui ne respecte pas les règles. Mais au fil de la pièce il sera amené à reconsidérer sa position, et c’est la théorie d’un autre intervenant qui lui fournira la formulation nécessaire de sa contradiction. Au cours de la conférence, le philosophe McKendrick propose ce qu’il appelle une « application audacieuse » de la théorie des catastrophes à l’éthique. La théorie des catastrophes permet de construire des modèles mathématiques continus qui décrivent des phénomènes discontinus : le terme de « catastrophe » évoque cette discontinuité, et les points où une fonction change brusquement de forme. McKendrick se saisit de cette idée de renversement pour l’appliquer aux situations dans lesquelles on doit enfreindre une règle éthique pour agir moralement, et ainsi redéfinir brusquement la notion d’action « morale » :
MCKENDRICK … The mistake that people make is, they think a moral principle is indefinitely extendible, that it holds good for any situation, a straight line cutting across the graph of our actual situation – here you are, you see – (He uses a knife to score a line in front of him, straight across the table cloth, left to right in front of him.) ‘Morality’ down there ; running parallel to ‘Immorality’ up here – (He scores a parallel line.) – and never the twain shall meet. They think that is what a principle means.
ANDERSON And isn’t it ?
MCKENDRICK No. […] There’s a point – the catastrophe point – where your progress along one line of behaviour jumps you into the opposite line ; the principle reverses itself at the point where a rational man would abandon it [31]
Ce dialogue illustre parfaitement le double avantage de la modélisation mathématique pour Stoppard, car elle fournit à la fois une structure visuelle, qui permet de visualiser le paradoxe, et une structure narrative, qui va se superposer à l’intrigue dans la suite de l’action. La description de McKendrick n’est pas un modèle de précision, mais elle suggère graphiquement la nécessité de renoncer parfois à un système pour rester « rationnel ». Et alors que McKendrick se garde bien d’appliquer cette théorie, Anderson en fera la démonstration en emportant les documents interdits. Conformément à nos remarques précédentes, le raisonneur est donc forcé de changer son point de vue et de renoncer à sa position de theoros, en s’impliquant dans le jeu. Grâce au modèle mathématique, la démarche rationnelle est cependant préservée.
On retrouve ici la prédilection de Stoppard pour les intrigues fondées sur une forme paradoxale, et la greffe de la théorie mathématique sur la fable dramatique permet de formuler l’incohérence apparente en l’intégrant à une explication rationnelle. Dans le monde de l’espionnage représenté par Hapgood, cette greffe se produit deux fois, une première fois à l’échelle d’une scène et une deuxième à l’échelle de la pièce entière. Hapgood commence par un mystérieux échange de mallettes dans une piscine municipale, où les espions des deux blocs suivent un circuit complexe dans des cabines de douche, et à la fin de cette petite chorégraphie l’agent britannique Hapgood perd la mallette – et les informations – qu’elle croyait utiliser pour piéger un traître à la solde des russes. Cette scène d’ouverture donne le ton de la pièce, puisqu’il y sera constamment question d’échanges et de permutations. L’équipe de Hapgood, ainsi que l’agent américain Wates, sont incapables de comprendre ce qu’il s’y est passé, jusqu’à ce que la solution soit fournie par le physicien Kerner, qui compare la disposition des cabines au problème des sept ponts de Königsberg (Kaliningrad). Inspiré par la disposition particulière de Kaliningrad, avec ses deux îles reliées entre elles et au continent, le problème consiste à savoir si un promeneur peut parcourir les sept ponts qui relient les rives et les îles de la ville et revenir à son point de départ, sans passer deux fois sur le même pont. Muni d’un schéma, Kerner explique donc ce problème à Hapgood et au public :
KERNER … When I looked at Wates’s diagram I saw that Euler had already done the proof. It was the bridges of Konigsberg, only simpler.
HAPGOOD What did Euler prove ?
KERNER It can’t be done, you need two walkers [32].
Le modèle mathématique permet ainsi de visualiser le problème et d’en suggérer la solution : il s’agissait en fait non pas d’un, mais de deux espions. Cette première énigme fonctionne alors comme une miniature de la pièce entière : tout comme la première scène est modelée sur puis modélisée par les ponts de Königsberg, l’ensemble de la fable dramatique sera structurée par la métaphore de la dualité de la lumière. Résumés par Kerner dans de longs monologues décriés par la critique, les principes de la mécanique quantique se superposent aux incertitudes du monde de l’espionnage. Lorsque Hapgood se lance à la recherche du traître dans son équipe, la dualité de la lumière est transposée à l’énigme : « KERNER … The act of observing determines what’s what. […] Somehow light is continuous and also discontinuous. The experimenter makes the choice. You get what you interrogate for “[33].
Selon Kerner, aucune observation ne peut déterminer objectivement l’identité d’un être humain. Ses différentes facettes sont révélées par différentes méthodes d’interrogation, tout comme différents dispositifs d’observation peuvent démontrer la nature ondulatoire ou particulaire de la lumière. Cette métaphore physique est ensuite étendue pour englober, de façon très simplifiée, le principe d’incertitude d’Heisenberg : selon Kerner, dans le monde de l’espion comme dans celui de l’électron, les résultats de l’observation sont caractérisés par des relations d’incertitude, et « le monde des particules est l’univers rêvé de tout agent des services secrets » [34] . La métaphore quantique structure ainsi l’action de Hapgood, car les rebondissements de l’intrigue révèleront progressivement la présence d’agents doubles dans l’équipe (Kerner et Ridley), mais aussi de doubles (on découvrira que Ridley a un frère jumeau), et enfin la dualité fondamentale de l’identité humaine :
KERNER … We’re all doubles… The one who puts on the clothes in the morning is the working majority, but at night – perhaps in the moment before unconsciousness – we meet our sleeper – the priest is visited by the doubter, the Marxist sees the civilizing force of the bourgeoise, the captain of industry admits the justice of common ownership [35].
Au fil de la pièce, le rôle ambigu de Kerner illustrera l’idée que l’identité humaine peut comporter des facettes contradictoires, nécessitant parfois des descriptions alternatives et apparemment impossibles à concilier. D’agent double, il deviendra agent triple ou quadruple, ne sachant plus quel bloc retient son allégeance. Selon les questions qu’on lui pose, il sera l’un ou l’autre, démontrant ainsi qu’ « on obtient les réponses qu’on cherche ».
Tout comme la démonstration de McKendrick dans Professional Foul, la théorie scientifique sert ainsi à la fois de support visuel de l’énigme et de métaphore narrative qui vient structurer la fable. Mais alors que le modèle mathématique du professeur McKendrick était évoqué une seule fois dans la pièce, et fonctionnait directement comme une métaphore du problème exposé, les références scientifiques de Hapgood sont bien plus fréquentes et font l’objet de longues discussions entre les personnages. Pour construire sa métaphore, Stoppard s’est fortement inspiré des écrits de R. Feynman (Lectures on Physics et The Character of Physical Law) et de J. C. Polkinghorne (The Quantum World), ainsi que de toute une correspondance avec ce dernier au sujet de la mécanique quantique [36]. Entre Professional Foul et Hapgood, on passe donc de la métaphore scientifique ponctuelle à une intégration systématique de la théorie tout au long de l’intrigue. Le théâtre à référence scientifique est devenu un véritable théâtre d’idées [37], dont les longs passages théoriques laissèrent toutefois de nombreux spectateurs perplexes.
Alors que Hapgood avait été accueillie très froidement par la critique, Arcadia fut applaudie comme une intégration réussie du théorique et de l’humain [38]. Pour ne pas répéter les nombreuses analyses dont Arcadia a fait l’objet, nous nous bornerons ici à en rappeler les grandes lignes et à souligner la continuité qui relie cette pièce aux précédentes. L’intrigue repose, comme celle de Hapgood, sur une enquête. La pièce alterne entre deux époques dans une grande demeure anglaise, et juxtapose les évènements de 1809 et 1812 à l’interprétation de ces mêmes évènements par les occupants de la maison en 1991. Les scènes du dix-neuvième siècle suivent l’éducation d’un génie mathématique, la jeune Thomasina Coverly, par son tuteur Septimus Hodge, ainsi que les intrigues amoureuses des habitants de Sidley Park et de leurs visiteurs, les poètes Chater et Byron. Dans les scènes du vingtième siècle, les chercheurs Hannah Jarvis et Bernard Nightingale cherchent à reconstituer les évènements du dix-neuvième : Hannah retrace l’histoire du jardin de Sidley Park, et son évolution du classicisme au romantisme, tandis que Bernard tente de prouver que Byron a commis un meurtre pendant son séjour dans la maison. Un troisième chercheur enfin, le descendant de Thomasina, Valentine Coverly [39], poursuit des recherches mathématiques dans le domaine de la théorie du chaos. Le désir de connaissance, à tous les sens du terme, fournit donc le moteur de l’action, et d’emblée l’enquête historique est orientée par un parallèle avec l’enquête mathématique. Leur juxtaposition suggère la possibilité de greffer le modèle scientifique sur la démarche historiographique, et au fil de la pièce les découvertes mathématiques de Thomasina et les explications de Valentine fournissent des concepts qui seront transférés aux « systèmes » humains en question.
Dans la conception d’Arcadia, Stoppard avait poussé son enquête plus loin que pour Hapgood. Après diverses lectures sur la théorie du chaos (notamment Chaos, de James Gleick) et la géométrie fractale (notamment The Fractal Geometry of Nature, de Mandelbrot), il s’assura aussi que ses acteurs connaissaient suffisamment les théories en question, et leur fit visiter le laboratoire du professeur Robert May à Oxford [40]. Nourrie de ces recherches, la structure complexe d’Arcadia intègre des modèles mathématiques à de multiples niveaux. Au niveau thématique, les principes théoriques sont introduits par les réflexions de Thomasina, qui découvre successivement l’entropie, l’itération et la géométrie fractale. En plaçant ces notions dans la bouche d’une adolescente – Thomasina a treize ans au début de la pièce, seize à la fin – Stoppard s’assure que son public pourra comprendre leur formulation. Ainsi lorsque Thomasina découvre le deuxième principe de la thermodynamique, sa démarche est exprimée par une image enfantine de l’irréversibilité qui sert d’appui visuel au spectateur :
THOMASINA When you stir your rice pudding, Septimus, the spoonful of jam spreads itself round making red trails like the picture of a meteor in my astronomical atlas. But if you stir backward, the jam will not come together again. Indeed, the pudding does not notice and continues to turn pink just as before. Do you think this is odd ? […] You cannot stir things apart [41].
Par la suite, toutes les images choisis par Thomasina garderont cette simplicité, qu’il s’agisse de la feuille dont elle étudiera la forme fractale ou du lapin qui inspirera son étude d’une population par itérations successives. Valentine apportera une formulation plus mathématique à ces problèmes, mais les intuitions de la jeune fille fournissent au spectateur un point d’entrée dans l’univers mathématique.
En situant l’action au début de la période romantique, Stoppard souligne la parenté entre le romantisme et les idées d’entropie et de chaos que découvrent se personnages. Cherchant à mettre en avant le parallèle qu’on peut tracer entre les révolutions scientifiques et esthétiques, il superpose le contraste entre classicisme et romantisme à celui qui oppose les mathématiques de Newton aux nouvelles découvertes qui commencent à remettre en cause la conception newtonienne du déterminisme au dix-neuvième siècle. Ce parallèle entre science et esthétique est souligné par la citation de poèmes romantiques en écho aux théories scientifiques, ainsi que par la forme même de la pièce. En effet le traitement thématique de la science est renforcé par une esthétique inspirée par la géométrie fractale et ses principes d’itération et de similitude interne. La géométrie fractale permet de décrire des objets irréguliers caractérisés par l’autosimilarité, et Stoppard utilise ces notions pour souligner une organisation régulière dans la structure complexe de sa pièce. Ainsi, selon Christopher Innes, la structure temporelle intègre le principe de similitude interne, car les personnages du vingtième siècle reflètent, avec de légères variations, ceux du dix-neuvième . [42]. Nous pouvons étendre cette remarque à certaines images récurrentes à différentes échelles dans la pièce : par exemple, la spirale rosée de Thomasina est répercutée dans l’agencement des scènes, où les deux époques commencent par se succéder et finissent par coexister dans la dernière scène. Macrostructures et microstructures se répondent, et l’une des formes les plus récurrentes de cette similitude interne est l’omniprésence du triangle dans les rapports entre personnages. Selon Ira Nadel, cette disposition seraient inspirée par le triangle fractal de Sierpinski, qui a fourni l’une des clefs de l’intrigue pour Stoppard et qu’on retrouve dans des positionnements triangulaires dans ses indications de mise en scène [43]. Bien qu’on ne puisse pas légitimement parler d’ « application » de la théorie à l’esthétique dramatique, les idées mathématiques sont ainsi mises en jeu par le réseau d’images de la pièce [44].
Enfin, certains principes de la théorie du chaos structurent la trame narrative, car les péripéties de l’enquête sont nourries par une grande sensibilité aux conditions initiales. Valentine, qui étudie les phénomènes de variation de population, souligne l’impossibilité de prendre en compte toutes les causes dans un système :
VALENTINE … The unpredictable and the predetermined unfold together to make everything the way it is. […] We can’t even predict the next drip from a dripping tap when it gets irregular. Each drip sets up the conditions for the next, the smallest variation blows prediction apart, and the weather is unpredictable the same way, will always be unpredictable. […] The future is disorder. [45]
Cette impossible prédiction sera en effet illustrée par l’enquête historique de Hannah et Bernard, car les évènements du dix-neuvième siècle seront le plus souvent déterminés par des causes infimes aux conséquences imprévisibles. L’ignorance de ces facteurs amène Bernard à construire une version complètement fausse des évènements, dans laquelle Byron se conduit en bon héros romantique et tue son rival, Chater, dans un duel. Comme dans Hapgood, l’observateur obtient les résultats qu’il cherche, et la réalité, à laquelle les spectateurs ont un accès privilégié, est bien différente : c’est Septimus, et non Byron, qui se bat en duel, et la mort de Chater sera due à une simple morsure de singe. La sensibilité aux conditions initiales est donc exploitée à des fins comiques, jusqu’à ce que la démarche rationnelle de Hannah rétablisse cette version des évènements. La métaphore scientifique permet ainsi de construire une réflexion sur le processus d’interprétation, et celle-ci s’applique aussi bien au spectateur qu’aux personnages. Le public se laisse prendre au jeu herméneutique en traitant les différentes informations qu’on lui donne, et le caractère vivant de l’expérience théâtrale renforce l’aspect ludique de ce processus [46].
La particularité d’Arcadia est donc de mettre en abyme son utilisation métaphorique du modèle scientifique. Le modèle des systèmes non-linéaires fournit une métaphore narrative qui structure aussi bien la démarche historiographique des personnages (la fable dans la fable) que la fable dramatique qui les gouverne. Le rôle primordial du discours scientifique est ainsi de fournir une structure narrative, et Stoppard joue visiblement sur la polysémie du mot plot –souvent employé par Valentine et Thomasina – qui peut désigner la représentation d’une équation dans un système de coordonnées, mais aussi l’intrigue ou la fable dramatique, plot étant la traduction la plus courante du mythos d’Aristote [47] . Dans cette intégration systématique de la fable et du discours scientifique, la théorie scientifique participe de la « collusion générique » de la pièce, « tour à tour une comédie de mœurs, une enquête policière, une démonstration mathématique, une conférence universitaire, une énigme littéraire » [48], tout en étant un modèle privilégié qui permet à Stoppard de renouveler la fable dramatique en y intégrant l’incertitude fondamentale de l’entreprise de connaissance [49].
De l’équation au graphique, de l’axiome à la théorie, la modélisation scientifique du réel fournit ainsi un motif récurrent dans le théâtre de Stoppard. Au fil des pièces le « modèle » se transforme : les axiomes d’Euclide sont remplacés par des fractales et des systèmes chaotiques, et la séduction de la formule et du paradoxe cède la place à l’expression de l’incertitude et de l’imprévisible. Mais l’attrait du discours scientifique reste toujours celui de la formulation du monde, dans un théâtre qui, malgré son instabilité herméneutique, ne renonce jamais à dire l’humain, et à soumettre le monde et la scène à l’emprise du logos.
ps:
ISSN 1913-536X ÉPISTÉMOCRITIQUE (SubStance Inc.), Vol. II, 2008
notes:
[1] Ces pieces sont recensées dans l’ouvrage de Charles A. Carpenter, Dramatists and the Bomb : American and British Playwrights Confront the Nuclear Age, 1945-1964 (Westport, Conn., Greenwood Press, 1999).
[2] Selon Nicole Boireau, c’est au cours des années 80 que « la pensée scientifique semble prendre le relais de la thématique de la guerre froide. […] A la fois thème et structure, la science prend une place de premier plan dans la démarche intellectuelle et dramaturgique de certains auteurs, et non des moindres, tels Terry Johnson, Howard Brenton, Tom Stoppard, Edward Bond, Michael Frayn, Timberlake Wertenbaker. Les paradoxes de la pensée postmoderne informent le travail scénique et l’écriture dramatique. » (Théâtre et société en Angleterre des années 1950 à nos jours, Paris, Presses Universitaires de France (Perspectives anglo-saxonnes), 2000, p. 144)
[3] Pour une analyse détaillée du phénomène des science plays, on se reportera à l’ouvrage de Kirsten Shepherd-Barr, Science on Stage, From Dr Faustus to Copenhagen (Princeton University Press, 2006).
[4] John Fleming, Stoppard’s Theatre : Finding Order Amid Chaos, Austin, University of Texas Press, 2001, p. 253.
[5] Nicole Boireau, Théâtre et société en Angleterre, op. cit., p. 231.
[6] Elisabeth Angel-Perez, Le Théâtre anglais, Paris, Hachette, 1997, p. 125.
[7] “A play in the theatre is an equation which is continuously changing and most of the variables are specific to the performance”, Tom Stoppard, « The text’s the thing », Daily Telegraph, 23/04/88.
[8] “My plays may have a fragmented look, but they’re very traditional plays. Everything is logical and rational”, entretien avec Stanley Eichelbaum, San Francisco Examiner, 28/03/1977, in Paul Delaney (éd.), Tom Stoppard in Conversation, University of Michigan Press, 1994, p. 105.,
[9] Entretien avec Stephen Schiff, Vanity Fair, 52-5, mai 1989, in Paul Delaney, Tom Stoppard in Conversation, op. cit, p. 223. « Les paradoxes m’attirent. Ils ont une forme, comme une architecture. […] On dirait un processus de pensée concrétisé, dont on peut voir la forme et la structure. »
[10] La biographe Ira Nadel affirme que Beckett aurait servi de modèle à Stoppard, car il était lui aussi fasciné par les mathématiques et leurs paradoxes (Double Act, A Life of Tom Stoppard, Londres, Methuen, 2002, p. 426).
[11] Tom Stoppard, Albert’s Bridge, Londres, Samuel French, 1969, p. 12. “Ce projet, je le ressens comme de la poésie : l’équation parfait du temps, de l’espace et de la vitesse de travail… C’est le sens même du rendement ; de l’efficacité et des mathématiques…”, Albert et son pont, adaptation française de J.-F. Prévand et Stephan Meldegg, éds. Du Laquet, 1994 (1979), p. 14.
[12] Tom Stoppard, Albert’s Bridge, op. cit., p. 27-28. « Je ne pouvais plus supporter le bruit et le chaos, ni l’obsession d’un si irrationnel magma d’effets et de causes toujours à la merci du hasard et jamais à l’abri de la moindre réaction en chaîne. […] [V]u d’ici tout paraît harmonieux… ordonné en petites cases, à chaque petite case une fonction, et à chaque fonction un petit point… et tout d’un coup ça a même l’air de fonctionner… c’est vrai qu’à une telle altitude : l’idée même de société peut paraître supportable », Albert et son pont, op. cit., p. 43-44.
[13] Tom Stoppard Albert’s Bridge, op. cit., p. 36. « [L]es lois de la physique sont inviolables […] Et si on n’en tient pas compte, le pont va trembler, les poutrelles vibrantes, tendues à craquer, vont gonfler, se dilater… », Albert et son pont, op. cit., p. 55-56.
[14] Dans un article publié dans le New York Times, Stoppard souligne l’embarras du gouvernement tchècoslovaque face à la décision de Havel de refuser un visa de sortie du pays : sous le regard de la presse internationale, les autorités devaient alors choisir entre la poursuite de leur logique de répression et l’admission de leur erreur (article cité dans John Fleming, Stoppard’s Theatre, op. cit., p.123-124).
[15] Tom Stoppard, Every Good Boy Deserves Favour and Professional Foul, Londres, Faber and Faber, 1978, p. 25. “Ils ne veulent pas céder du terrain. Il leur faut une formule.”
[16] Tom Stoppard, Every Good Boy Deserves Favour, op. cit., p. 19-20.
– SACHA. « Le point est une figure géométrique sans dimension. »
– LA MAITRESSE. L’asile de fous est fait pour les mécontents qui ne savent pas ce qu’ils font.
– S. « Un point qui se déplace engendre une ligne ».
- Ils savent ce qu’ils font mais ils ne savent pas que c’est anti-social.
- « La ligne droite est le plus court chemin d’un point à un autre. »
- Ils savent que c’est anti-social mais ce sont des fanatiques.
- « Une circonférence est une ligne courbe dont tous les points sont à égale distance d’un point fixe appelé centre. »
- Ce sont des malades.
- « Le polygone est une surface plane limitée par des lignes droites. »
- Et ce n’est pas une prison, c’est un hôpital.(La Musique adoucit les mœurs, adaptation française de Guy Dumur, L’Avant-Scène, 1/10/80, 48).
[17] Tom Stoppard, Squaring the Circle, with Every Good Boy Deserves Favour and Professional Foul, Londres, Faber and Faber, 1984. Le problème de la quadrature du cercle consiste à construire un carré de même aire qu’un cercle à l’aide d’une règle et d’un compas.
[18] Hapgood, in Plays : 5, Londres, Faber and Faber, 1999, p. 543. « Quand je rédige une expérience je ne cherche pas à surprendre, ce n’est pas une plaisanterie. C’est ce qui fait la beauté d’une publication scientifique : d’abord, voici ce que nous allons trouver ; puis voici comment nous allons le trouver ; voici la première énigme, voici la solution, à présent nous pouvons passer à autre chose. Ceci est poli. Nous ne gardons pas toutes les réponses pour la fin pour assurer le triomphe de l’auteur. »
[19] Entretien avec Mel Gussow, in Mel Gussow, Conversations with Stoppard, Londres, Nick Hern Books, 1995, p. 78. « C’est l’hypothèse qui a généré la pièce elle-même, que la dualité de la lumière pouvait aussi être appliquée aux personnes, et que la personnalité qu’on rencontre en public n’est que la majorité fonctionnelle de cette personne. »
[20] Tom Stoppard, Rosencrantz and Guildenstern Are Dead, Londres, Samuel French, 1967, p. 4. “L’approche scientifique des phénomènes est une défense contre l’émotion pure de la peur”, Rosencrantz et Guildenstern sont morts, adaptation française de Lisbeth Schaudinn et Eric Delorme, Eds du Seuil, 1967, p. 16.
[21] « everything is logical and connects into the grand design », Tom Stoppard, Another Moon Called Earth, in The Dog It Was That Died and Other Plays, Londres, Faber and Faber, 1983, p.101.
[22] « Nourrie d’une perte de confiance dans les schémas de pensée traditionnels, cette dislocation des certitudes engendre chez Stoppard un processus de désacralisation. Les notions fondamentales qui structuraient notre imaginaire ont perdu toute légitimité, les repères ontologiques et les outils herméneutiques ont disparu, la vérité est devenue résolument suspecte », Valérie Francoite-Chabin, « Stoppard par lui-même : lecture croisée d’Arcadia (1993) et de Travesties (1974) », Cycnos, vol. 18, n°1, 2001, p. 25-26.
[23] Rappelons que dans la définition proposée par Gianni Vattimo, « [a]u lieu de se rapprocher de l’autotransparence, la société de communication généralisée et des sciences humaines s’est rapprochée de ce que l’on pourrait appeler, du moins en général, la « fabulation du monde ». Les images du monde que les média et les sciences humaines nous fournissent, fût-ce dans des domaines distincts, constituent l’objectivité même du monde et non uniquement des interprétations différentes d’une « réalité » qui est de toute façon « donnée ». « Il n’y a pas de faits, écrivait Nietzsche, il n’y a que des interprétations » ; et encore : « Le monde vrai, pour finir, devient fable. » » (La société transparente, trad. J.-P. Pisetta, Paris, Desclée de Brouwer, 1990, p. 39).
[24] Hersh Zeifman rattache d’ailleurs cette « dislocation de la perspective » à une esthétique post-absurde plutôt que postmoderniste (Hersh Zeifman, “A Trick of the Light : Tom Stoppard’s Hapgood and Postabsurdist Theater”, in Around the Absurd : Essays on Modern and Postmodern Drama, Enoch Brater et Ruby Cohn (éds.), University of Michigan Press, 1990, p. 189).
[25] Entretien avec Ronald Hayman cité dans Ewa Keblowska-Lawniczak, The Visual Seen and Unseen, Insights into Tom Stoppard’s Art, Wroclaw, Wydawnictwo Universyteu Wroclawskiego, 2004, p. 101. « Il n’y a pas d’observateur. Il n’y a pas de point stable autour duquel tout prendrait sa place, et grâce auquel on pourrait mettre les choses à plat et voir les relations entre elles. L’image d’Einstein contre Copernic a l’air prétentieuse, mais je ne trouve pas de meilleure façon d’expliquer ce qu’il voulait dire : il n’y a pas de point fixe. »
[26] Ewa Keblowska-Lawniczak, The Visual Seen and Unseen, Insights into Tom Stoppard’s Art, Wroclaw : Wydawnictwo Universyteu Wroclawskiego, 2004, p.65.
[27] Tom Stoppard, Albert’s Bridge, op. cit., p. 3. « … une couche de peinture et tout est dit, défini et vécu… L’ouvrier d’usine, lui ne connaîtra pas ce bonheur ! Les pièces qu’il fabrique seront disséminées, lui échapperont, il leur poussera des roues, elles se désintégreront, changeant de couleur, se rassembleront ailleurs en de nouvelles formes qu’il ne connaîtra même jamais… Bref au contraire de toi, il ne saura jamais ce qu’il a fait et ce qu’il a été… » (Albert et son pont, op. cit., p.14).
[28] Selon Valérie Francoite-Chabin, « [l]a marque de fabrique stoppardienne, c’est bien la subversion de l’Histoire. » (« Stoppard par lui-même », op. cit., p. 26). Nous étendons ici cette idée à la notion de récit en général, et ainsi à la fable dramatique.
[29] “the pure scientist’s traditional posture as theoros, or spectator, can no longer be maintained”, Stephen Toulmin, The Return to Cosmology, Postmodern Science and the Theology of Nature, University of California Press, 1982, p. 255. Stephen Toulmin affirme que le théâtre de Stoppard exprime particulièrement clairement la « mort du spectateur » qui caractérise la science de l’époque postmoderne.
[30] John Fleming a d’ailleurs souligné cette ambivalence dans le titre de son ouvrage sur Stoppard : Stoppard’s Theatre : Finding Order Amid Chaos (op. cit.).
[31] Tom Stoppard, Professional Foul, in Every Good Boy Deserves Favour and Professional Foul, op. cit., p.77-78.
MCKENDRICK … Les gens croient qu’un principe moral peut s’étendre infiniment, qu’il s’applique à toute situation, comme une ligne droite qui traverse le graphique de notre situation – vous voyez – (Il utilise un couteau pour tracer une ligne sur la nappe, de gauche à droite.) la « moralité » ici, en bas, parallèle à l’ « immoralité » là-haut – (Il trace une ligne parallèle.) – et elles ne se rencontreront jamais. Les gens pensent que c’est ce que signifie un principe.
ANDERSON Et ce n’est pas le cas ?
MCKENDRICK Non. […] A un point donné – le point de la catastrophe – votre trajet le long d’une ligne de comportement vous fait passer sur la ligne opposée ; le principe se renverse au point où un homme rationnel l’abandonnerait. (Tom Stoppard, Hapgood, op. cit., p. 541-542.)
[32] Tom Stoppard, Hapgood, op. cit., p. 541-542.
KERNER … Quand j’ai regardé le diagramme de Wates, j’ai vu qu’Euler avait déjà trouvé la solution. C’était les ponts de Konigsberg, en plus simple.
HAPGOOD Qu’est-ce qu’Euler a prouvé ?
KERNER C’est impossible, il faut deux promeneurs.
[33] Ibid, p. 501.
KERNER … L’acte d’observation détermine la réalité. […] La lumière est à la fois continue et discontinue. C’est l’expérimentateur qui choisit. L’interrogateur obtient les réponses qu’il cherche.
[34] « [t]he particle world is the dream world of the intelligence officer », Ibid, p. 544.
[35] Ibid, p. 572-573.
KERNER … Nous sommes tous des doubles… Celui qui s’habille le matin est la majorité fonctionnelle, mais la nuit – peut-être dans le dernier instant avant le sommeil – nous rencontrons notre espion double – le prêtre reçoit la visite du sceptique, le marxiste perçoit la force civilisatrice de la bourgeoise, le capitaine d’industrie reconnaît la justice de la propriété commune.
[36] Ira Nadel analyse ces sources en détail dans Double Act, A Life of Tom Stoppard (Londres, Methuen, 2002). Une partie de la correspondance entre Stoppard et Polikinghorne fut incluse dans le programme de la première production de Hapgood, à l’Aldwych Theatre en mars 1988.
[37] L’inclusion de passages théoriques ainsi que l’importance relative des discussions par rapport à l’action peut être comparée à une forme de théâtre d’idées conceptualisée par G. B. Shaw, la discussion play. Shaw est considéré comme l’inventeur du théâtre d’idées en Angleterre : dans ses écrits et surtout dans ses nombreuses préfaces il affirma qu’un théâtre ambitieux se devait de privilégier le débat d’idées, et que la forme dramatique idéale était donc celle d’une pièce argumentative dont le dénouement serait une démonstration verbale des idées illustrées par l’intrigue. Stoppard lui-même revendique son appartenance à un théâtre d’idées, mais tandis que Shaw construisait des pièces à thèse qui défendaient la position engagée de leur auteur, celles de Stoppard se comprennent plutôt sur un mode hypothétique. Hapgood, on l’a dit, prend pour point de départ une « hypothèse » que Stoppard cherchait à explorer, et celle-ci suggère justement l’invalidité des interprétations uniques. Si Hapgood et Arcadia semblent se rattacher à un certain théâtre d’idées, la multiplication des perspectives qui les caractérise nous invite donc plutôt à parler de théâtre d’hypothèses que de pièce à thèse.
[38] Voir la comparaison proposée par Paul Edwards dans “Science in Hapgood and Arcadia”,dans K. E. Kelly (ed.), The Cambridge Companion to Tom Stoppard, Cambridge University Press, 2001, 169-184.
[39] Valentine est un prénom masculin.
[40] Voir Ira Nadel, Double Act, op. cit., et Prapassaree et Jeffrey Kramer, ‘Stoppard’s Arcadia : Research, Time, Loss’, Modern Drama, 40, 1997, p.1-10.
[41] T.Stoppard, Arcadia, in Plays : 5, Londres, Faber and Faber, 1999, p. 12. « Quand on mélange une cuillérée de confiture dans le riz au lait, Septimus… On tourne dans un sens, la confiture dessine des stries rouges à la surface, comme la gravure d’un météore dans mon atlas d’astronomie. Mais si on tourne dans l’autre sens, la confiture ne se reconstitue pas. Le riz au lait fait comme si de rien n’était et continue de devenir rosé. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? […] On ne peut pas tourner pour « reséparer » », Arcadia, adaptation française de J.-M. Besset, Actes Sud, 1998, p. 15.
[42] Innes, Modern British Drama, The Twentieth Century, Cambridge University Press, 2002, p. 421.
[43] Ira Nadel, Double Act, op. cit., p. 432.
[44] On se gardera de parler ici d’« esthétique fractaliste » : comme le souligne Jean-Claude Chirollet, « [i]l n’est pas certain qu’on ait eu besoin d’attendre Mandelbrot pour mettre en œuvre une pratique fondée sur […] la répétition indéfinie d’un même motif à diverses échelles » (« En quel sens peut-on parler d’une « esthétique fractaliste » ? », in Yves Abrioux (éd.), Littérature et théorie du chaos, Théorie, Littérature, Enseignementn°12, automne 1994, p. 139). Selon K. Shepherd-Barr, cette intégration formelle des concepts scientifiques peut être considérée sous l’angle de la performativité et des théories de J. L. Austin, les concepts scientifiques étant mis en jeu par le dialogue dramatique (voir Science on Stage, op. cit., p. 33-36).
[45] Tom Stoppard, Arcadia, op. cit., p. 68-69. « L’imprévisible et le prédéterminé se conjuguent pour créer les choses comme elles sont. […] On ne peut même pas prédire quand un robinet réparé va se remettre à fuir. Car si chaque fuite contient les conditions de la prochaine fuite, la moindre variation peut réduire les prévisions à néant. De même pour le climat, qu’on ne pourra jamais prévoir. […] L’avenir est désordre », Arcadia, op. cit., p. 58.
[46] Comme l’a souligné Kirsten Shepherd-Barr, la représentation théâtrale est par nature soumise elle aussi à une certaine sensibilité aux conditions initiales (‘From Copenhagen to infinity and beyond : science meets literature on stage’, Interdisciplinary Science Reviews, 28 – 3, 2003, p. 196).
[47] Comme le souligne Kenneth Knoespel, « [l]e mot anglais plot nous place devant tout un éventail d’intérêts disciplinaires qui comprennent la Poétique d’Aristote, le navigateur qui repère une position au milieu de la mer ou des étoiles, le mathématicien qui représente une équation selon des coordonnées cartésiennes, sans oublier l’espace dans lequel le fermier plante ses choux. […] Plot apparaît pour la première fois pour désigner un plan ou projet d’écriture au XVIe siècle, et c’est cette extension métaphorique du terme qui justifie son application au plan d’un récit poétique ou d’un acte politique prémédité. Plot se trouve pris dans une tradition discursive encore plus complexe quand il en vient à traduire le mot latin fabula, qui est lui-même censé rendre les mots grecs logos et muthos » (‘L’écriture, le chaos et la démystification des mathématiques’, dans Yves Abrioux (éd.), Littérature et théorie du chaos, Théorie, Littérature, Enseignement n°12, automne 1994, 41-68).
[48] Valérie Francoite-Chabin, « Stoppard par lui-même », op. cit., p. 33.
[49] Selon Daniel Jernigan, Stoppard « normalise » les épistémologies « radicales » qu’il emprunte à la science dans Hapgood et Arcadia, car il s’en sert pour confirmer l’existence d’une explication narrative des évènements, alors que les lectures postmodernes de la mécanique quantique et de la théorie du chaos, notamment celle de Lyotard, tendent plutôt à les utiliser pour remettre en cause l’idée du récit unique (‘Tom Stoppard and « Postmodern Science » : Normalizing Radical Epistemologies in Hapgood and Arcadia‘, Comparative Drama, Printemps 2003, 37-1, 3-35).