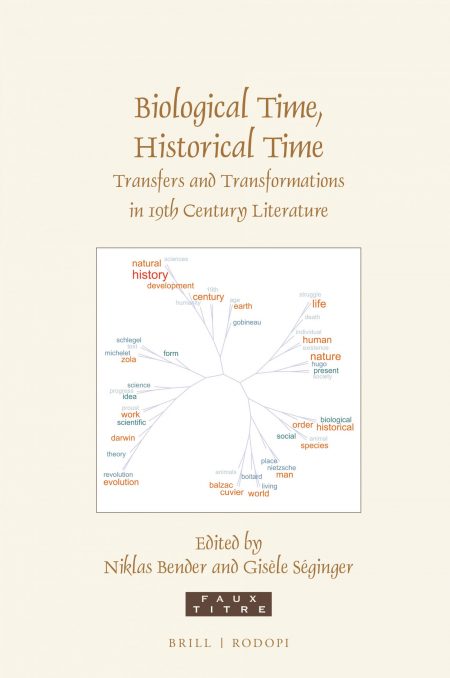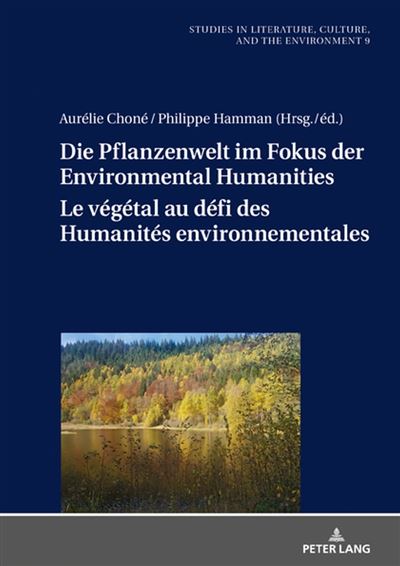L’art du diagramme
Peut-on penser l’invention intellectuelle par-delà les partages entre science et littérature ? Existe-t-il un art de l’invention commun à toutes les activités créatrices ? Pour cerner ce moment mystérieux qui détermine l’art de trouver, cet ouvrage propose de remonter vers le stade «diagrammatique » de la pensée, avant qu'elle se matérialise dans des chiffres ou des lettres, pour se faire science ou littérature. Saisi au-delà de son usage instrumental, le diagramme est ici considéré comme un outil intellectuel qui ne sert ni à représenter ni à illustrer un phénomène déjà existant mais à faire émerger des possibilités de pensée. Qu’il représente le germe d’une œuvre artistique ou le premier jaillissement graphique d’une future théorie, il joue un rôle décisif dans la fabrique de la pensée à laquelle il fraye un chemin vers la production du nouveau.




 Cet ouvrage collectif, dont le titre est une allusion à E.T.A. Hoffmann et son Marchand de sable, réunit quinze contributions (en allemand et en français) à un colloque ayant eu lieu à l’Université de Neuchâtel (Suisse) en novembre 2014. Il s’inscrit dans les recherches actuelles menées dans le cadre de la Maison des Littératures et du Laboratoire d’études des littératures et savoirs de l’Université de Neuchâtel sur la vision et l’épistémologie visuelle
Cet ouvrage collectif, dont le titre est une allusion à E.T.A. Hoffmann et son Marchand de sable, réunit quinze contributions (en allemand et en français) à un colloque ayant eu lieu à l’Université de Neuchâtel (Suisse) en novembre 2014. Il s’inscrit dans les recherches actuelles menées dans le cadre de la Maison des Littératures et du Laboratoire d’études des littératures et savoirs de l’Université de Neuchâtel sur la vision et l’épistémologie visuelle