Table des matières
Actes du colloque international Projections : des organes hors du corps (13-14 octobre 2006) Table des matières Hugues Marchal et Anne Simon – Présentation 1…
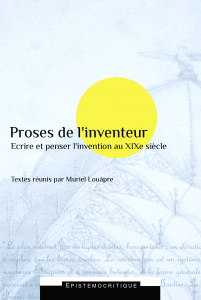 Proses de l’inventeur. Ecrire et penser l’invention au XIXè siècle
Proses de l’inventeur. Ecrire et penser l’invention au XIXè siècleDétrôné au siècle suivant par le savant-chercheur, l’inventeur n’est pas encore au XIXe siècle ce spécimen loufoque qui prêtera à rire dans les futurs concours Lépine. Au contraire, la France postrévolutionnaire voit le sacre de l’inventeur comme figure d’exception, dont la légitimité a été renforcée par l’essor des sociétés d’émulation et la mise en place des systèmes de brevets, maillon indispensable entre l’invention et le capitalisme naissant. La création de la Société des inventions et découvertes composée « d’inventeurs, de savants, d’artistes et d’amateurs […] sans prééminence entre ces quatre classes » comme l’annoncent en 1790 ses statuts, a préparé et facilité l’adoption d’une loi « relative aux découvertes utiles et aux moyens d’en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs », première pierre de notre législation sur les brevets. La monarchie de Juillet va également favoriser l’invention, notamment avec la loi de 1844 qui facilite le dépôt de brevet, puis la fondation en 1849 par le Baron Taylor de l’Association des Inventeurs et Artistes Industriels, qui marque le glissement vers un monde de l’invention divisé entre arts appliqués et mécanique, incluant désormais les ingénieurs. Le premier XIXe siècle est donc particulièrement attentif à l’inventeur, rouage précieux du nouveau système capitaliste ; c’est le temps des David Séchard, à la fois synthèse et référence d’un inventeur idéaliste sorti du rang, et au service du bien commun. Plus loin dans le siècle, en 1867, un pamphlet d’Yves Guyot défend explicitement un idéal de l’inventeur héraut de la société démocratique et républicaine, et constitue de ce fait un marqueur dans la construction médiatique cette fois du personnage d’inventeur.
 Théâtre et médecine.
Théâtre et médecine.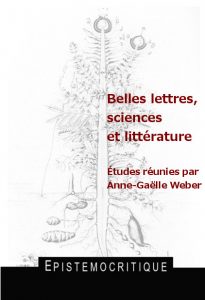 Belles lettres, sciences et littérature
Belles lettres, sciences et littératureS’il existe désormais de nombreuses études sur la question des „deux cultures“ et des partages disciplinaires entre sciences et humanités, elles tiennent rarement compte de l’écart existant entre le décret de leur séparation et sa réalisation effective, qui n’a pas toujours pris des formes aussi définitives ou univoques qu’on le croit généralement. C’est l’ambition de cet ouvrage que de redessiner l’histoire des articulations de la science et de la littérature en prenant pour point de repère temporel l’apparition de la notion moderne de « littérature » et le remplacement progressif du système des Belles Lettres par une nouvelle organisation des disciplines de l’esprit. Les études de cas réunies ici dessinent une nouvelle histoire de la séparation des « deux cultures », qui tient compte de l’extrême variabilité historique et culturelle des mots « science » et « littérature ». Peut-on échapper à l’illusion rétrospective lorsqu’on analyse, à partir de nos catégories présentes, les « sciences » et les « littératures » passées ? Convient-il de subsumer l’étude de leurs rapports sous des catégories plus générales, comme les « imaginaires », ou faut-il considérer que les liens entre science et littérature jouent un rôle spécifique pour l’histoire de chacune de ces disciplines, qu’elles sont archétypales de certaines évolutions culturelles ? Tout en ébauchant un certain nombre de réponses à ces questions, cet ouvrage suggère que le modèle contemporain
la spécialisation des disciplines savantes pourrait être nuancé, voire remodelé dans le sens d’une plus grande complexité.
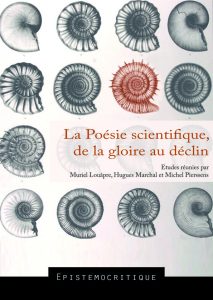 La Poésie scientifique, de la gloire au déclin
La Poésie scientifique, de la gloire au déclinCe volume réunit les actes d’un colloque international organisé à Montréal en 2010. Il part d’une interrogation, et ouvre un champ d’investigation : après avoir connu une sorte d’apogée à la fin des Lumières, autour de figures comme Delille, Erasmus Darwin ou Goethe, la « poésie scientifique » a-t-elle disparu avec le romantisme, qui, selon Sainte-Beuve, consomma la déroute de la poésie didactique et descriptive ? A-t-elle au contraire survécu, comme le suggère l’analyse quantitative des données éditoriales françaises, jusqu’en 1900 ? En ce cas, que faire des œuvres qui ont cherché, après cette date, à réinventer les modalités d’un dialogue entre poème et sciences, quitte à tourner le dos à toute tradition antérieure ? Peut-on encore parler d’un même genre ? Enfin le destin de cette poésie fut-il identique en France et dans d’autres pays européens ? Ce sont les pièces de cette enquête en cours, poursuivie selon d’autres voies par l’anthologie Muses et Ptérodactyles (Seuil, 2013), qui sont versées ici au dossier, avec 26 contributions synthétiques, monographiques ou théoriques, couvrant plusieurs siècles et plusieurs langues, du XVIIIe siècle à nos jours.
Conference Proceedings of the International Workshop Archives of the Body. Medieval to Early Modern, Cambridge University, 8-9 Sept. 2011. Téléchargez l’ouvrage en format pdf : Nous remercions la Bibliothèque de l’Académie Nationale de Médecine pour l’illustration de couverture : (c) Bibliothèque de l’Académie Nationale de Médecine
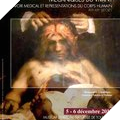 Mécaniques du vivant : Savoir médical et représentations du corps humain (XVIIe–XIXe siècle)Sous la direction de Laurence Talairach-Vielmas
Mécaniques du vivant : Savoir médical et représentations du corps humain (XVIIe–XIXe siècle)Sous la direction de Laurence Talairach-VielmasActes du colloque. Explora 2011 à l’Université de Toulouse « Mécaniques du vivant : savoir médical et représentations du corps humain » Télélarchargez le livre en format pdf : Pages 1-70 : Pages 71-129
Ce dossier spécial présente les Actes du colloque tenu les 13-14 octobre 2006 au MAC-VAL, Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne. Les actes du colloque PROJECTIONS : des organes hors du corps sont téléchargeables soit sous la forme d’un volume complet au format pdf (mais attention : la durée du téléchargement du fichier de 65M dépendra de votre bande passante) soit en cliquant ici pour une consultation chapitre par chapitre. [Actes->http://rnx9686.webmo.fr/IMG…] du Colloque International Projections : des organes hors (…)
Vingt mille notes sous les textes — Daniel Compère Le document chez Jules Verne : valeur didactique ou facteur de configuration romanesque ? — Philippe Scheinhardt Technologies et société du futur : procédés et enjeux de l’anticipation dans l’œuvre de Jules Verne — Julien Feydy Les Voyages extraordinaires ou la chasse aux météores — Christian Robin Cartonnages et illustrations : de Jules Verne à Robida — Sandrine Doré et Ségolène Le Men
Actes du colloque international Projections : des organes hors du corps (13-14 octobre 2006) Table des matières Hugues Marchal et Anne Simon – Présentation 1…
Vingt mille notes sous les textes — Daniel Compère Le document chez Jules Verne : valeur didactique ou facteur de configuration…
Téléchargez le volume complet au format PDF : Courant-Enriquez_Intégrale ISBN PDF : 979-10-97361-05-1
Réseaux médico-littéraires dans l’Entre-deux-guerres Revues, institutions, lieux, figures Sous la direction de Julien Knebusch et Alexandre Wenger Téléchargez le volume complet…
ACTES DU COLLOQUE « LES ESPRITS ANIMAUX » XVIème–XXIème SIÈCLE : LITTERATURE, HISTOIRE, PHILOSOPHIE Ouvrage publié à la suite du colloque « LES ESPRITS ANIMAUX…
Études réunies par Anne Chassagnol, Camille Joseph et Andrée-Anne Kekeh-Dika ISBN numérique PDF : 979-10-97361-10-5 Télécharger l'ouvrage PDF Table des…
Ce volume est issu d'une journée d’études de l’axe Prose des Savoirs du CERILAC-Paris 7, axe piloté par Paule Petitier…
Théâtre et Médecine Table des matières Avant-propos Florence Filippi 6 Introduction Pour une poétique de la pratique…
Actes du colloque "La Poésie scientifique, de la gloire au déclin", Montréal, 15-17 septembre 2010 Table des matières Introduction 5 Vues d’ensemble :…
Dans son numéro de février 1931, la revue française Art et médecine reproduit en pleine page une photographie prise à l’occasion de l’un des « dîners d’Art et médecine »1. On y reconnaît les poètes Paul Valéry et Luc Durtain entourés de médecins, au rang desquels figure le Dr François Debat, directeur des prospères laboratoires dermatologiques qui portent son nom, propriétaire de la revue et financeur des dîners en question. Art et médecine est elle-même une revue luxueuse, richement illustrée, proposant des commentaires d’œuvres littéraires et des reportages artistiques aussi bien que des éloges médicaux. Outre celle des médecins, elle s’adjoint la participation régulière d’écrivains reconnus tels que Jean Cocteau, Pierre Mac Orlan, François Mauriac, Jules Romain, Maurice Maeterlinck, Paul Morand, ou encore de personnalités comme Georges Duhamel et Henri Mondor, qui ont un pied dans le monde médical et l’autre dans celui des lettres. Une telle photographie constitue une archive intéressante car elle montre le caractère artificiel de la séparation entre les lettres et les sciences. Elle soulève des questions qui sont autant de portes d’entrée novatrices et inédites dans l’histoire des liens entre médecine et littérature : quel idéal commun motive la rencontre des personnalités qui figurent sur cette photographie ? Pourquoi se laissent-elles représenter côte à côte ? Quelle place une revue telle qu’Art et médecine occupe-t- elle dans les paysages médical et littéraire du début des années 1930 ?
Actes du colloque. Explora 2011 à l'Université de Toulouse "Mécaniques du vivant : savoir médical et représentations du corps humain" Sous la direction de Laurence Talairach-Vielmas
ACTES DU COLLOQUE « LES ESPRITS ANIMAUX » 4-6 FÉVRIER 2016 FONDATION HARDT, GENÈVE TABLE DES MATIÈRES Téléchargez la table des matières…
Table des matières Préface, Éléments pour une histoire de la séparation des sciences et de la littérature Anne-Gaëlle Weber 5…
Eighteenth-Century Archives of the Body Conference Proceedings of the International Workshop Archives of the Body. Medieval to Early Modern, Cambridge University, 8-9 Sept. 2011
Détrôné au siècle suivant par le savant-chercheur, l’inventeur n’est pas encore au XIXe siècle ce spécimen loufoque qui prêtera à rire dans les futurs concours Lépine. Au contraire, la France postrévolutionnaire voit le sacre de l’inventeur comme figure d’exception, dont la légitimité a été renforcée par l’essor des sociétés d’émulation et la mise en place des systèmes de brevets, maillon indispensable entre l’invention et le capitalisme naissant. La création de la Société des inventions et découvertes composée « d’inventeurs, de savants, d’artistes et d’amateurs […] sans prééminence entre ces quatre classes » comme l’annoncent en 1790 ses statuts, a préparé et facilité l’adoption d’une loi « relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs », première pierre de notre législation sur les brevets. La monarchie de Juillet va également favoriser l’invention, notamment avec la loi de 1844 qui facilite le dépôt de brevet, puis la fondation en 1849 par le Baron Taylor de l'Association des Inventeurs et Artistes Industriels, qui marque le glissement vers un monde de l’invention divisé entre arts appliqués et mécanique, incluant désormais les ingénieurs. Le premier XIXe siècle est donc particulièrement attentif à l’inventeur, rouage précieux du nouveau système capitaliste ; c’est le temps des David Séchard, à la fois synthèse et référence d’un inventeur idéaliste sorti du rang, et au service du bien commun. Plus loin dans le siècle, en 1867, un pamphlet d’Yves Guyot défend explicitement un idéal de l'inventeur héraut de la société démocratique et républicaine, et constitue de ce fait un marqueur dans la construction médiatique cette fois du personnage d’inventeur.
Si l’univers de la médecine fait souvent intrusion dans l’espace scénique, et s’il peut apparaître comme un thème privilégié du…
Le sternum brûle la plèvre La plèvre, contractée, étouffe les poumons. L’air pleut en escarbilles sur l’estomac. Un acide coule le…
Depuis une dizaine d’années, certains chercheurs s’emploient à réactualiser le concept des esprits animaux. Minuscules corpuscules invisibles mais bien réels, composés d’air, de vent, de flamme ou de lumière selon les auteurs, ils avaient pour mission à la fois de capter les sensations du monde extérieur et celles de l’intériorité corporelle, d’en véhiculer les impressions jusqu’au cerveau, et de déclencher les mouvements corporels en fonction des impressions reçues. Leur rôle les ancraient au cœur du vivant et, malgré l’incertitude qui caractérisait leur nature physique, la réalité de leur existence ne faisait, depuis Galien, aucun doute ni pour les chimistes, ni pour les physiologistes, ni pour les romanciers, ni pour les médecins, ni pour les philosophes. Pour certains auteurs, ils circulaient dans tout le corps par les circuits veineux et/ou nerveux, pour d’autres ils évoluaient à l’intérieur de toutes les fibres, comme l’a récemment montré Hisao Ishizuka (2016).
Nous nous sommes engagés à partir de 2007, avec d’autres chercheurs, dans le projet Euterpe : la poésie scientifique en France de 1792 à 1939, parce nous nous étions heurtés, en suivant des voies diverses, à un obstacle commun. Nous trouvions au XIXe siècle, et parfois fort tard, des textes relevant d’un genre de poésie qui n’aurait pas ou plus dû exister à cette date. D’abord prises pour des isolats, ces œuvres, dont la science contemporaine constitue le principal sujet, s’avéraient assez nombreuses pour former une ligne continue, des lendemains de la Révolution jusqu’à l’aube du dernier siècle. Davantage, ces textes faisaient l’objet d’un intense débat, mobilisant durant toute la période des noms restés célèbres. Or de ces œuvres comme de ces polémiques les manuels d’histoire littéraire ne gardaient pas trace. Au mieux, ils rappelaient que la fin des Lumières et le Premier Empire avaient porté au firmament des poètes « didactiques » ou « descriptifs », comme Jacques Delille, chantre de l’histoire naturelle ou de la physique ; mais cette production n’avait pas de postérité
Ce livre a été réalisé au sein du Projet de Recherche ILICIA. Incripciones literarias de la ciencia. Lengua, ciencia y epistemología du Ministerio de Economía y Competitividad d‘Espagne (Proyectos de I+D, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento). Réf. FFI2014-53165-P, Université de Salamanca.
Entre les années 1920 et 1930 surgissent de nombreuses revues à vocation littéraire, voire poétique, éditées par les médecins pour les médecins, qui se retrouvent ainsi mis en réseau. Cet article propose de passer en revue les principales publications médico-littéraires de l’Entre-deux-Guerres, et de s’interroger sur le rapport que ces évadés de la médecine entretiennent avec leur pratique scripturaire. Comment les médecins intègrent-ils l’écriture, ce « violon d’Ingres », dans leur ethos scientifique? Quelle esthétique défendent-ils dans des productions voulant témoigner du mariage entre l’art et la médecine, alors même que les avant-gardes littéraires et la technicité accrue de la science semblent signer leur divorce ? mots-clés : revues médico-littéraires, Entre-deux-guerres, figure du poète-médecin, liens entre poésie et médecine, réseaux.
La discussion entre Goethe et Schiller sur la nature de la Urpflanze est bien connue : à Schiller qui décrétait « Das ist keine Erfahrung, das ist eine Idee », Goethe répondait : « Das kann mir sehr lieb sein, daβ ich Ideen habe, ohne es zu wissen, und sie sogar mit Augen sehe » . La plante « originelle » qui contiendrait en germe toutes les formes botaniques passées et futures serait donc, d’après son inventeur, aussi réelle qu’idéale. Goethe mit un certain temps à trouver un dessinateur digne, à ses yeux, de dresser les planches du Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. L’honneur revint à Pierre-Jean-François Turpin qui avait illustré l’Organographie végétale d’Auguste-Pyrame de Candolle en 1827. Le même Turpin présenta en 1837 à l’Académie des sciences l’illustration de la Urpflanze, illustration reprise la première traduction française des « œuvres d’histoire naturelle de Goethe », éditée en 1837 par Charles Martins et commentée en ces termes : « La planche III, dont il avait déjà conçu l’idée depuis 1804, est la réalisation de la métamorphose au moyen d’une plante, dont l’ensemble est idéal tandis que toutes les parties qui la composent se retrouvent isolément sur divers végétaux » . L’archétype ou l’origine idéale de toutes les formes botaniques, sur le dessin de Turpin, se présente comme une plante luxuriante et monstrueuse, reconstruite a posteriori à partir de tous les types connus et classés et contenant donc, rétrospectivement, tous les développements possibles des végétaux. La Urpflanze, aussi bien décrite par Goethe que dessinée par Turpin, pourrait aisément devenir le symbole d’une entreprise d’élaboration rétrospective de l’histoire de la séparation des sciences et de la littérature, oscillant entre l’observation, dans des textes littéraires et savants, de la manière dont la séparation joue et se dit et l’idéal d’une séparation des sphères décrétée a posteriori. Téléchargez cet article au format PDF: pdf/preface.pdf
Actes du Colloque Explora Mécaniques du vivant : Savoir médical et représentations du corps humain (XVIIe siècle-XIXe siècle) Université de Toulouse, 4-5 décembre 2011 :
Résumé : Si la médecine ancienne est souvent définie comme une médecine « humorale », c’est avant tout parce que la…
Pour bien comprendre le sens de mes réflexions sur l’invention en littérature, il n’est pas inutile de rappeler un certain nombre de faits historiques et juridiques qui ont fait de l’invention un concept à part entière pour désigner dans l’ordre des activités humaines la production du neuf. Historiques et juridiques, car la question de l’invention s’est posée de la sorte dès le XVIIIe siècle dans le monde de l’artisanat et de l’industrie afin d’assurer aux « inventeurs » la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle de leurs inventions. Ce qui soulève la question du rapport entre l’individuel et le collectif, l’inventeur et la société. Ce cadre juridique a été bien étudié par les historiens, et je renvoie aux travaux de Christine Demeulenaere et de Gabriel Galvez-Béhar. Deux lois importantes à cet égard : celle du 7 janvier 1791 et celle du 5 juillet 1844, qui régissent l’obtention d’un brevet sous forme contractuelle entre l’inventeur et l’Etat dans une société qui, à l’instar de l’Angleterre, entend prendre le pas de l’industrialisation (plusieurs modifications ont été apportées dans le sens d’un assouplissement, notamment des taxes, au moment des grands expositions universelles, dès 1855). Toute découverte ou invention — la loi de 1844 a été d’application jusqu’en 1968 — devant remplir deux conditions : « être nouvelle et avoir un caractère industriel » (Galvez-Behar, p. 30), ce qui exclut d’office le brevetage des découvertes purement théoriques et scientifiques.
La médecine est omniprésente au théâtre, tant sur le plan thématique que du point de vue des dispositifs, elle qui…
Abstract: This article examines the ways in which the human body was represented in eighteenth-century France, using a range of surgical…