Présentation
La plupart des scientifiques s’entendent aujourd’hui pour penser que la biologie sera le paradigme scientifique du 21ème siècle. Dès le début…
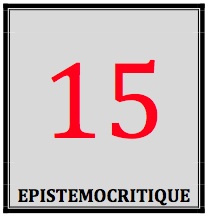 Epistémocritique, Volume 15. Savoirs et littérature dans l’espace germanophone.
Epistémocritique, Volume 15. Savoirs et littérature dans l’espace germanophone.
On assiste aujourd’hui à une véritable explosion des recherches sur les savoirs et la littérature en Europe. Il devenait urgent de rendre compte de la vitalité de ces recherches en faisant un tour d’horizon des travaux qui essaiment aujourd’hui à travers toute l’Europe. Cette quinzième livraison d’Epistemocritique initie ce tour d’horizon par un état des lieux de la recherche dans les pays de langue allemande (Allemagne, Autriche, Suisse), où une variété d’approches et de positions différentes se sont développées, donnant lieu à des controverses parfois très vives. Réalisé par Hildegard Haberl, ce numéro d’Epistemocritique propose un éventail de quelques-unes de ces approches et orientations ainsi que des tensions et débats qu’elles ont suscités, témoignant de la vitalité d’un champ aujourd’hui en plein essor dans le monde germanophone.
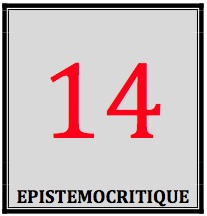 Epistémocritique, Volume 14. GREFFES.
Epistémocritique, Volume 14. GREFFES.
Greffes, hybridations, percolations… les métaphores ne manquent pas pour décrire la circulation des modèles, des idées et des représentations entre sciences et littérature. Parmi ces métaphores, celle de la greffe jouit d’une mémoire culturelle et d’une épaisseur historique toutes particulières : aux XVIIIe et XIXe siècles, elle a été mobilisée de façon massive par les scientifiques et les écrivains pour figurer différentes modalités du dialogue entre discours littéraires et savants. Les études réunies dans ce volume illustrent quelques-unes de ces modalités, interrogeant à partir d’exemples précis les rapports réciproques de la science et de la littérature, leur concurrence possible dans le champ du savoir, mais aussi la manière dont se constituent l’une par rapport à l’autre la « connaissance de l’écrivain » et la « connaissance du savant.
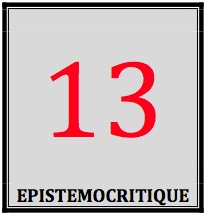 Epistémocritique, Volume 13. Littérature et savoirs du vivant.
Epistémocritique, Volume 13. Littérature et savoirs du vivant.
Depuis le 19ème siècle, moment où naissent les sciences du vivant, la circulation des modèles et des théories liés à ce domaine crée un espace de production épistémique qui permet aux représentations culturelles du vivant de se diffuser et de percoler dans la pensée historique, politique et sociale grâce à une série d’analogies, de déplacements métaphoriques, de généralisations et d’extrapolations. Les études réunies dans ce numéro visent à cerner la diversité de ces appropriations et des usages qui ont été faits des sciences du vivant dans le champ plus vaste des savoirs sur l’homme, mais aussi dans la production littéraire et, plus généralement, dans l’imaginaire, afin de mettre en évidences leurs enjeux idéologiques ainsi que les effets de culture qu’elles ont produit.
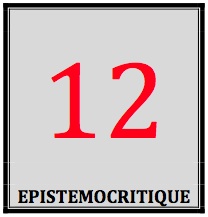 Epistémocritique, Volume 12. Littérature et économie.
Epistémocritique, Volume 12. Littérature et économie.
Le monde économique et le monde de la littérature et des arts ont souvent, depuis le Romantisme, été considérés comme antithétiques. Cependant les relations économiques sont présentes dans de nombreux textes et dessinent même une tradition littéraire. Après un bref parcours historique, du marchand dans la littérature du XVIIe siècle au Robinson de Defoe, des tribulations des personnages de Balzac dans le contexte du libéralisme naissant aux textes de Masséra, la littérature mettant en scène l’économie, surtout en période de crise, ne se contente pas de la représenter mais elle interroge les principes et l’éthique qui la fondent et entretient avec elle un dialogue constant .
La plupart des scientifiques s’entendent aujourd’hui pour penser que la biologie sera le paradigme scientifique du 21ème siècle. Dès le début…
Depuis un certain nombre d’année je puise dans le corpus de poésie québécoise des fragments de discours, des citations scientifiques qui ont donné lieu à un long inventaire, qui pourrait constituer mis bout à bout un seul texte qui remonte aux années 1900 et qui se poursuit encore de nos jours, tout en restant difficilement saisissable parce qu’il est le résultat de centaines d’éclats, aussi bien dire des particules (quand j’y jette un regard optimiste) ou des débris (quand je m’interroge sur la pertinence de ma démarche). Ce long texte bigarré, anecdotique, peut-être même très peu digne de l’intérêt que j’oblige mon lecteur à lui porter en ce moment, entre autres parce qu’il ne donne aucune garantie de réussite esthétique des poèmes retenus, me pose tout de même des questions sur les rapports que peuvent entretenir la poésie et la science.
Cette cinquième livraison de la revue Epistemocritique pourrait être placée sous l’égide de Goethe, dont la pensée esthétique et épistémologique est…
Cette neuvième livraison de la revue Epistémocritique est consacrée à une approche critique aujourd’hui en plein essor, dont l’actualité éditoriale vient…
El presente número 16 de la revista Épistemocritique surgió con el propósito de dar mayor visibilidad a las diversas…
La présence des théories de l’évolution et, en particulier, des références darwiniennes dans la fiction britannique contemporaine est notable et a fait l’objet de plusieurs études récentes1. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer et, parmi eux, le développement d’un courant qualifié de néo-victorien, qui réunit des œuvres dont l’intrigue se situe en totalité ou pour partie au XIXe siècle. Sally Shuttleworth a pu mettre en relation la floraison de ces romans dans les années 1990 avec la politique menée par le gouvernement de Margaret Thatcher. Selon Shuttleworth, ce choix narratif permettait une double critique, par une discussion des structures de la famille victorienne exaltées par M. Thatcher comme un modèle d’ordre et de stabilité et par la mise en perspective du XIXe siècle anglais à un moment où le gouvernement s’en servait pour justifier une forme de darwinisme social2. L’œuvre d’Antonia S. Byatt s’inscrit pour une large part dans ce champ, en accordant une place importante à l'époque victorienne, que tout le récit y prenne place3 ou qu'il se construise dans l'alternance des deux plans temporels4.
Editorial. Cette huitième livraison d’Épistémocritique s’ouvre résolument à la diversité pour explorer quelques-unes des voies émergentes dans le champ des relations…
Hervé-Pierre Lambert Présentation I. La synesthésie, une révolution scientifique et culturelle Carol Steen Synesthesia : Seeing the World Differently Marcia Smilack…
Depuis près de 150 ans, Leconte de Lisle se trouve injustement relégué dans une Grèce de marbre. Cependant – et c’est ce qui fait pour partie l’originalité de l’œuvre – son passéisme revendiqué s’allie à des connaissances scientifiques très actuelles.
Au confluent des sciences du vivant et de la littérature, ce numéro d’Épistémocritique interroge le rôle du virus et du parasite dans l’imaginaire…
Pourquoi se parler, intérieurement ? De quoi nous parlons-nous ? Comment se structurent nos espaces mentaux ? L’abondance des études sur le langage intérieur ces dernières décennies est spectaculaire. Néanmoins, des lacunes subsistent et des pans entiers restent à explorer, comme la question des espaces intérieurs. La représentation des espaces intérieurs n’a généralement été abordée que sous un angle métaphorique, ou indirect. Les liens entre espaces intérieurs et langage intérieur n’ont guère été explorés au sein d’une discipline et encore moins à l’interface entre plusieurs disciplines. L’objectif de ce numéro d’Épistémocritique est de poser des premiers jalons dans cette direction, à la convergence entre linguistique, neurosciences, études littéraires, théâtrales et cinématographiques.
Cette nouvelle livraison d' Épistémocritique invite à explorer des territoires du savoir dont les relations avec la littérature vont plus loin…
Cette nouvelle livraison d’Epistemocritique se penche sur la notion de machine, souvent mobilisée par la littérature pour servir de miroir à l’humain, mais qui intéresse aussi en tant que dispositif textuel. De l’homme-machine à la machine-texte, c’est tout un éventail de machinations textuelles qu’explorent les études réunies ici.
Ce champ critique ouvert par Jean-Joseph Goux dans les années 80 et illustré aujourd’hui en France principalement par les travaux d’Yves…
Cette seconde livraison d' Épistémocritique permet d'appréhender l'étendue et la vitalité du domaine de recherche représenté par l'ensemble des interrogations que…
Ce 15e numéro d’Epistémocritique a pour objectif de présenter la recherche sur « Littérature et savoir(s) » dans les pays germanophones[1]. Le rythme…
La vérité de la fiction Cette dixième livraison de la revue Epistémocritique est consacrée à la question d’agrégation de littérature comparée…
La présente étude se propose d’examiner, dans une approche épistémocritique, les différentes modalités de fonctionnement du savoir médical dans La Vie devant soi. Nous ne ferons qu’en noter la fonction référentielle — l’illusion de la réalité d’un univers marqué par le vieillissement, la maladie et la mort passant obligatoirement par l’introduction d’une composante médicale —, pour nous concentrer sur l’analyse de fonctions plus spécifiques.
Résumé : En convoquant une histoire historienne des sciences attentive à étudier le passé de la science pour lui-même et dans ses propres termes, l’étude des relations entre littérature et savoirs du vivant enrichit notablement son propos et se prémunit contre toute forme d’anachronisme. Des exemples puisés chez La Fontaine, Balzac et surtout Laurence Sterne illustrent la fécondité de cette démarche encore peu répandue. Inversement, en s’ouvrant à des discours dont les codes ne lui sont pas familiers, l’histoire des sciences trouve matière à repenser certains de ses paradigmes, pour ne pas dire mythes.
à Amy Ione Carol Steen, Clouds Rise Up 2004-05, huile sur masonite recouverte de toile, 62.5 x 51cm. I…
Les découvertes dans le domaine des neurosciences ont commencé avant la révolution de la neuroimagerie des années 1990, qui est souvent…
Résumé : Qu’est-ce que cette petite voix dans notre tête ? À quoi sert-elle ? Pourquoi se parler, en son for intérieur ou à voix haute ? Quelles sont les formes et les modalités de langage intérieur ? Et quel rôle joue-t-il dans notre rapport au texte littéraire, théâtral ou cinématographique ? Malgré d’abondantes publications ces quarante dernières années, principalement en anglais, la plupart des études sur la parole intérieure commencent par un sempiternel constat de méconnaissance. Récemment encore, le sociologue Norbert Wiley (2016) ne déroge pas à cette règle tacite. Il faudrait en réalité distinguer soigneusement les questions qui ont polarisé l’attention, les disciplines qui restent peu impliquées, et les lacunes qui s’en suivent (pour un état de l’art plus complet sur le langage intérieur, voir Bergounioux, 2001, et Smadja, à paraître). Au sein d’un domaine où il subsiste encore des pans entiers à explorer, l’espace intérieur, c'est-à-dire les représentations mentales de l'espace, a un statut particulier, puisqu’il n’est quasiment pas abordé ou seulement de façon indirecte et/ou métaphorique. Pourtant, notre parole intérieure participe de l'élaboration des espaces imaginés que nous habitons au quotidien, qu'il s'agisse de nous remémorer des environnements familiers, de nous projeter dans des espaces fictionnels lors de la lecture d'un roman ou à l’occasion d’une rêverie, ou de planifier un déplacement vers un lieu réel. Le présent numéro d'Épistémocritique – Revue de littérature et savoirs vise à remédier à ce manque, en explorant les liens entre parole et espace intérieurs. Afin de nous mieux orienter dans cette exploration, nous vous proposons maintenant quelques repères qui ont jalonné l'histoire de ce domaine.
Este artículo revisa el concepto de mímesis en la confluencia del postestructuralismo, el budismo y el comparatismo entre literatura y ciencia. A partir de este cruce de disciplinas se defiende la vertiente más creativa de la mímesis, ortodoxamente entendida por la teoría literaria tradicional como una representación pasiva de la realidad. La importancia del sujeto observador en la física cuántica o la trascendencia de la mente a la hora de determinar la realidad sensible, postulada por el budismo, apuntan hacia una revisión de la mímesis para destacar en el fenómeno su potencial creativo en detrimento de la función de copia engañosa que peyorativamente le atribuyó Platón. Como última consecuencia, de la revisión del concepto de mímesis se deriva la posibilidad de extender los procesos miméticos a agentes naturales no humanos, contribuyendo de esta manera a la reubicación del antropocentrismo en la epistemología actual. Palabras clave: budismo, física cuántica, realismo agencial, creatividad, verosimilitud. Cet article réexamine le concept de mimesis à la croisée du poststructuralisme, du bouddhisme et du comparatisme entre littérature et science. À partir de ce carrefour de disciplines, c’est la facette la plus créative de la mimesis qui est défendue, comprise de manière orthodoxe par la théorie littéraire classique comme une représentation passive de la réalité. L’importance du sujet observateur en physique quantique ou la transcendance de l’esprit au moment de déterminer la réalité sensible, postulée par le bouddhisme, vont dans le sens d’une révision de la mimesis pour mettre en valeur le potentiel créatif du phénomène au détriment de la fonction péjorative de copie trompeuse que lui avait attribuée Platon. Conséquence ultime, il résulte de ce réexamen du concept de mimesis une possibilité d’étendre les processus mimétiques à des agents naturels non-humains, contribuant ainsi à replacer l’anthropocentrisme dans l’épistémologie actuelle. Mots-clés : bouddhisme, physique quantique, réalisme agentiel, créativité, vraisemblance.
La greffe, entendue à la fois comme l’opération de greffe et son résultat, n’est ni l’hybride, ni le monstre. Dans la Physiologie végétale, en 1832, Auguste-Pyrame de Candolle tente de distinguer les « espèces » des « variations » et, pour ce faire, passe en revue les moyens de reproduction, naturels ou artificiels, des plantes. L’hybridité est, selon lui, le résultat de la fécondation d’une plante par une autre ; le physiologiste y voit la preuve de l’existence d’un sexe des plantes. Il juge toutefois la définition originelle du phénomène, donnée par Linné, tributaire de beaucoup d’analogies et de peu de raison ; le naturaliste suédois aurait déduit de la simple ressemblance de plantes contiguës l’existence d’hybridités qui n’étaient que des variations[1]. Des déformations, qui ne doivent pas être confondues avec les monstruosités, de Candolle écrit qu’« elles sont le produit des circonstances extérieures », là où les « monstruosités tiennent au principe même de la reproduction »[2]. Viennent ensuite les cas de « dégénérescences » dérivés de l’idée de « métamorphose » défendue par Goethe, et ceux des soudures de tissu cellulaire parmi lesquelles figurent les greffes
Parmi les problématiques à l’œuvre dans les relations entre littérature et neurosciences, l’une d’elles s’applique directement au phénomène cognitif de la mémoire, à savoir dans quelle mesure, pour les neurosciences, la littérature rend compte de manière scientifiquement valide du fonctionnement de la mémoire individuelle. Depuis une dizaine d’années, les neurosciences se sont intéressées à l’apport cognitif de la littérature que représente l’œuvre de Proust et des expressions comme : « syndrome proustien », « Proust neurologue », « Proust phenomenon », «the Proustian hypothesis », « Proust as a neuroscientist » sont maintenant utilisées. [Une version imprimable de cet article est accessible en pied de page]
Mon but est de cerner, dans quelques textes de Poe, une certaine image de la machine. Je ne m'intéresserai qu'à la machine en tant qu'elle est susceptible d'imiter l'humain, et j'interrogerai la nature et les limites que les textes de Poe attribuent à une machine qui contreferait, autant que possible, l'humain.
Parce qu’elle met en jeu des procédures cognitives qui diffèrent de celles de la science ou de la philosophie, la littérature se conçoit souvent comme contre-savoir poétique ou même comme non-savoir. Par là, elle cherche moins à tracer une frontière qu’à exhiber le retournement toujours possible du déjà-su en insu, des réponses admises en nouveaux questionnements, de l’irrationnel en figure possible d’une autre raison.
Face à la présence encore discrète des virus dans la littérature contemporaine, cet article examine quelques défis narratifs posés par la mise en récit des découvertes récentes de la virologie. Quels procédés littéraires peuvent transposer ces relations complexes, impliquant différentes échelles et différentes temporalités du vivant ? La modélisation en science a-t-elle des cousins en littérature, des procédés de formalisation qui pourraient communiquer les mêmes idées ? Cette réflexion est le fruit d’un dialogue entre un biologiste écrivain, qui s’interroge sur les moyens de transposer les connaissances et l’esprit des découvertes de microbiologie dans des récits, et une spécialiste de littérature anglophone, s’intéressant à l’imaginaire biologique du roman contemporain. Leur visée est aussi bien analytique que prospective : les trois premières sections s’appuient sur un panorama de la fiction narrative existante inspirée par les virus, de la science-fiction des années 1980 au roman contemporain (francophone et anglophone) ; les deux suivantes imaginent des pistes pour une littérature du virus encore à venir. Cinq pistes narratologiques sont ainsi explorées : i) les jeux de focalisation et d’échelle permettant de tenir compte de l’extrême hétérogénéité de la taille des populations interactives des virus et de leurs hôtes, et de la multiplicité des échelles temporelles et physiques exploitables ; ii) le potentiel déstabilisateur des virus dans les schémas actantiels classiques, en raison de la dynamique complexe de leurs relations avec leurs hôtes ; iii) la métaphorisation par la littérature d’un discours scientifique non exempt de ses propres métaphores, cette métaphorisation littéraire reposant sur une diversité d’imaginaires mobilisés ; iv) la transformation des relations virales en schèmes poétiques, et la transposabilité rhéthorique des images structurantes du discours scientifique ; v) l’intégration de nouveaux personnages qui correspondraient aux superorganismes associant les virus et leurs hôtes. Mots-clés Virus, récit, biologie, littérature, échelle, évolution, réseau, holobionte, focalisation, actant, métaphore, schème, organisme.
E.A. Poe s'est souvent penché sur les mécanismes de la pensée [1]. En témoignent des textes tels que « Le Scarabée d’or [2] », « Quelques…
Le concept théorique de « ville créative » [1] pose les conditions selon lesquelles un espace urbain augmentera idéalement son potentiel d’attractivité en se…